
Texte © Prof. Angelo Messina

Traduction en français par Jean-Marc Linder

Appelés aussi Poissons osseux, les Ostéichthyens sont une classe de vertébrés équipés de mâchoires, comme ce redoutable Tylosurus crocodilus © Jean-Marie Gradot
Plus simplement appelés Poissons osseux, les Osteichthyes représentent une classe de vertébrés à mâchoires (Gnathostomata) à laquelle on associe des entités caractérisées par un squelette complètement ou au moins largement ossifié à l’âge adulte, d’où leur nom scientifique.
Les animaux des formes les plus primitives, comme les Placodermi et les Ostracodermi, ne présentent pas encore de corps vertébraux et le processus d’ossification ne concerne que le crâne, seulement recouvert de grandes arêtes dermiques.
Il n’y a que chez les Teleostei que les structures squelettiques sont complètement ossifiées et que la colonne vertébrale constitue l’axe de soutien de l’ensemble du squelette.
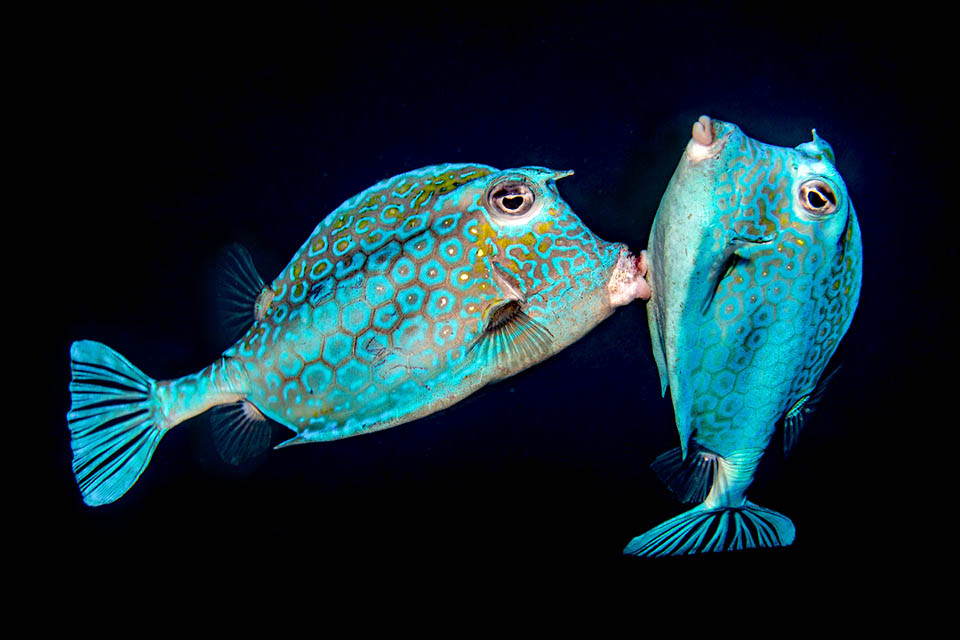
Chez les Ostéichthyes, comme ce Acanthostracion polygonium, la bouche s’ouvre en position terminale, contrairement aux poissons cartilagineux où elle est généralement ventrale et oblique. Le crâne est constitué d’un nombre varié d’os formant une boîte rigide, et leur présence ou leur absence a une grande importance taxonomique © Allison & Carlos Estape
À ce sujet, il faut indiquer que, traditionnellement considéré comme synonyme d’Osteichthyes, le terme Teleostei ne désigne actuellement qu’un groupe au sein des Actinopterygii au niveau systématique inférieur de l’infraclasse.
Il faut savoir que le tissu osseux est présent même chez les poissons cartilagineux (Chondrichthyes), mais limité aux minuscules écailles placoïdes qui forment le revêtement dermique. En revanche, chez les Osteichthyes , les tissus osseux jouent un rôle fondamental dans le développement évolutif de la classe. En effet, tout au long de leur histoire évolutive, qui a probablement commencé en milieu aquatique continental avec les formes les plus archaïques, ce tissu remplace progressivement, chez les Poissons osseux, chaque composant cartilagineux du squelette interne et des formations dermiques, depuis les formations crâniennes jusqu’aux vertébrales, en passant par les branchies et les nageoires.

Certains Ostéichthyes sont de taille très modeste, comme ce Paedocypris progenetica, qui dépasse rarement 10 mm © Ganjar Cahyadi
En règle générale, les Osteichthyes ont un neurocrâne composé d’un nombre varié d’os disposés de manière à former une boîte rigide. La présence ou l’absence de certains os crâniens revêt d’ailleurs une importance considérable pour la systématique.
La bouche des Poissons osseux, à la formation de laquelle participent divers éléments ossifiés, est généralement large et s’ouvre en position terminale, à la différence des Poissons cartilagineux chez lesquels elle est généralement ventrale et oblique.
Les mâchoires, habituellement bien développées, sont composées de structures ossifiées qui s’articulent au crâne par une connexion également osseuse. Tous les éléments osseux qui contribuent à la formation de la bouche, y compris ceux qui constituent les arcs branchiaux, peuvent être pourvus de dents (mâchoires pharyngienne).
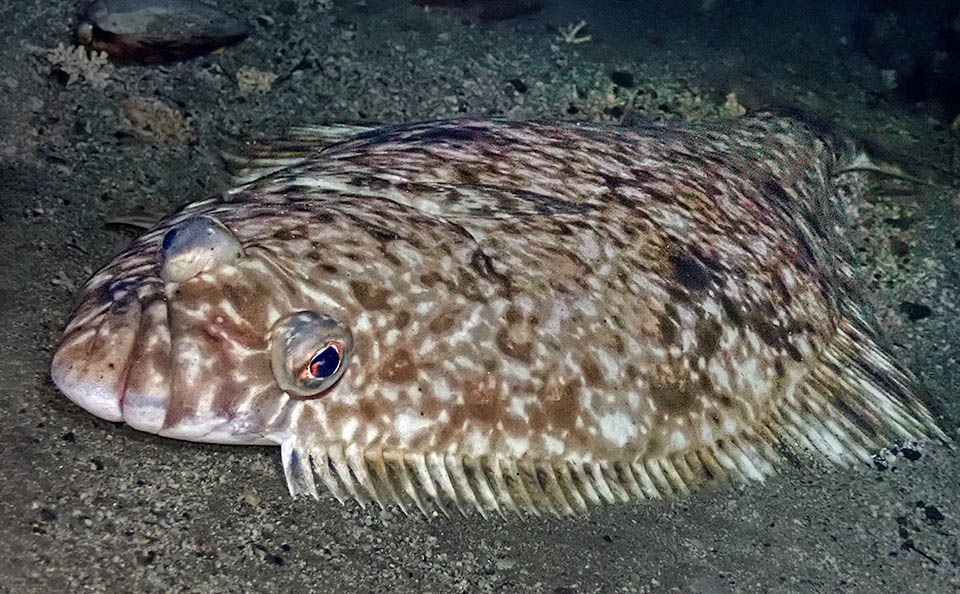
À l’opposé, le Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus) mesure environ 3 m © Vsevolod Rudyi
La configuration structurelle de la bouche, particulièrement riche en éléments squelettiques, et sa position terminale, ont contribué à une série d’adaptations de ces poissons à une extraordinaire variété de stratégies alimentaires, caractéristique qui explique le succès évolutif de cette classe.
La taille des Poissons osseux est extrêmement variable et va de quelques millimètres à plusieurs mètres. Parmi les formes les plus petites, on trouve les espèces de Paedocypris (Kottelat et alii, 2006), petits poissons des eaux de Sumatra qui ne dépassent pas 7,9 mm de longueur chez les femelles et 10 mm chez les mâles. Le Gobie pygmée nain (Pandaka pygmaea Herre, 1927) et le Sinarapan (Mistichthys luzonensis, Smith 1902), Gobiiformes des Philippines, sont aussi certainement parmi les plus petits des poissons osseux, avec des longueurs respectives de 10 et 11 mm.

Et l’Espadon (Xiphias gladius) est tout aussi grand © Pierre Jaquet
Parmi les plus grands Osteichthyes, on trouve l’Espadon (Xiphias gladius Linnaeus, 1758) et le Flétan de l’Atlantique ou Flétan blanc (Hippoglossus hippoglossus Linnaeus, 1758), qui mesurent tous deux près de 3 m de long.
Parmi les géants de la classe figurent certainement le Bélouga ou Grand esturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758), ainsi que l’Esturgeon d’Europe (Acipenser sturio Linnaeus, 1758) : bien qu’exceptionnellement, ce dernier peut cependant atteindre 6 m de long.
Le record des géants revient sans aucun doute au Ruban de mer (Regalecus glesne Ascanius, 1772), poisson des abysses présent dans tous les océans, qui mesure en moyenne 7 m mais peut atteindre et dépasser les 10 m. À ce sujet, on peut aussi rappeler qu’il n’y a pas si longtemps encore, les eaux de la mer Caspienne hébergeaient des esturgeons (Acipenser sturio Linnaeus, 1758) mesurant jusqu’à 9 m et pesant jusqu’à 1 500 kg.
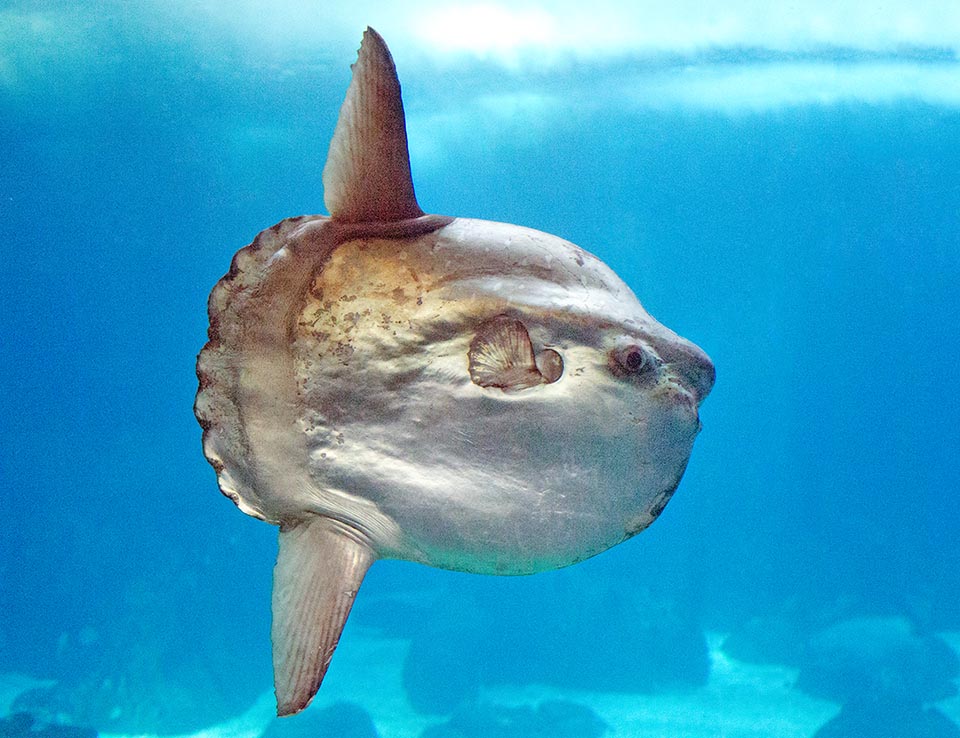
Parmi les plus lourds, voici le Poisson-lune (Mola mola), qui peut peser jusqu’à une tonne © Giuseppe Mazza
Cependant, mises à part quelques formes de taille extrême, la plupart des poissons osseux mesurent généralement moins d’un mètre. Avec leur taille, leur poids est également très variable et peut fluctuer fortement entre quelques grammes et près d’une tonne comme chez le Poisson-lune (Mola mola Linnaeus, 1758).
Le corps des poissons osseux est généralement fusiforme, mais son apparence est très variable. De nombreuses espèces benthiques, marines et d’eau douce, présentent un corps aplati ; chez certains groupes, comme les anguilles, il est allongé et serpentiforme.
Cependant, le corps peut être de forme globulaire, comme chez les poissons-globes (Tetraodontidae), cubique, comme chez les poissons-coffres (Ostraciidae) ou encore de forme tout à fait singulière, comme pour les espèces surprenantes de l’ordre des Syngnathiformes.
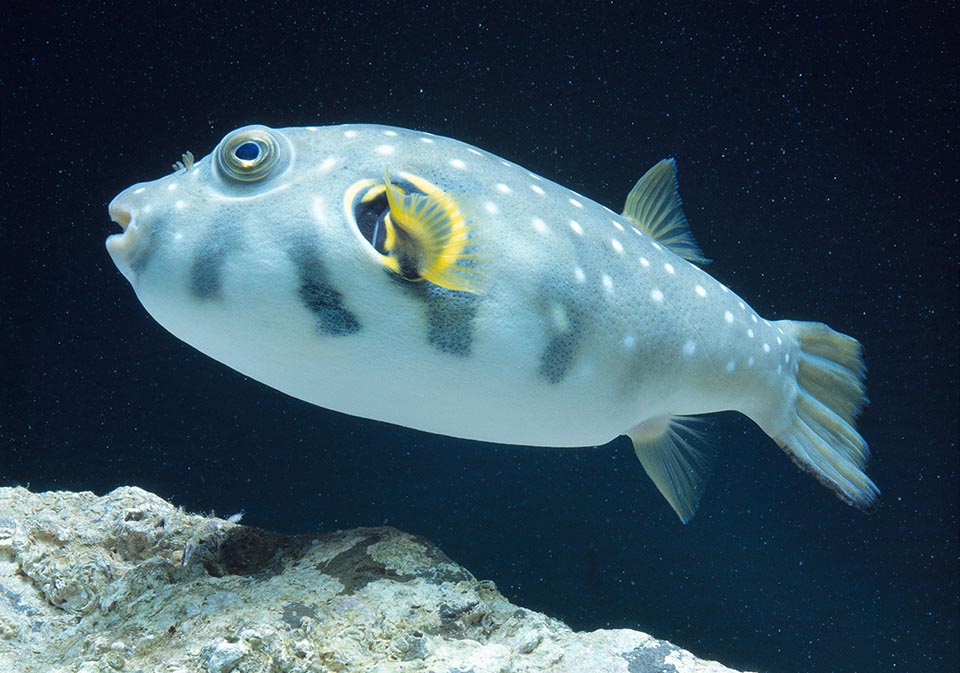
Le corps des poissons-globes comme Arothron hispidus est globuleux, et les poissons-coffre, comme Acanthostracion polygonium que voici, ne manquent pas © G. Mazza
Le corps des poissons osseux est recouvert d’écailles dermiques ossifiées (cténoïdes, cycloïdes, parfois ganoïdes). La protection du corps est parfois une véritable armure d’écailles ganoïdes (Lepisosteiformes et Polypteriformes).
Chez certaines espèces, la peau est complètement dénudée ou porte quelques écailles vestigiales (Polyodontidae). D’autres espèces ont un corps nu seulement en partie, le reste étant protégé par des plaques osseuses ou des écailles ganoïdes, comme c’est le cas chez les esturgeons (Acipenseridae).
La coloration du corps est très variable et constitue souvent le caractère le plus évident des poissons osseux. Cette coloration est principalement assurée par des cellules pigmentées (chromatophores) situées dans le derme, sur l’extérieur des écailles ou sous celles-ci, et dont le nombre et la disposition sont contrôlés par des nerfs ou des hormones.

Très souvent, les poissons peuvent changer rapidement de couleur en jouant des chromatophores de la peau. Tel est le cas de cet Hippocampus reidi © Allison & Carlos Estape
Chez les représentants de cette classe, les yeux, généralement latéraux et bien développés, sont dépourvus de paupières. Deux sacs olfactifs dorsaux, sans communication avec la cavité buccale, sont présents.
Chez les Osteichthyes, les branchies ont une conformation dite en peigne en raison de l’absence de cloisons entre les lamelles branchiales. Les branchies sont soutenues par quatre arcs branchiaux et disposées à l’intérieur de deux chambres branchiales, une de chaque côté, qui communiquent avec le milieu extérieur par des ouvertures situées derrière les yeux. Les branchies et les chambres branchiales sont protégées par un repli tégumentaire soutenu par des os operculaires d’origine dermique et qui se contracte avec l’arc hyoïde.
Les poissons osseux sont généralement dépourvus de spiracles. Ils ne peuvent être présents que chez les espèces aux caractéristiques les plus primitives, mais sous une forme très réduite.

Les nageoires, soutenues par de nombreux rayons dermiques ossifiés disposés parallèlement entre eux comme chez Acanthurus pyroferus, sont typiques des Osteichthyes © Giuseppe Mazza
Les individus de cette classe ont des nageoires de forme, de taille et de position très variables. La plupart du temps, elles sont soutenues par de nombreux rayons dermiques ossifiés, disposés parallèlement les uns aux autres.
En revanche, les représentants des Crossopterygii, groupe d’Osteichthyes auquel la plupart des spécialistes attribuent le rang de sous-classe, se caractérisent par le fait que chacune des nageoires paires, pectorale et pelvienne, est implantée sur une seule base distincte, qui s’articule à son tour, respectivement, avec la ceinture pectorale et la ceinture pelvienne.
Des parties osseuses des nageoires des Osteichthyes primitifs, Dipnoi ou Crossopterygii, dérive très probablement le squelette des membres de tous les Tetrapoda, vertébrés caractérisés par deux paires de membres (Amphibiens, Mammifères, Reptiles, Oiseaux) qui ont pu être modifiés voire disparaître au cours de l’évolution.

Elément anatomique typique des Osteichthyes, la vessie natatoire est presque toujours hydrostatique, parfois aussi respiratoire pour coloniser le milieu subaérien, comme c’est le cas chez les formes les plus primitives. Elle manque quand elle n’est pas nécessaire, comme chez cet Echeneis naucrates qui se déplace le plus souvent fixé à un hôte © Allison & Carlos Estape
La queue des Osteichthyes est typiquement homocerque ou diphycerque, parfois hétérocerque. Une autre caractéristique anatomique typique des Osteichthyes est la présence d’une vessie natatoire, invagination de la paroi de l’œsophage, remplie de gaz et qui, chez la plupart de ces poissons, est unique et située dorsalement par rapport au canal digestif. Chez les formes plus primitives en revanche (Dipnoi et Crossopterygii), cet organe consiste en une paire d’invaginations en forme de sac situées ventralement, à l’arrière du pharynx.
Tout au long de l’histoire des Osteichthyes, la vessie natatoire a connu une évolution dans deux directions déterminantes pour l’évolution de ces poissons, d’une part vers une spécialisation marquée pour l’environnement aquatique, et d’autre part vers l’acquisition de caractéristiques qui sont des conditions préalables importantes pour la colonisation des milieux subaériens.

Elle manque aussi chez la sole et le turbot, espèces qui, comme ce Bothus lunatus, vivent pour l’essentiel sur les fonds marins © Mickey Charteris
D’un côté, pour tout un groupe d’Osteichthyes, la vessie gazeuse acquiert les fonctions d’un organe hydrostatique et devient un outil précieux, grâce auquel, en faisant varier son contenu gazeux, ces poissons sont en mesure d’adapter leur poids spécifique à celui de l’eau dans laquelle ils vivent et d’effectuer des déplacements dans le sens vertical (vessie natatoire).
Par contre, chez les formes plus primitives des Ostéichthyens, Dipnoi et autres groupes, cet organe fonctionne comme un poumon ; chez certaines espèces, il est accompagné de structures accessoires qui leur permettent de respirer l’air atmosphérique.
La vessie natatoire peut être reliée (physostomes) ou non (physoclystes) au pharynx, ou se contracter avec le labyrinthe par l’intermédiaire de l’appareil de Weber. La vessie natatoire est associée à un dense réseau de capillaires, le rete mirabile ou réseau admirable, qui lui permet de se remplir de gaz à l’opposé du gradient.

Parmi les Poissons osseux, les espèces hermaphrodites qui changent de sexe avec l’âge ne sont pas rares. Ainsi, dans les petites communautés de Amphiprion ocellaris, les femelles dominent. Lorsque la reine meurt, le mâle le plus ancien se transforme en femelle et prend sa place, phénomène appelé hermaphrodisme par proterandrie © Michael Eisenbart
La vessie natatoire a des parois tapissées de guanine, substance azotée qui est aussi un composant des acides nucléiques, ce qui la rend imperméable ; elle est équipée d’une valve, appelée ovale, qui sert à la dégonfler. La conformation de la vessie, voire son absence, sont des éléments importants dans la systématique de ces poissons.
Le cœur, dans lequel ne passe que le sang veineux, comporte deux cavités de pompage (une oreillette et un ventricule) auxquelles s’ajoutent un sinus veineux et, dans certains cas, un cône artériel.
Comme les poissons cartilagineux, les poissons osseux sont des animaux à sang froid et leur température corporelle varie en raison des fluctuations de la température ambiante (hétérothermie). Cependant, les poissons de grande taille et particulièrement actifs sont capables d’augmenter leur température corporelle par des voies métaboliques.

Chez les mérous, comme Cephalopholis argus, ce sont les femelles qui changent de sexe quand les mâles sont rares : c’est l’hermaphrodisme protogyne © Barry Fackler
Les sexes sont généralement séparés, mais il existe des cas d’hermaphrodisme. La fécondation est externe à quelques exceptions près.
La plupart des espèces de Poissons osseux sont ovipares, mais les cas d’ovoviparité ou de viviparité sont nombreux.
Les œufs sont généralement très petits et déposés en grand nombre, parfois plusieurs millions.
À la naissance, les jeunes peuvent ressembler parfaitement à leurs parents ou être très différents. Dans ce dernier cas, ils subissent une métamorphose qui peut parfois être très complexe.
Distribution

La plupart des Osteichthyes sont ovipares. Il peut y avoir des accouplements de masse, comme chez ces Lutjanus bohar, avec des millions d’œufs et des nuages de sperme © Richard Barnden
Présents dans toutes les mers, depuis la surface jusqu’à des profondeurs dépassant 9000 m, dans les eaux saumâtres comme dans les eaux douces, les Osteichthyes représentent la classe de Vertébrés la plus riche ; selon une estimation à considérer comme très approximative, ils comprendraient aujourd’hui entre 20.000 et 30.000 espèces vivantes.
L’histoire évolutive des Osteichthyes est incontestablement très complexe et présente plusieurs zones d’incertitude, qui se traduisent en controverses scientifiques à propos de la systématique.
Sur la base des restes fossiles, il semble toutefois bien établi qu’il y a environ 400 millions d’années, entre la fin du Siluronien et le début du Dévonien, les ancêtres des poissons osseux se sont engagés dans des parcours évolutifs qui se sont ensuite poursuivis selon trois radiations distinctes : les Palaeoniscidae, les Dipnoi et les Crossopterygii.

Certains les transportent, par exemple dans leur bouche ou accrochés à leur queue, comme ce Phyllopteryx taeniolatus © Rafi Amar
Il faut savoir que, si les Palaeoniscidae se sont éteints au début du Jurassique, les Dipnoi et les Crossopterygii ont connu un destin qui intéresse plus ou moins directement les racines de la radiation évolutive des Vertébrés et a abouti à la colonisation des milieux subaériens.
Classification
La classification des Osteichthyes est quelque peu incertaine et fait encore l’objet d’hypothèses variées, chacune basée sur des données objectives mais incomplètes, de sorte qu’aucune d’entre elles n’apparaît complètement satisfaisante. De surcroît, les indications partielles et donc préliminaires qui découlent des recherches biomoléculaires compliquent le panorama de la systématique des Osteichthyes. En effet, la classification proposée, toujours en cours d’élaboration, présente plusieurs points contradictoires avec la classification traditionnelle, qui est basée sur des caractéristiques morphologiques et physiologiques.

Les larves sont souvent très différentes de leurs parents, comme ce Leptocéphale d’une murène qui peut former en s’enroulant un cylindre gélatineux évoquant une méduse © Mickey Charteris
À cet égard, il convient de mentionner que certains experts estiment que les Brachiopterygii, considérés par d’autres comme une sous-classe distincte, devraient être inclus dans les Actinoptérygii où ils constitueraient un ordre distinct, celui des Polypteriformes.
Pour leur part, Dipnoi et Crossopterygii forment, aux yeux de certains experts, un groupe monophylétique et devraient donc être intégrés dans une classe distincte, celle des Sarcopterygii ou Coanoitti. D’autres chercheurs considèrent au contraire que ces Dipnoi et Crossopterygii composent un groupe clairement polyphylétique, donc non naturel, et les rattachent à deux sous-classes distinctes.
Ici, il semble préférable de suivre l’opinion de nombreux spécialistes, qui considèrent les Osteichthyes comme une classe de Poissons et la subdivisent en 4 groupes (taxons) auxquels on donne le rang de sous-classes : les Brachiopterygii, les Actinopterygii, les Dipnoi et les Crossopterygii.

Les Osteichthyes sont couramment ovovivipares ou de vivipares. Les jeunes à peine nés peuvent ressembler beaucoup à leurs parents, comme chez ce Hippocampus kuda © Giuseppe Mazza
Par conséquent, comme, morphologiquement et physiologiquement, les groupes ci-dessus sont clairement distincts les uns des autres, sont indiquées ci-dessous des informations essentielles sur leurs caractéristiques distinctives, indépendamment des différents points de vue sur la position systématique et les subdivisions des Osteichthyes. Il convient toutefois de ne pas oublier que la classe des Osteichthyes demeure aussi vaste que complexe, et que leur systématique est donc susceptible de faire débat et de se modifier au fil des études.
Sous-classe des BRACHIOPTERYGII
Appelés aussi polyptères ou Cladistia, ces animaux constituent un groupe très ancien d’Osteichthyes, apparu il y a environ 60 millions d’années au Crétacé de la fin de l’ère mésozoïque, auquel on attribue le statut de sous-classe.

La classification traditionnelle des Osteichthyes, parfois en décalage avec les indices biomoléculaires, fait l’objet d’hypothèses variées soutenues par des données objectives mais partielles. Ainsi, ce Polypterus est un Chondrostrei pour certains spécialistes, un Brachiopterygii pour d’autres experts, et un Dipnoi pour certains taxonomistes réputés © Joel Abroad
Aujourd’hui, ces poissons sont représentés par quelques espèces dulçaquicoles d’Afrique tropicale et subtropicale, comme les poissons serpentiformes du genre Polypterus et le Poisson roseau (Erpetoichthys).
Il faut encore préciser que l’ordre auquel ils appartiennent, celui des Polypteriformes, ici rattaché à la sous-classe des Brachiopterygii, est au contraire inclus par d’autres dans les Actinopterygii. Outre la collocation systématique, le nom des Brachiopterygii rappelle la caractéristique de ses représentants de présenter des nageoires courtes et régulières, dotées d’une musculature propre.
Par ailleurs, la dénomination Polypteriformes provient de la morphologie particulière de la nageoire dorsale, divisée en de nombreuses petites pinnules, chacune soutenue par un rayon dur et quelques rayons mous. Le corps de ces poissons est allongé, parfois très élancé, un peu comme celui des anguilles, et peut atteindre une longueur totale de 1 m. La tête, petite et aplatie, est recouverte de plaques osseuses formant une sorte de casque protecteur.

De même pour Erpetoichthys calabaricus. On considère ici les Ostéichthyens comme une classe avec 4 sous-classes : Brachiopterygii, Actinopterygii, Dipnoi et Crossopterygii © Giuseppe Mazza
Le squelette de la tête conserve une structure très primitive en partie cartilagineuse, avec un nombre limité d’ossifications. Le reste du corps des Polypteriformes est recouvert d’une robuste cuirasse composée d’écailles rhomboïdes de type ganoïde, articulées entre elles et disposées en files obliques. Les nageoires ventrales, lorsqu’elles sont présentes, occupent une position abdominale. La nageoire anale est peu développée et la queue est diphycerque , symétrique et terminée en pointe.
Les Brachiopterygii sont dotés d’une vessie gazeuse double et asymétrique, située sous l’intestin. Le lobe droit de la vessie s’étend jusqu’à l’anus, le lobe gauche jusqu’à l’estomac. En relation avec sa fonction d’organe respiratoire accessoire aidant les branchies, les parois internes de la vessie natatoire sont légèrement plissées dans le sens de la longueur et tapissées de cellules pavimenteuses ciliées. Les Brachiopterygii sont dotés de spiracles fonctionnels et d’une valve intestinale en spirale. Ces poissons sont actuellement représentés par un peu plus d’une douzaine d’espèces, relevant toutes de l’ordre des Polypteriformes. On les trouve dans les eaux intérieures du continent africain.

Polypterus endlicherii. Les Brachiopterygii comptent un peu plus d’une douzaine d’espèces qui vivent dans les eaux intérieures du continent africain © Giuseppe Mazza
L’ordre comprend lui-même une seule famille, celle des Polypteridae, divisée en deux genres : Polypterus, avec neuf espèces connues sous le nom générique de Bichir, et Erpetoichthys (anciennement Calamoichthys), avec deux espèces.
Ces poissons vivent dans les rivières et les lacs côtiers où ils apprécient les eaux peu profondes à fond sablonneux ou vaseux. Cachés sur le fond pendant la journée, ils deviennent particulièrement actifs la nuit. Outre la nage, ils sont capables de se déplacer sur le fond grâce à leurs nageoires pectorales et ventrales dont ils se servent comme de véritables pattes.
Prédateurs voraces, ils se nourrissent de petits poissons, de vers, de mollusques, d’amphibiens et de leurs larves. À l’arrivée de la saison sèche, ils peuvent se retrouver piégés dans des mares avec un peu d’eau boueuse ; ces poissons s’enfouissent alors et restent en état de vie dormante jusqu’à l’arrivée des nouvelles pluies. Ils surmontent ainsi des conditions hostiles et inhabituelles pour un poisson grâce à leur vessie natatoire, qui fonctionne comme un organe respiratoire apte à utiliser l’oxygène atmosphérique.

Protopterus annectens utilise un poumon primitif pour respirer de l’air, enfoui dans le lit boueux des rivières asséchées, lors d’une létargie qui peut durer jusqu’à 4 ans © Gőtehal
En période de reproduction, on a observé que les adultes de ces poissons quittent les lieux fréquentés pendant la saison sèche et se rendent dans des zones inondées où, après l’accouplement, les femelles pondent de très petits œufs colorés. Les œufs fécondés donnent naissance à des larves au corps doré avec des rayures noires longitudinales, une nageoire dorsale continue et des branchies externes ressemblant vaguement à celles des Dipnoi et de certains amphibiens Urodeli.
Parmi les espèces les plus connues, on trouve le Bichir du Nil (Polypterus bichir Lacepéde, 1803), présent dans les eaux du Nil et des grands fleuves et lacs d’Afrique, le Bichir d’Endlicher ou Bichir sellé (Polypterus endlicheri Heckel, 1847) et le Bichir du Congo (Polypterus ornatipinnis Boulenger, 1902), que l’on trouve dans la partie occidentale de l’Afrique. Le Poisson roseau ou Poisson corde (Erpetoichthys calabaricus Smith, 1865) se rencontre dans les eaux lentes et riches en végétation aquatique de la partie inférieure du Niger et du Cameroun.
Sous-classe des ACTINOPTERYGII

Carassius auratus. Les Actinopterygii se sont développés dans les eaux douces du Dévonien avant d’envahir les mers, donnant naissance à la quasi-totalité des Osteichthyes © Giuseppe Mazza
Il s’agit d’un groupe (sous-classe ou classe selon les opinions) auquel sont rattachés presque tous les Osteichthyes. Ce sont des poissons osseux sans choane, c’est-à-dire sans communication entre les sacs olfactifs et la cavité buccale. Généralement, les nageoires paires sont soutenues par des rayons disposés en éventail, d’où le nom commun de Poissons à nageoires rayonnées.
Il faut remarquer d’emblée que les nageoires des Actinopterygii ne présentent pas dans leur squelette l’organisation structurelle de base nécessaire à leur transformation en membres des Tétrapodes terrestres, comme on le suppose parfois.
Animaux d’origine très ancienne, les Actinopterygii ont laissé des restes fossiles témoignant de leur présence dès le Dévonien, entre 400 et 350 millions d’années. Au Carbonifère (360-285 millions d’années), entre le Dévonien et le Permien, les Actinopterygii, venus des milieux dulcicoles où ils étaient très communs, ont commencé à envahir les mers, constituant le groupe de poissons le plus nombreux et le plus florissant.

Caractérisés par leurs nageoires rayonnées, les Actinopterygii acceptent toutes les eaux et toutes les températures jusqu’à 2 °C comme la Morue du Groenland (Gadus ogac) © Adam Maire
Actuellement, les représentants des Actinopterygii se rencontrent toujours dans une grande variété de milieux, dulcicoles et même marins.
Adaptés à des environnements extrêmes, ces poissons peuvent supporter de grandes variations de température, depuis un peu moins de 2° jusqu’à près de 40˚C, des niveaux de pH allant de 4 à 10, et des niveaux d’oxygène dissous allant de l’absence à la saturation.
Certaines espèces vivent dans des sources des déserts (“pupfishes”), d’autres dans des points d’eau éphémères, d’autres encore dans des lacs et des cours d’eau de haute altitude ; des espèces Actinopterygii se retrouvent dans des grottes souterraines (poissons cavernicoles), certaines espèces y vivant d’ailleurs exclusivement.
D’autres espèces encore peuplent les eaux des océans, où elles peuvent atteindre des profondeurs allant jusqu’à 7 000 m, comme les baudroies des eaux profondes (Oneirodidae, de l’ordre des Lophiiformes).

Et le Saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha) bondit dans les cascades des cours d’eau du Canada © sfreeman7
Certaines espèces vivent dans les eaux froides des mers polaires, comme la Morue du Groenland (Gadus ogac Richardson, 1836) et le Saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha Walbaum, 1792), Salmonidae marins et d’eau douce.
Aujourd’hui, les Actinopterygii regroupent environ 25 000 espèces, soit la très grande majorité de l’ensemble des Poissons et environ la moitié de l’ensemble des vertébrés vivants. Même pour ce groupe, auquel sont rattachés la grande majorité des Osteichthyes et tous les Poissons, tant par le nombre d’espèces qu’il comprend que par le nombre d’ordres en lesquels il se subdivise, il existe des divergences systématiques significatives.
Nous garderons à l’esprit la classification traditionnelle qui, sur la base de caractéristiques morphologiques, physiologiques et écologiques, divise les Actinopterygii en Chondrostei, Holostei et Teleostei, considérés comme des infraclasses.

Lophius piscatorius peut descendre jusqu’à environ 2000 m, mais les baudroies d’eau profonde atteignent jusqu’à 7000 m © Pietro Formis
Force est de constater qu’il n’est pas aisé d’identifier les relations phylétiques entre ces trois lignées évolutives d’Actinopterygii. Ces imprécisions systématiques sont également illustrées par le fait que certains experts préfèrent ranger les Holostei et les Teleostei dans une sous-classe distincte, celle des Néopterygii. Par ailleurs, la classification moderne appuyée sur des outils d’investigation biomoléculaires, encore en construction, n’est de ce fait pas encore vraiment décisive et présente des contradictions avec la classification traditionnelle.
Infraclasse des Chondrostei
Naguère classé parmi les Poissons cartilagineux (Chondrichthyes), avec lesquels ils partagent une certaine similitude morphologique et structurelle, ce groupe de poissons est aujourd’hui considéré comme une infraclasse des Actinopterygii.
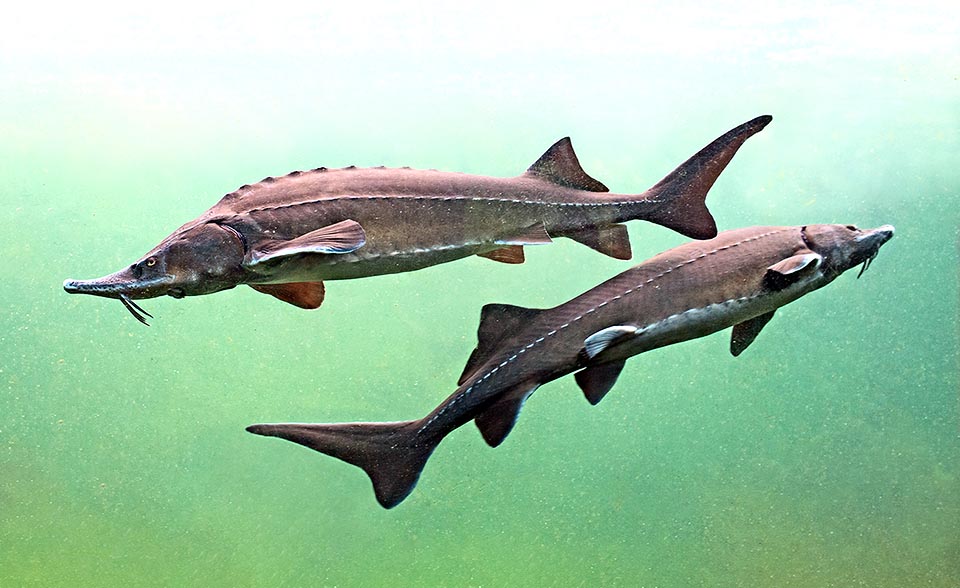
Selon la classification morphologique traditionnelle, en attendant les études moléculaires, les Chondrostei regroupent une trentaine d’espèces dont les esturgeons © Giuseppe Mazza
Il regroupe des espèces dont le squelette présente un certain degré d’ossification, mais qui conserve de nombreuses parties entièrement cartilagineuses, d’où le nom de Chondrostei.
Autrefois, il étaient également rattaché aux requins (Chondrichthyes Selachimorpha), auxquels ces poissons ressemblent principalement par la forme et la structure de la mâchoire, dépourvue d’os, et par la présence d’une paire de spiracles.
À l’exception des esturgeons, les Chondrostei n’ont pas d’écailles.
Les Chondrostei regroupent une trentaine d’espèces, communément appelées Esturgeons (Acipenseridae) et Poissons-spatules (Polyodontidae), classés dans l’ordre des Acipenseriformes.

S’y ajoutent les poissons spatules, créatures insolites comme Polyodon spathula © Giuseppe Mazza
Certaines classifications incluent également parmi les Chondrostei les Bichir (Polypterus) et les Calamattidae (Erpetoichthys), de l’ordre des Polypteriformes, que nous incluons dans la sous-classe des Brachiopterygii.
En vérité, la systématique des Chondrostei, en tant que groupe paraphylétique, c’est-à-dire qui n’inclut pas tous les descendants d’un ancêtre commun, reste discutée.
Infraclasse des Holostei
Les Holostei sont considérés comme une infraclasse des Chondrostei. En grande partie éteints, ils sont aujourd’hui représentés par des espèces caractérisées par un squelette partiellement ossifié et une bouche armée d’une forte dentition.

Les Holostei, ici Amia calva, regroupent des espèces largement éteintes dont le squelette est partiellement ossifié et la dentition solide © Phil’s 1stPix
Ils sont dotés d’une paire de spiracles, réduits à l’état de structures vestigiales et sans ouverture vers l’extérieur.
Il y a quelques années encore, on pensait que les Holostéens formaient un clade unitaire, mais des études cytogénétiques ont conduit certains experts à considérer aujourd’hui qu’il s’agit d’un groupe paraphylétique.
Deux ordres sont actuellement inclus dans les Holostei, les Amiiformes et les Lepisosteiformes.
Les Amiiformes, apparus au Trias moyen (il y a environ 244 millions d’années), se caractérisent par un squelette peu ossifié et essentiellement cartilagineux. Ils ne sont aujourd’hui représentés que par l’espèce Amia calva Linnaeus (1766), qui vit dans les eaux des rivières de la partie orientale de l’Amérique du Nord.
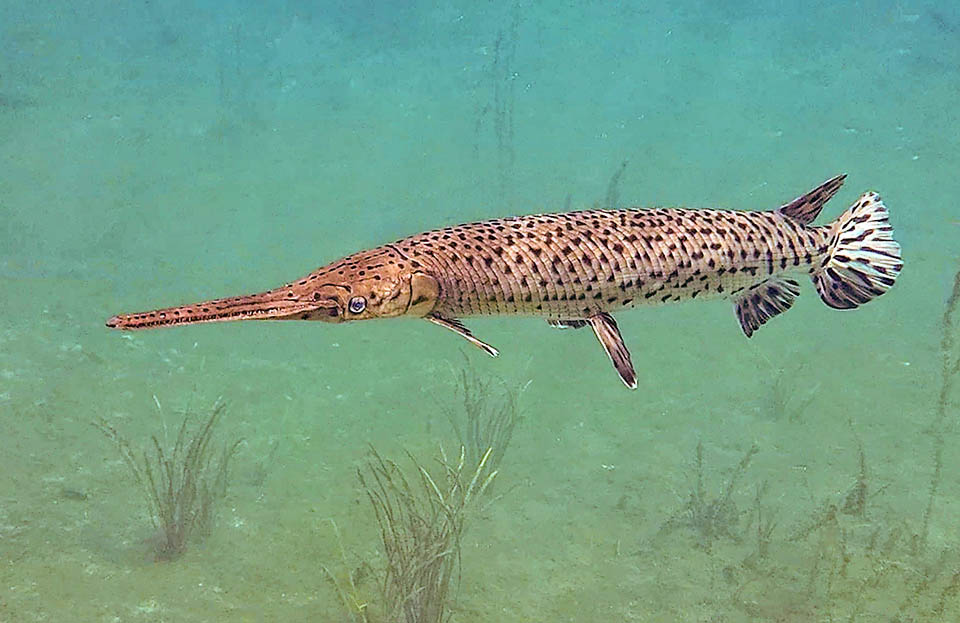
Lepisosteus osseus, fréquent dans l’est des Etats-Unis, appartient à la même infraclasse. Il ressemble de profil à un brochet mais est beaucoup plus vorace © smmcdonald
Les espèces de l’ordre des Lepisosteiformes, considéré comme plus archaïque que celui des Amiiformes, se rencontrent en eaux douces, saumâtres et parfois marines d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des îles des Caraïbes.
Les Lepisosteiformes comprennent une douzaine d’espèces regroupées en deux genres, Atroctestus (Rafinesque, 1820) d’Amérique centrale, et Lepisosteus (Linnaeus, 1758) des Grands Lacs d’Amérique du Nord.
On les appelle couramment brochets crocodiles, en raison de leur museau long et fin, et parfois aussi, improprement, poissons brochets, à cause de leur ressemblance avec le vrai Brochet, poisson de l’ordre des Esociformes (Actinopterygii).
Infraclasse des Teleostei

Les Teleostei reviennent de loin ! Nés au début du Trias, ils ont profité de la grande extinction de masse Trias-Jurassique pour s’adapter et comptent 20 000 espèces © www.davidfleetham.com
Ces poissons considérés comme des poissons osseux modernes composent le groupe le plus nombreux, non seulement parmi les Actinopterygii mais aussi parmi tous les Poissons. L’histoire des Teleostei commence au Trias (il y a 250 à 200 millions d’années), période d’apparition de leurs ancêtres.
Leur développement est lié à la disparition de presque tous les autres Actinopterygii lors de la grande extinction de masse qui s’est produite au cours de la période Trias-Jurassique (il y a environ 200-145 millions d’années), alors que ceux-ci connaissaient une remarquable radiation adaptative. La réussite des Teleostei s’est concrétisée par la différenciation de plus de 20 000 espèces connues à ce jour, au sein de plus de 400 familles, elles-mêmes réparties en un peu plus de 40 ordres.
Compte tenu de la considérable richesse des Teleostei, nous nous limiterons ici aux ordres les plus représentatifs, en renvoyant le lecteur, pour plus de détails, aux pages de l’encyclopédie consacrées aux espèces.
Ordre des Atheriniformes

Les bancs d’Atherina boyeri, Atheriniformes d’environ 10 cm, sont courants sur la côte atlantique européenne, de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne © Maurizio Pasi
Cet ordre comprend des espèces d’apparence variée qui se distinguent les unes des autres principalement par des caractères du squelette. En général, ces poissons possèdent deux nageoires dorsales, l’antérieure pouvant être perdue secondairement. La ligne latérale est vestigiale ou totalement absente.
Répandu dans pratiquement toutes les mers, sauf dans les eaux libres, abyssales et polaires, cet ordre regroupe des espèces marines côtières, y compris saumâtres, et des espèces dulçaquicoles. Parmi ses espèces les plus connues, on trouve l’Athérine (Atherina boyeri Risso 1810), petit poisson d’une dizaine de centimètres de long, habituel des eaux méditerranéennes.

Une espèce analogue, Atherina hepsetus, ne fréquente que la Méditerranée et la mer Noire © Frédéric Andre
Appelée aussi le Joël, cette espèce, outre certaines parties des côtes atlantiques de l’Europe, se rencontre dans en mer Noire et mer Caspienne, où deux sous-espèces semblent s’être différenciées, respectivement Atherina boyery pontica (Eichwald, 1831) et Atherina boyery caspia (Eichwald, 1831). Une autre espèce du genre est le Sauclet (Atherina hepsetus Linnaeus, 1758), petit poisson propre à la Méditerranée et à la mer Noire.
Ordre des Beloniformes
Autrefois inclus parmi les Cyprinidontiformes, les Beloniformes sont aujourd’hui considérés comme un ordre à part entière. Largement répandus dans les eaux salées et douces, ces poissons comptent près de 300 espèces reconnues pour leurs nombreuses utilisations commerciales et provenant principalement d’Asie tropicale, réparties dans les familles des Adrianichthyidae, des Belonidae, des Exocoetidae, des Hemiramphidae et des Zenarchopteridae.

Belone belone avec sa proie. Appelée Orphie, ce Beloniformes de près de 1 m de long fréquente la Méditerranée, l’Atlantique Est et la mer Noire © Sarah Faulwette
La plupart d’entre eux sont de petits poissons d’un peu moins de 10 cm, ce qui les rend compatibles à la vie en aquarium.
En Méditerranée ne sont signalées que six espèces de Beloniformes aux apparences cependant très inhabituelles, comme les Aiguillettes (Belonidae) et les exocets, ou poissons volants (Exocoetidae).
Les Aiguillettes, aussi appelées Aiguilles ou Orphies, présentent un corps de forme caractéristique, très mince et allongé. Les mâchoires de ces poissons, également très développées et allongées, forment une sorte de bec corné muni d’un grand nombre de dents.
Les aiguillettes appartiennent à la famille des Belonidae, présentes dans les mers tempérées et tropicales, et dont voici les quatre espèces présentes en Méditerranée.

Ce Tylosurus choram de la mer Rouge s’abandonne aux soins d’un Labre, qui élimine du maraudeur relaxé les parasites de la peau et la nourriture restée entre les dents © Rafi Amar
L’Orphie (Belone belone Linnaeus, 1761) est un poisson d’un peu moins d’un mètre de long, pouvant peser environ 1 kg. La livrée est sobre, gris argenté, plus foncée sur le dos et blanchâtre sur les parties ventrales. Le squelette présente une coloration bleu-vert caractéristique due à la présence de bilirubine. Présent en Méditerranée, dans l’Atlantique Est et la mer Noire.
L’aire de répartition de l’Aiguille (Belone svetovidovi Collette & Parin, 1970) couvre la Méditerranée et certains secteurs du nord-est de l’Atlantique. Facilement confondu avec l’Orphie, ce poisson se différencie principalement par le nombre de ses dents.
Tylosurus acus (Lacèpede, 1803), la Grande orphie, est une espèce principalement tropicale qui fréquente les eaux de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée, où elle n’est pas très répandue.
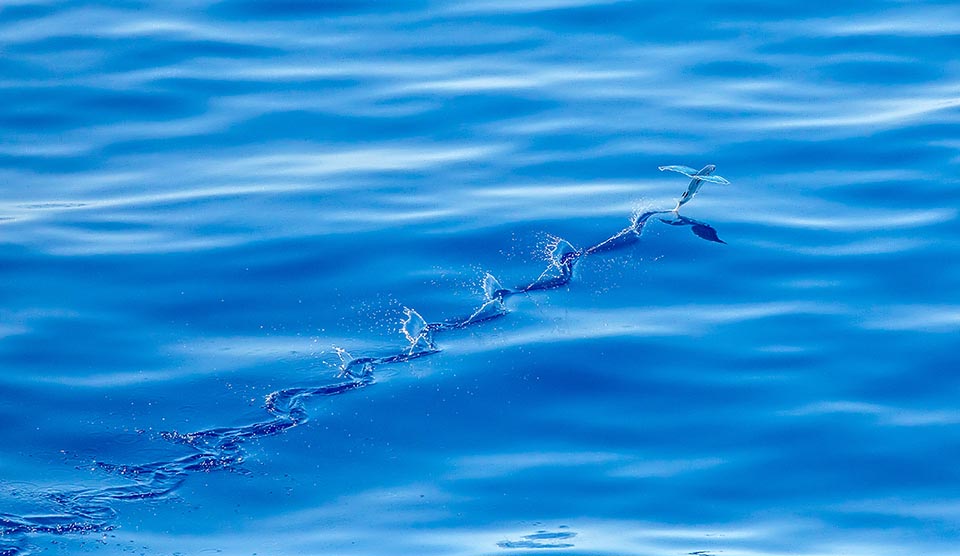
Les Beloniformes, famille des Exocoetidae, comprennent également les Poissons volants, capables de voler hors de l’eau pendant 20 à 30 secondes © Harold Moses
D’apparence très proche de l’Orphie, cette espèce s’en distingue néanmoins facilement par sa taille plus importante allant jusqu’à 1,5 m, par ses dents plus développées et par sa nageoire caudale dont le lobe inférieur est plus long que le lobe supérieur.
L’Orphie de la mer Rouge (Tylosurus choram Rüppell, 1837) est une espèce dont la physionomie générale est très proche de celle de l’Orphie et en particulier de la Grande orphie. Elle vit dans la plupart des mers tempérées et chaudes et parfois dans les rivières. Très commune dans la partie la plus occidentale de l’océan Indien, dans la Mer Rouge et dans le golfe d’Oman, on la trouve aussi en Méditerranée, où elle s’est introduite par le canal de Suez (espèce lessepsienne).
Une autre famille, celle des Exocoetidae, regroupe les espèces de Beloniformes communément appelés Poissons volants.

L’Exocet méditerranéen (Cheilopogon heterurus), qui plane en déployant ses pectorales et ses ventrales, se distingue par la présence de 4 ailes © Harold Moses
Le nom commun de ces animaux fait référence au développement considérable de leurs nageoires pectorales, qui atteignent généralement la nageoire dorsale et parfois aussi la nageoire caudale.
Cette particularité confère aux Exocoetidae la capacité, unique parmi les poissons, d’effectuer des vols de courte durée (20 à 30 secondes) au-dessus de la surface de l’eau, leurs grandes nageoires pectorales leur servant d’ailes.
Les yeux sont gros et la bouche, petite et tournée vers le haut, est équipée de dents de petite taille. Selon les espèces, les nageoires ventrales peuvent être plus ou moins développées, mais toujours beaucoup moins que les nageoires pectorales. En fonction du développement des nageoires ventrales, on distingue les poissons volants à quatre ailes et les poissons volants à deux ailes.

Cheilopogon abei, présent dans l’Indo-Pacifique de la côte africaine aux îles Salomon, étonne par la couleur vive de ses grandes nageoires pectorales © Максим Стефанович
La nageoire caudale est fortement fourchue, le lobe inférieur étant plus long que le lobe supérieur. Le corps des Exocoetidae, dont la longueur est généralement comprise entre 20 et 40 cm, est effilé et recouvert d’écailles grandes et dures. La livrée des adultes est uniformément bleue sur les parties dorsales et blanc argenté sur les parties ventrales. Les juvéniles, quant à eux, peuvent présenter des couleurs variées et de longs barbillons ou des nageoires pectorales aux motifs brillants.
Ces poissons singuliers vivent dans tous les océans, avec une plus grande fréquence et une plus grande abondance dans les eaux chaudes. En Méditerranée, l’Exocet méditerranéen et l’Exocet aile noire sont communs, tandis que le Poisson volant et l’Exocet bouledogue se rencontrent plus ou moins rarement.
L’Exocet méditerranéen (Cheilopogon heterurus Rafinesque 1810) est présent dans les eaux chaudes et tempérées de l’est de l’océan Atlantique et de l’ouest de la Méditerranée, où il est l’espèce la plus courante de la famille.

Hirundichthys speculiger, commun sous les tropiques, a bondi hors de l’eau et échappé à Sula leucogaster, qui le poursuivait. Mais l’oiseau a émergé et chasse d’en haut © Benoît Segerer
Mesurant généralement un peu moins de quarante centimètres, l’Exocet méditerranéen est doté de quatre ailes comprenant des nageoires pectorales très allongées, au-delà de la nageoire dorsale, ainsi que des nageoires ventrales très reculées. Une autre espèce du genre est Cheilopogon abei Parin, 1996, Exocoetidae des eaux du Pacifique occidental et de l’océan Indien.
L’Exocet aile noire (Hirundichthys rondeletii Valenciennes, 1847), long d’environ 20 cm, est assez commun dans les eaux italiennes. L’espèce se caractérise par sa forme à quatre ailes et possède, en plus des nageoires pectorales, des nageoires ventrales très allongées et reculées. Largement diffusé dans l’océan Atlantique et en Méditerranée occidentale, cette espèce migre en été vers le Nord de l’Adriatique, et regagne, pour l’hiver, des zones plus orientales de la Méditerranée.

Dans le golfe du Mexique, ce Hirundichthys volador de l’Atlantique tropical est lui aussi chassé par la même espèce en émersion © Jon McIntyre
Au même genre appartiennent le Poisson volant à ailes noires (Hirundichthys volador Jordan, 1884), du nord-ouest de l’océan Atlantique, et le Poisson volant à ailes bordées (Hirundichthys speculiger Valenciennes, 1847), présent dans les eaux circumtropicales.
Le Poisson volant (Exocoetus volitans Linneo, 1758) est une espèce très commune de la ceinture tropicale. Pendant la saison chaude, il peut pénétrer en Méditerranée occidentale et même, bien que rarement, atteindre l’Adriatique. Mesurant généralement jusqu’à 20 cm de long, ce poisson volant se caractérise par des nageoires ventrales très courtes et insérées à l’avant (forme à deux ailes).
L’Exocet bouledogue (Exocoetus obtusirostris Günther, 1866) est très proche, par son aspect et ses habitudes, du Poisson volant, dont il se distingue facilement par son museau sensiblement plus court.
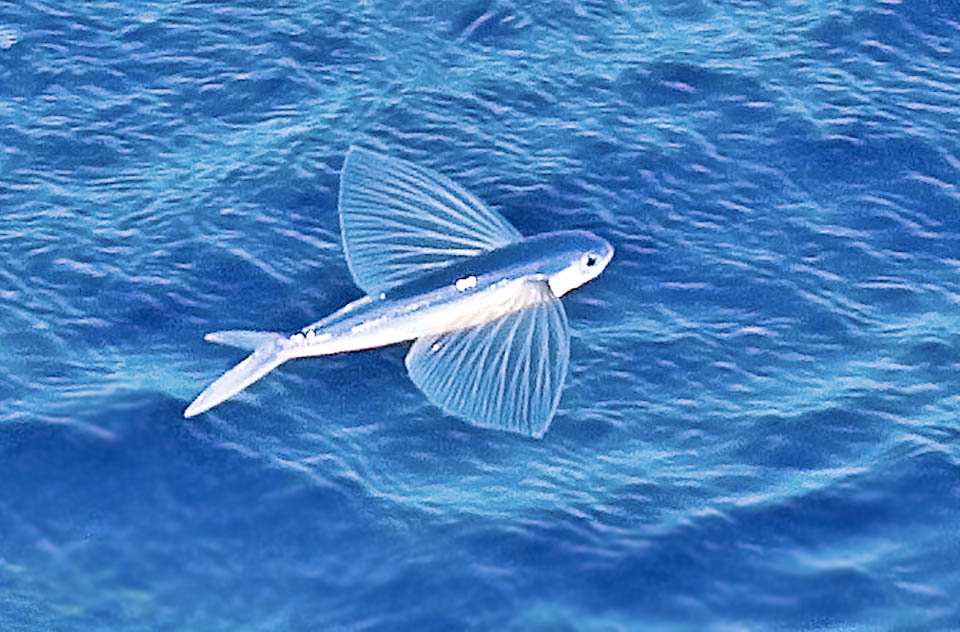
Exocoetus volitans est une espèce très commune des eaux de la ceinture tropicale et peut pénétrer en Méditerranée occidentale pendant l’été © Graham Ekins
On retrouve aussi parfois cette espèce dans les eaux méditerranéennes. Parmi les nombreuses autres espèces de l’ordre des Beloniformes, on peut citer les suivantes.
Les Poissons des rizières et les Médakas, de la famille des Adrianichthyidae, anciennement inclus dans l’ordre des Cyprinodontiformes, vivent dans les eaux douces et saumâtres d’une région allant de l’Inde à l’archipel malaisien et au Japon. Le nom de Poisson des rizières donné à certaines espèces vient du fait qu’on les trouve aussi dans les rizières. Ce poisson plutôt petit mesure de 1,6 à 16 cm selon l’espèce. La petite taille combinée à la facilité d’élevage et aux couleurs de la livrée rendent ces petits poissons particulièrement populaires auprès des aquariophiles.
Le Médaka (Oryzias latipes Temminck & Schlegel, 1846) est une espèce euryhaline des rizières, ainsi que des eaux stagnantes des étangs, des marais et des flaques d’eau de mer.

Le Médaka (Oryzias latipes) relève lui aussi des Beloniformes. Long d’environ 3,6 cm, c’est une espèce euryhaline qui fréquente les rizières, les marais et les mares © hhkaaks
De petite taille, mesurant jusqu’à 3,6 cm de long, la couleur naturelle du corps du Médaka varie du blanc crème au jaunâtre. Appréciés pour leur variété de couleurs et de formes, ainsi que pour leur facilité d’élevage et de reproduction, les médakas sont des poissons d’aquarium populaires depuis plusieurs siècles. Considéré aussi, sur un tout autre plan, comme très important dans le domaine scientifique, le Médaka a été le premier poisson dont le génome a été complètement séquencé et a également été génétiquement modifié.
A un autre genre appartient Adrianichthys kruyti M.Weber, 1913, dont la mâchoire supérieure est protubérante. Il s’agit d’une espèce de poisson de rizière originaire du lac Poso, dans le centre de Sulawesi, en Indonésie, en risque critique d’extinction.
Ordre des Beryciformes

L’ordre des Beryciformes regroupe des poissons marins aux mœurs nocturnes vivant surtout en eaux profondes. Beryx decadactylus descend jusqu’à environ 1 000 m © Ken Sulak
Les poissons de cet ordre fréquentent les mers du monde entier. Poissons nocturnes, ils vivent principalement en eau profonde, mais certains, comme les espèces d’Holocentridae, fréquentent également les eaux peu profondes.
Deux espèces sont signalées en mer Méditerranée, le Béryx commun et l’Holocentre rouge.
Le Béryx commun (Beryx decadactylus Cuvier, 1829) est un poisson au corps rouge, de forme grossièrement rhomboïdale et d’une longueur pouvant atteindre 60 cm. La bouche est plutôt grande et protractile, les yeux sont remarquablement grands. La nageoire dorsale est plus haute dans sa partie antérieure. La nageoire anale a la même forme, mais elle est plus longue. Les nageoires dorsale et anale sont soutenues par quelques rayons spiniformes peu marqués. De mœurs pélagiques à plus de 1000 m de profondeur, le Béryx commun se rencontre dans toutes les mers, y compris la Méditerranée, où il est cependant assez rare.

Fréquent dans l’Indo-Pacifique tropicale, Sargocentron rubrum est une espèce dite lessepsienne : il a atteint la Méditerranée depuis la Mer Rouge, via le canal de Suez © Giuseppe Mazza
L’Holocentre rouge, ou Marignan rouget (Sargocentron rubrum Forsskål, 1775), habite les zones tropicales de l’océan Indien et de l’océan Pacifique. On en trouve aussi quelques populations limitées en Méditerranée, dans les eaux de laquelle il est arrivé après une migration lessepsienne, c’est-à-dire en provenance de la mer Rouge via le canal de Suez.
Mesurant normalement une trentaine de centimètres de long, ce poisson présente un corps ovale, un museau pointu et une forte épine sur chaque opercule branchial. Les yeux sont gros et la livrée est voyante, rouge vif avec des bandes blanches longitudinales sur les côtés et des nageoires marginées de blanc. Il vit dans une grande variété de milieux, y compris dans les eaux portuaires peu profondes.
Ordre des Cyprinodontiformes

Les Cyprinodontiformes sont des poissons généralement dulcicoles avec un fréquent dimorphisme sexuel. Ils ont une bouche petite, de gros yeux et une seule nageoire dorsale, arrondie et symétrique à la nageoire anale. La plupart des espèces sont petites ou moyennes : ici, une femelle d’Heterandria formosa mesurant seulement 8 mm © Giuseppe Mazza
On considère ici un ordre d’Actinopterygii, qui comprend principalement des espèces dulçaquicoles caractérisées par une bouche petite, des yeux gros et des nageoires soutenues par des rayons. La nageoire dorsale est unique et la nageoire caudale est symétrique et arrondie. La plupart des espèces sont de taille petite à moyenne, allant de 8 mm pour le Poisson-moustique (Heterandria formosa Girad, 1859) à 34 cm pour le Poisson à quatre yeux du Pacifique (Anableps dowei T.N. Gill, 1861).
Le corps des Cyprinodontiformes est généralement plutôt allongé, la mâchoire inférieure plus ou moins développée.
Le dimorphisme sexuel est fréquent, les mâles présentant une nageoire dorsale plus développée et une livrée plus voyante que les femelles.
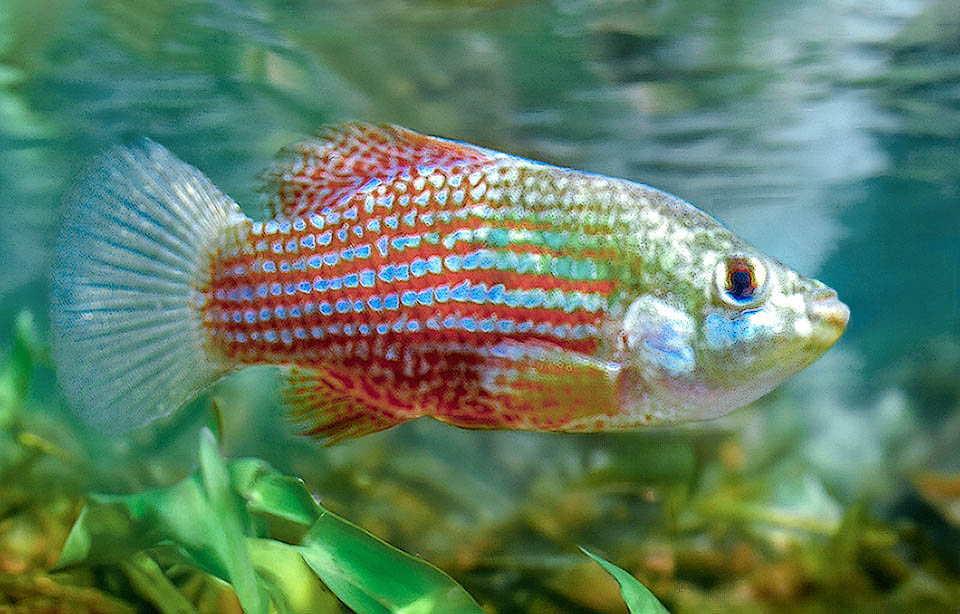
Le Killi de Floride, Jordanella floridae, atteint 6-7 cm de long et est fréquent dans les eaux douces et saumâtres d’Amérique centrale © Giuseppe Mazza
Avec plus d’un millier d’espèces, cet ordre est largement répandu dans les mers et les eaux douces de la quasi-totalité du globe.
Plusieurs espèces de cet ordre, de taille généralement comprise entre 2,5 et 5 cm, sont rassemblées sous le nom générique de killies, signifiant poisson de petits ruisseaux ; elles se rencontrent surtout dans les eaux douces ou saumâtres du continent américain, depuis le Canada jusqu’à l’Argentine. Certaines espèces de killies vivent en Afrique, en Asie et quelques-unes sont connues dans l’Europe méditerranéenne.
En raison de leurs caractéristiques physiologiques et écologiques particulières, ainsi que de leur belle livrée, plusieurs espèces de killies font l’objet de commerce et d’élevage dans le monde entier. Parmi eux, signalons ceux appelés pupfish par les anglo-saxons : ces petits poissons se caractérisent par leur capacité à survivre dans des milieux isolés et dans des conditions extrêmes.

De taille équivalente, voici, en Méditerranée, Aphanius fasciatus, présent lui aussi dans les eaux saumâtres et seule espèce du genre autochtone en Italie © Rolando Criniti
Les pupfish sont de petits killies dont la plupart des espèces présentent un dimorphisme sexuel marqué en termes de forme du corps et de coloration de la livrée. En général, la livrée des mâles est sensiblement plus voyante que celle des femelles. Répandus surtout dans les eaux douces et saumâtres du continent américain, les pupfish se nourrissent d’insectes, d’algues et de matières végétales en décomposition.
Certains ont un régime alimentaire particulièrement riche en algues, comme le fameux Killi de Floride (Jordanella floridae Goode & Bean, 1879), petit poisson de 6 à 7 cm de long, largement diffusé en Amérique centrale où on le trouve en eaux douces ou saumâtres.
Très différente est la répartition d’Aphanius, genre de killies répandu dans les eaux saumâtres et douces de la bande côtière méditerranéenne ; plusieurs espèces s’y sont différenciées, fortement menacées d’extinction en raison de l’anthropisation de l’habitat.

On attribue au genre Anableps plusieurs espèces nettement plus grandes, mesurant généralement de 25 à 30 cm © Pierre-Yves Le Bail
L’Aphanius de Corse (Aphanius fasciatus Valenciennes, 1821) est un poisson des eaux saumâtres, y compris des marais salants. Avec une distribution circum-méditerranéenne, c’est la seule espèce du genre supposée indigène en Italie.
D’autres espèces du genre sont Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernandez-Delgado, 2002, endémique des eaux côtières du sud-ouest de l’Espagne, et l’Aphanius d’Espagne Aphanius iberus Valenciennes, 1846, endémique de la bande côtière méditerranéenne de la péninsule ibérique.
Enfin, il convient de mentionner le Killi géant d’Anatolie (Aphanius anatoliae Leidenfrost, 1912) qui, avec ses 15 cm de long, est le géant du genre. Cette espèce est signalée dans les bassins des lacs Tuz et Beysehir en Anatolie.

Ce sont des poissons fréquents dans les eaux douces et saumâtres d’Amérique centrale et du Sud. Ici nage un petit groupe d’Anableps microlepis © Mario Barroso
Toujours au sein des Cyprinodontiformes, on trouve les Quatre yeux du genre Anableps, appelés ainsi en raison de la conformation très particulière et intéressante de leur appareil visuel.
En effet, les yeux de ces poissons extraordinaires, gros et saillants, sont divisés horizontalement en deux lobes par une membrane de tissu épithélial.
La cornée et la pupille sont également divisées en deux parties et possèdent deux rétines. Le cristallin, quant à lui, est unique.
Ainsi, en se déplaçant avec les yeux maintenus à la surface de l’eau, les Quatre yeux sont capables de voir simultanément ce qui se passe au-dessus de la surface et sous l’eau, ce qui facilite la prédation des insectes dont ils se nourrissent.

Le Quatre-yeux à grandes écailles (Anableps anableps), souvent invité des aquariums, est courant du Venezuela au nord du Brésil © Giuseppe Mazza
Plusieurs espèces sont attribuées au genre Anableps ; elles mesurent 25 à 30 cm de long et, à l’état sauvage, vivent dans les eaux saumâtres et douces de la côte septentrionale de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.
Outre le Quatre-yeux à grandes écailles (Anableps anableps Linnaeus, 1758), le plus connu et le plus recherché du genre en aquariophilie, mentionnons également le Quatre-yeux à petites écailles (Anableps microlepis Müller et Troschell, 1844) et le Quatre-yeux du Pacifique (Anableps dowei T. N. Gill, 1861).
Les rivulines africaines sont de petits killies de la famille des Nothobranchiidae, qui compte plus de 250 espèces du continent africain au sud du Sahara.

Le Quatre-yeux à grandes écailles (Anableps anableps), souvent invité des aquariums, est courant du Venezuela au nord du Brésil © Giuseppe Mazza
Les rivulines colonisent les eaux douces et saumâtres et sont, avec les Dipnoi, les seuls poissons à vivre dans les environnements extrêmes des vasières des plaines africaines. D’une longueur typique de 5 cm, les rivulines africaines présentent des couleurs vives et certaines espèces, comme Nothobranchius guentheri de Zanzibar, sont prisées comme poissons d’aquarium.
Ordre des Gasterosteiformes
Cet ordre contient des poissons Actinopterygii répandus principalement dans les milieux marins côtiers tropicaux et tempérés et, dans une moindre mesure, dans les eaux douces. L’ordre regroupe des espèces de petite taille, au corps généralement mince et allongé et au pédoncule caudal quelque peu effilé.

L’Epinoche (Gasterosteus aculeatus) vit dans les eaux douces, marines et saumâtres de l’hémisphère nord © Riccardo Novaga
L’apparence des Gasterosteiformes est très diversifiée. Le corps est parfois plat et large avec une bouche ventrale surplombée d’un long rostre et de nageoires pectorales très larges (Pegasidae). De nombreuses espèces possèdent des plaques osseuses sous-cutanées latérales. Les nageoires sont soutenues par des rayons mous et des rayons spiniformes robustes, dont le nombre est d’ailleurs un bon caractère taxonomique. Quelques espèces sont dépourvues de nageoires ventrales, d’écailles et même de plaques osseuses (Hypoptychidae).
En Europe, l’ordre n’est présent qu’avec quelques espèces de Gasterosteidae connues sous le nom commun d’Épinoche, dont une seule espèce (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758) atteint la Méditerranée occidentale. Une autre espèce est l’Épinoche de mer (Spinachia spinachia Linnaeus, 1758), petit poisson d’environ 20 cm de long répandu dans l’Atlantique Nord-Est mais absent des eaux méditerranéennes.
Ordre des Mugiliformes

L’ordre des Mugiliformes compte une seule famille d’environ 80 espèces, les Mugilidae. Mugil cephalus, commun en Europe, remonte les rivières et tolère les eaux polluées © Francesco Caroli
Il s’agit d’un ordre de poissons Actinopterygii comptant quelque 80 espèces communément appelées mulets ou muges. Les Mugiliformes sont des poissons au corps allongé, dont la longueur varie d’une vingtaine de centimètres à plus de 120 cm, et dont la bouche est pourvue de dents généralement de petite taille, ou n’en a pas du tout.
Les nageoires pectorales et ventrales sont bien développées. Il y a deux nageoires dorsales, la première soutenue par quatre rayons épineux et la seconde constituée de nombreux rayons minces et souples. La nageoire caudale présente deux lobes bien développés. La ligne latérale est à peine perceptible.
Les Mugiliformes regroupent l’unique famille des Mugilidae, dont relèvent quelque 80 espèces de mulets, principalement réparties dans les eaux marines côtières tropicales et tempérées. Certaines espèces fréquentent les estuaires et remontent également les cours d’eau douce.

Mugil curema est également très commun le long des côtes tropicales de l’Afrique de l’Ouest et en Amérique © Allison & Carlos Estape
Le Mulet cabot (Mugil cephalus Linnaeus, 1758), également appelé Poisson queue bleue ou Muge à grosse tête, est un poisson au corps effilé, recouvert de grandes écailles, gris bleuté sur le dos, blanchâtre avec des stries foncées sur les parties ventrales.
Typiquement, la tête est large et massive, la bouche équipée de dents petites et les yeux recouverts d’une paupière transparente. Les deux nageoires dorsales sont séparées et situées au milieu du dos, les nageoires ventrales étant situées un peu en arrière des nageoires pectorales. La taille peut atteindre jusqu’à 1 m de long et le poids peut dépasser 4 kg.
Le Mulet cabot est une espèce euryhaline : il tolère de fortes variations de salinité et vit ainsi dans les eaux marines, saumâtres et douces. On le trouve aussi dans les eaux polluées et couramment dans les ports. Son aire de répartition est très vaste et englobe toutes les eaux de la ceinture tropicale et tempérée. Dans les mers européennes, il remonte jusqu’au nord du golfe de Gascogne.
Ordre des Perciformes

La perche (Perca fluviatilis) a donné son nom à l’ordre des Perciformes, qui compte plus de 7000 espèces © Giuseppe Mazza
Avec plus de 7000 espèces, les Perciformes forment l’un des groupes les plus nombreux de tous les vertébrés et leur systématique suscite encore des discussions.
Le nom de Perciformes dérive de celui de la Perche (Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758), certainement l’une des espèces les plus connues de cet ordre. Cette espèce mesure en moyenne 20 cm mais peut atteindre jusqu’à 60 cm. Les parties dorsales du corps sont verdâtres et ornées de 5 à 8 bandes verticales sombres, les bandes centrales étant blanchâtres.
Les nageoires sont généralement de couleur vive variant du rouge à l’orange, à l’exception des nageoires pectorales qui sont jaunâtres. Il s’agit d’un poisson d’eau douce, mais résolument euryhalin, que l’on peut trouver en haute mer dans les zones les plus septentrionales, ainsi que dans les estuaires et les lagunes saumâtres.

Le vorace Sandre (Sander lucioperca), originaire du centre-nord de l’Europe et d’Asie occidentale, a été accidentellement introduit en Europe centro-méridionale © Patrick Doll
De lointaine origine eurasienne, la Perche est largement répandue pratiquement dans toute l’Europe, suite aussi à des introductions anthropiques dès 1700.
Le Sandre doré européen, Sandre ou Perche-brochet, (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) est un poisson qui, chez les vieux sujets, peut atteindre et même dépasser 1 mètre de long et le poids de 15 kilogrammes. La livrée du Sandre est brun verdâtre sur la tête, les parties dorsales et les flancs, plus claire sur les parties ventrales. Quelques bandes noires verticales descendent du dos vers les flancs. Les nageoires présentent une couleur verdâtre mouchetée de noir.
Originaire du centre-nord de l’Europe et d’Asie occidentale, le Sandre est un prédateur vorace dont l’introduction dans les eaux de l’Europe centro-méridionale au début des années 1800 a probablement posé de graves problèmes de compétition avec la faune piscicole locale, avec notamment la disparition de formes endémiques.

Gymnocephalus cernua, introduite pour la pêche sportive dans diverses régions d’Europe et d’Amérique, a causé de graves dommages à la faune piscicole locale © Ewout Knoester
Gymnocephalus cernua (Linné, 1758), la Grémille, est une espèce qui affectionne les fonds sableux et graveleux des eaux douces d’Europe et d’Asie, depuis la France jusqu’à la Sibérie.
Ce poisson peut mesurer jusqu’à 25 cm et peser jusqu’à 400 g. La tête est grosse et le corps est équipé d’une grande nageoire dorsale munie d’épines érectiles. La livrée de la Grémille présente généralement une coloration jaune brunâtre avec des reflets métalliques sur le dos, pâle sur le ventre. Ses habitudes sont principalement nocturnes. Souvent introduite pour la pêche sportive dans diverses régions d’Europe et d’Amérique, cette espèce est elle aussi responsable de dégâts considérables sur la faune piscicole locale.
Une autre espèce bien connue de Perciformes est sans aucun doute le Poisson combattant, ou Combattant du Siam (Betta splendens Regan, 1910). Il s’agit d’un petit poisson d’eau douce originaire du bassin hydrographique du Mékong, dans le sud-est de l’Asie, où il vit dans les eaux stagnantes, lacustres et fluviales à faible courant.

Souvent présents dans les aquariums domestiques, les poissons combattants mâles (Betta splendens), très territoriaux, ne tolèrent pas la présence d’autres mâles © Giuseppe Mazza
Il est également assez fréquent dans les rizières et dans les eaux peu oxygénées. L’espèce a par ailleurs été introduite au cours des dernières décennies du XXe siècle en Amérique du Sud et en Indonésie.
Betta splendens présente un corps robuste et effilé ; les mâles atteignent une taille de 6 à 8 cm, les femelles sont légèrement plus trapues et plus petites. La bouche s’ouvre en position supérieure. Comme toutes les espèces de sa famille (celle des Osphronemidae), le Poisson combattant possède une structure respiratoire labyrinthique qui lui permet de respirer l’oxygène directement à partir de l’atmosphère. Pour cette raison, ces poissons sont aussi appelés Labyrinthidae.
Le Poisson combattant présente un dimorphisme sexuel qui, outre la taille du corps et des nageoires, plus développée chez les mâles, se manifeste aussi dans la livrée. Chez les individus sauvages, la livrée des mâles est bleu verdâtre à reflets métalliques sur le corps, la tête est noire et les nageoires sont rouges à reflets métalliques bleu-vert.

Les femelles, en revanche, sont les bienvenues et se reproduisent même dans de petits aquariums, créant pour les œufs un nid de bulles flottant caractéristique © Giuseppe Mazza
En revanche, le corps de la femelle est brun à reflets métalliques et est orné de deux bandes longitudinales brun-rouge. Le phénotype original est cependant moins facile à trouver dans le commerce, au contraire des variétés multicolores aux longues nageoires en forme de voile, issues d’une longue et patiente sélection.
Le Poisson combattant mâle manifeste un sens territorial prononcé et se montre particulièrement agressif envers les autres mâles, surtout pendant la saison de reproduction. La renommée mondiale de cette espèce est liée à cette agressivité des mâles, exploitée par les Thaïlandais qui organisent des paris lucratifs sur l’issue des combats entre deux mâles, d’où le nom commun de Poisson combattant.
Cette pratique est à l’origine d’un processus de sélection traditionnel et minutieux visant à obtenir des individus plus forts et plus agressifs, à la livrée flamboyante, pour les présenter à l’occasion des combats et les commercialiser sur le marché de l’aquariophilie.

À la même famille que le poisson combattant appartient aussi le Poisson Paradis (Macropodus opercularis), très apprécié des aquariophiles pour sa splendide livrée © Peter Voigt
Dans la même famille des Osphronemidae, une autre espèce assez répandue dans les aquariums est le Poisson Paradis (Macropodus opercularis Linnaeus, 1758) : il habite divers milieux d’eau douce en Asie du Sud-Est et colonise également les forêts et les plaines inondées pendant la saison des moussons.
Le corps du Poisson Paradis est plutôt trapu et petit, mesurant 6 à 7 cm de long. Il présente typiquement de longues nageoires dorsale et anale à l’extrémité filamenteuse. La queue est allongée et fourchue avec deux très larges lobes. Les nageoires pectorales sont ovales et les nageoires ventrales sont pointues.
La livrée des mâles est brillante, surtout en période de reproduction. La tête et les parties dorsales sont gris-vert et les flancs rouge vif avec des lignes bleu électrique. Les parties ventrales sont violettes. Les nageoires sont également de couleur pourpre à rouge, à l’exception des pectorales qui sont transparentes. La queue est rougeâtre et ornée d’une ponctuation bleue. Les femelles ont des couleurs moins vives et sont généralement brun clair à reflets bleu rougeâtre.

Avec ses grands yeux, le Poisson-sanglier (Capros aper), de Méditerranée et d’une grande partie de l’Atlantique, peut chasser dans l’obscurité à 100-500 m de profondeur © G. Mazza
Le Poisson-sanglier (Capros aper Linnaeus, 1758) est un Perciforme caractérisé par de grands yeux et un museau particulièrement allongé et pointu à bouche protractile. La taille diffère entre les deux sexes, les mâles ne dépassant généralement pas 15 cm, les femelles, plus grandes, pouvant atteindre 25 cm de long.
Il n’y a qu’une seule nageoire dorsale avec une incision évidente ; les nageoires ventrales sont assez grandes, les pectorales sont petites et les ventrales sont plutôt développées. La queue est large et plate. Le corps est de couleur rouge-orange, parfois orné de bandes plus foncées. Pendant la période de reproduction, la livrée est affectée d’un dimorphisme sexuel évident.
L’aire de répartition de ce poisson couvre une grande partie de l’Atlantique et toute la Méditerranée ; dans ces eaux, on le trouve de préférence sur des fonds vaseux, à des profondeurs variant entre 100 et 500 mètres.
Ordre des Bleniiformes

L’ordre des Bleniiformes réunit un millier d’espèces naguère intégrées parmi les Perciformes. Se déplaçant sur les fonds marins, ces poissons n’ont généralement pas besoin de vessie natatoire. Leurs écailles sont souvent remplacées par un mucus protecteur. Long de quelques centimètres, Aidablennius sphynx est le plus petit d’entre eux © Eleftherios Katsillis
Autrefois compris dans les Perciformes avec le statut de sous-ordre, ces poissons, avec d’autres groupes mineurs, ont récemment été élevés au statut systématique d’ordre indépendant.
Il s’agit de poissons au corps généralement allongé, souvent en forme d’anguille. Leur taille varie de quelques centimètres pour la Blennie sphinx (Aidablennius sphinx Valenciennes, 1836) à près de 2,40 m pour le Poisson loup à ocelles (Anarrhichthys ocellatus Ayres, 1855) du Pacifique Nord. Chez la plupart des espèces de l’ordre, le corps est dépourvu d’écailles et recouvert d’une épaisse couche de mucus, caractéristique d’où l’ordre tire son nom et qui vaut à de nombreux représentants d’être désignés, en italien, par le nom générique de Bavose (baveux).
En règle générale, les nageoires dorsale et anale des Bleniiformes sont bien développées ; chez certaines espèces, les nageoires dorsale, anale et caudale sont fusionnées en une frange continue. En revanche, les nageoires ventrales sont réduites et déplacées vers l’avant des nageoires pectorales, voire absentes. De nombreux représentants de l’ordre portent sur la tête, au-dessus des yeux, des tentacules simples ou ramifiés et, chez certaines espèces, une crête céphalique en forme d’écusson. La forme et le développement des tentacules et de l’écusson diffèrent chez les deux sexes.

Le Poisson loup à ocelles (Anarrhichthys ocellatus) du Pacifique Nord est le géant de l’ordre avec près de 2,40 m de taille © Neil McDaniel
La bouche est large et généralement armée de dents implantées dans les mâchoires dont les éléments latéraux sont plus développés et caniniformes. La livrée est souvent vive et variée. Une caractéristique intéressante de la plupart des espèces est la rapidité avec laquelle elles peuvent changer de livrée, changeant de couleur en fonction de la situation environnementale et traduisant des attitudes variées comme la menace, la soumission, le camouflage, la défense de la progéniture.
En période de reproduction, les femelles sont attirées par les mâles dans leur refuge, où a lieu l’accouplement. Les femelles pondent généralement des œufs fécondés à l’intérieur de l’abri du mâle, constitué d’une anfractuosités dans un rocher ou d’une coquille vide. À son tour, le mâle surveille et défend la couvée et la ventile à l’aide de ses nageoires pectorales jusqu’à ce que tous les œufs aient éclos. Il naît généralement des formes larvaires qui acquièrent plus tard les caractéristiques des adultes.
Essentiellement zoophages, la plupart des Bleniiformes se nourrissent principalement de polychètes, de crustacés et de mollusques, avec également de petites quantités de végétaux. Ils n’ont pas d’estomac et leur canal intestinal est plutôt court. Peu d’espèces sont purement phytophages.

La plus grande famille est celle des Blenniidae, comme Alticus saliens, qu’on trouve à des profondeurs considérables comme dans les bassins récifaux ou hors de l’eau © Frank Deschandol
Les Bleniiformes comptent environ un millier d’espèces regroupées en 15 familles pour certaines desquelles les connaissances sont extrêmement limitées. La famille la plus nombreuse et la plus variée est certainement celle des Blenniidae, qui compte des espèces adaptées aux conditions de vie les plus diverses. Les représentants de cette famille se rencontrent aussi bien à des profondeurs considérables que dans des eaux moins profondes ou même dans des bassins récifaux. Certaines espèces habitent les fonds rocheux et même les milieux marécageux à mangroves. La grande majorité des Blenniidae sont des espèces typiquement benthiques, dépourvues de vessie natatoire. Plusieurs espèces, en particulier celles du genre Blennius, sont capables d’aller hors de l’eau.
La répartition des Bleniiformes est très vaste, la plupart des espèces vivant dans les eaux tempérées et tropicales, saumâtres et douces. Un groupe limité d’espèces est restreint aux eaux du continent australien, d’autres vivent principalement dans les eaux de la région arctique, et d’autres encore sont limitées au Pacifique Nord. Un bon nombre de représentants de l’ordre appartenant au genre Blennius sont cantonnés à la Méditerranée.
Ordre des Pleuronectiformes

Les Pleuronectiformes sont des poissons plats, tel Pleuronectes platessa, avec une face aveugle et dépigmentée pour être la plupart du temps posée sur le fond marin © Giuseppe Mazza
Appelés également Heterosomata, les poissons Actinopterygii de cet ordre sont caractérisés par la particularité de présenter à l’état adulte un corps asymétrique où les deux yeux sont positionnés du même côté, dit côté oculaire, l’autre côté en étant dépourvu (côté aveugle).
Chez certaines espèces, le côté oculaire est le côté droit, chez d’autres, c’est l’inverse. En raison de cette conformation physique particulière, ces poissons acquièrent également un type de nage particulier appelé nage unilatérale, d’où leur nom scientifique de Pleuronectiformes.
Le corps de ces poissons est très aplati dans le sens latéral, légèrement convexe du côté oculaire et plat du côté aveugle, d’où, aussi, leur nom commun de Poissons plats ; ce côté est également dépigmenté.

Les yeux, normaux chez les jeunes, migrent en grandissant du côté pigmenté et les adultes nagent donc en biais © Giuseppe Mazza
Le corps des adultes de Pleuronectiformes est recouvert d’écailles cycloïdes, cténoïdes ou tuberculées ; les deux nageoires pectorales sont de longueurs différentes, celle du côté oculaire est plus développée ; les nageoires ventrales sont réduites ou absentes et les impaires sont symétriques.
Les adultes sont presque toujours dépourvus de vessie natatoire.
La taille des adultes varie de 2 cm à plus de 2,5 m chez le Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus Linnaeus, 1758).
La livrée est mimétique, généralement de couleur brunâtre marbrée de taches sombres et claires du côté oculaire, uniformément blanchâtre du côté aveugle.

Ainsi, à l’état larvaire, ce Symphurus nigrescens avait des yeux de chaque côté, comme tous les poissons © Stergios Vasilis
Avec plus de 700 espèces, les Pleuronectiformes sont pratiquement cosmopolites. Ils vivent principalement sur les fonds vaseux ou sablonneux des eaux côtières, où ils passent la majeure partie de leur vie couchés sur leur côté aveugle, confondus dans leur environnement.
Souvent, ils s’enfouissent dans le sable ou la boue du fond, laissant dépasser leurs yeux pour repérer les proies en approche ou pour échapper à un éventuel prédateur.
Certaines espèces, comme Hippoglossus hippoglossus, se rencontrent jusqu’à 2 000 m de profondeur, d’autres vivent dans des sources thermales en eau profonde, d’autres encore dans des milieux d’eau douce.
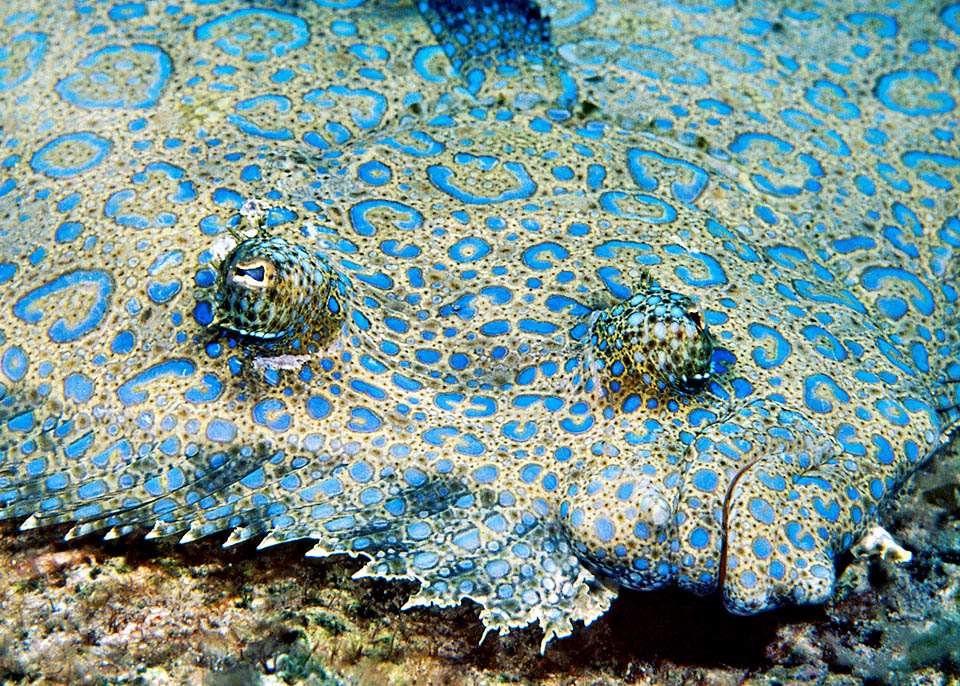
Détail de Bothus mancus, Pleuronectiforme de l’Indo-Pacifique tropical. Les yeux se meuvent indépendamment et voient dans toutes les directions. Ils stimulent les chromatophores pour changer de motifs et de couleurs ; quand ils sont absents ou recouverts de sable, le poisson ne peut pas interagir et reste uniformément sombre © Keoki Stender
De nombreuses espèces ont une grande importance économique et font l’objet d’une pêche intensive pour l’alimentation humaine.
Excellentes nageuses, plusieurs espèces de cet ordre effectuent des migrations saisonnières, passant des eaux peu profondes des zones d’alimentation estivales aux zones de frai plus profondes en période hivernale. Les femelles y pondent des œufs pélagiques d’où éclosent des larves à symétrie bilatérale qui nagent comme les autres poissons.
La différence morphologique entre les larves et les adultes est telle que les premières ont longtemps été considérées comme un groupe taxonomique à part entière. Plus tard, les larves mènent une vie benthique et subissent un processus de transformation avec la migration d’un œil vers le côté opposé de la tête et l’acquisition d’un mode de nage latéralisé.

Le Flet commun (Platichthys flesus) est une espèce euryhaline qui peut remonter les cours d’eau sur de longues distances. Les yeux sont situés sur le côté droit du corps © Hans Hillewaert
Voici, parmi les nombreuses espèces de l’ordre, celles qui sont les plus connues.
Le Flet d’Europe, ou Flet commun (Platichthys flesus Linnaeus, 1758), est un Pleuronectiforme d’environ 30-40 cm de long, dont les yeux sont situés sur le côté droit du corps. L’espèce se caractérise par la présence d’une série de tubercules épineux, formés par de plus grandes écailles, situés à la base des nageoires dorsale, anale et pectorale.
Cette espèce euryhaline fréquente les fonds vaseux et sablonneux et les lagunes, et peut remonter les fleuves loin de l’embouchure. Son aire de répartition est discontinue et comprend l’Atlantique Nord jusqu’au détroit de Gibraltar, le nord de la mer Adriatique et les mers Noire et d’Azov.

La Limande sole (Microstomus kitt), originaire des mers d’Europe du Nord, aime les eaux peu profondes à fond caillouteux, mais peut descendre jusqu’à 200 m environ © Hans Hillewaert
Le Carrelet ou Plie commune (Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758) peut atteindre 70 cm. Ses deux yeux sont situés sur le côté droit de son corps. Une crête osseuse est généralement présente derrière les yeux. Du côté oculaire, la livrée est vert brunâtre, agrémentée de taches punctiformes orange. La face aveugle est blanc nacré.
Il s’agit d’une espèce marine vivant sur les fonds vaseux et sablonneux du plateau continental européen, à des profondeurs, habituellement entre 10 et 200 m, dans la mer de Barents et dans l’est de l’océan Atlantique, de l’Islande à la péninsule ibérique.
La Limande sole (Microstomus kitt Walbaum, 1792) est originaire des mers d’Europe du Nord où elle affectionne les eaux peu profondes aux fonds caillouteux, jusqu’à des profondeurs de plus de 200 m.

Le Flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), géant de l’ordre avec près de 3 m de long et un poids d’environ 230 kg, peut descendre jusqu’à 2000 m © Vsevolod Rudyi
L’origine du nom commun est incertaine et n’a en tout cas rien à voir avec la couleur ou même le goût du citron. Il n’est pas certain que le nom “limanda” fasse référence à la texture dure de la peau, semblable à une lime, ou au fait que ce poisson se trouve fréquemment dans la vase des fonds marins. La Limande sole atteint plus de 60 cm. La surface oculaire, qui est le côté droit, prend une coloration brun-rougeâtre, tachetée de rose, d’orange, de vert et de jaune. Le côté aveugle du poisson est blanchâtre. La bouche est généralement très petite et le pédoncule caudal est large.
Plusieurs espèces de Pleuronectiformes sont désignées sous le nom générique de Flétan. Il s’agit en particulier du Flétan de l’Atlantique ou Flétan blanc (Hippoglossus hippoglossus Linnaeus, 1758), du Flétan du Pacifique (Hippoglossus stenolepis Schmidt, 1904), et du Flétan noir ou Flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides Walbaum, 1792).
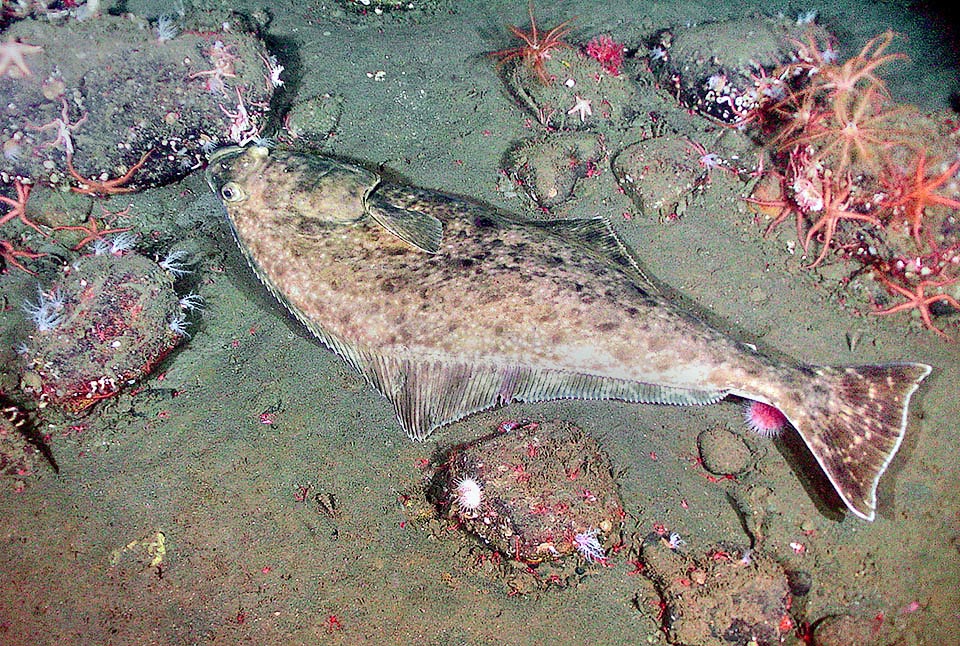
Hippoglossus stenolepis, que l’on trouve également dans les eaux du Pacifique Nord, est un grand Pleuronectiformes dont la taille peut dépasser 2,5 m © Jackson W.F. Chu
Poisson démersal, le Flétan de l’Atlantique vit près des fonds marins ; en hiver, une fois commencée la reproduction, il se concentre sur les bords du plateau continental, sur les fonds desquels il fraye entre 180 et 500 m environ.
Puissant nageur, le Flétan de l’Atlantique est capable de migrer sur de longues distances et d’effectuer des déplacements saisonniers récurrents entre les zones estivales d’alimentation, plus superficielles, et les zones hivernales de reproduction, plus profondes.
La dénomination ”flétan” se réfère notamment aux espèces des genres Hippoglossus et Reinhardtius, dont voici quelques exemples.
Hippoglossus hippoglossus est un poisson plat typique à grande bouche et aux deux yeux situés sur le côté droit. La livrée est gris brunâtre du côté oculaire et blanchâtre du côté aveugle.

Beaucoup plus petite, Limanda limanda, fréquente dans les mers du nord de l’Europe, dépasse rarement 40 cm et 1 kg © Pat Webster @underwaterpat
Ce poisson fait partie des géants de l’ordre et atteint ou dépasse 2,5 m de long pour un poids d’environ 230 kg.
De mœurs benthiques, la distribution du Flétan de l’Atlantique s’étend à l’Atlantique Nord et à l’Océan Arctique où on peut le trouver aussi bien sur des fonds mobiles qu’en eaux libres à une grande distance du fond.
Le Flétan du Pacifique (Hippoglossus stenolepis Schmidt, 1904) est un poisson qui peut atteindre ou dépasser 2,5 mètres et qui vit dans les eaux du Pacifique Nord. En général, les jeunes vivent dans les eaux côtières ; à mesure qu’ils grandissent, ils se déplacent vers des eaux plus profondes, en bordure du plateau continental. C’est un prédateur d’invertébrés, en particulier de crabes, de calmars et de palourdes, ainsi que d’autres poissons.

La Sole commune (Solea solea) que l’on trouve dans les mêmes eaux, mais aussi en Méditerranée et en mer Noire, a une taille similaire © Frédéric ANDRE
Le Flétan noir ou Flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides Walbaum, 1792) est assez semblable au Flétan de l’Atlantique dont il se distingue par un corps plus plat et une bouche encore plus grande. La livrée est brun très foncé sur la face oculaire et également sur la face aveugle.
La Limande commune (Limanda limanda, Linnaeus 1758) est un petit poisson de 20 à 40 cm de long, pesant jusqu’à 1 kg, dont l’apparence est similaire à celle de la Plie d’Europe, et dont les deux yeux se situent normalement sur le côté droit du corps. Originaire des mers peu profondes de l’Europe du Nord, on le trouve dans les eaux côtières de l’Atlantique Nord-Est, du golfe de Gascogne à la mer du Nord et à la partie occidentale de la mer Baltique, où il vit de préférence sur des fonds sablonneux jusqu’à des profondeurs d’environ 100 mètres.
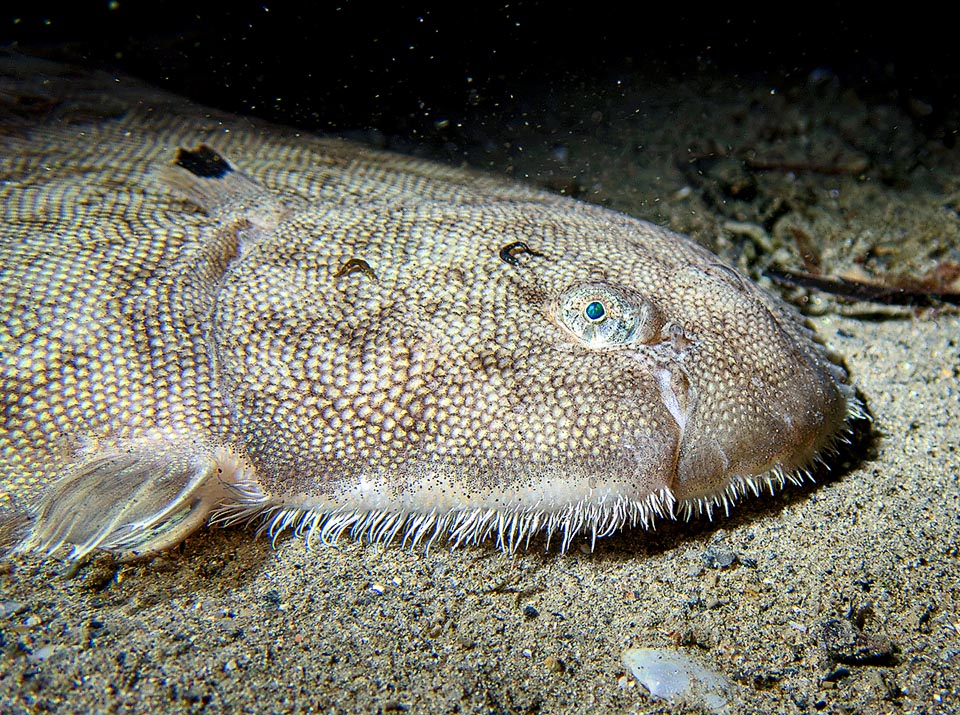
Elle vit sur des fonds sableux meubles jusqu’à 200 m de profondeur, ainsi que dans les lagunes et les eaux saumâtres des estuaires © Pierre Corbrion
La Sole commune, ou Sole franche (Solea solea Linnaeus, 1758), est un Pleuronectiformes qui mesure en moyenne environ 30 cm et peut, bien que rarement, atteindre 50 cm de long. Son museau est proéminent, sa mâchoire est saillante et ses deux yeux sont placés du côté droit (oculaire). La nageoire dorsale unique est plus longue que la nageoire anale ; toutes deux sont reliées par une membrane à la nageoire caudale, qui est petite et arrondie.
La livrée varie du beige au grisâtre parsemé de points sombres du côté oculaire, et est blanchâtre du côté aveugle. Très répandue dans le Nord-Est de l’Atlantique, la mer du Nord et la mer Baltique, la sole commune est également courante en Méditerranée et en mer Noire. Elle vit sur des fonds sableux mobiles à des profondeurs moyennes, couramment jusqu’à 200 m ; elle fréquente aussi les eaux saumâtres des estuaires et des lagunes. Prédateur nocturne, elle passe la journée enfouie dans le sable.

Microstomus pacificus, très similaire, se rencontre dans les eaux du Pacifique, depuis la mer de Béring jusqu’aux côtes de Basse-Californie © Gregory C Jensen
La Limande sole du Pacifique (Microstomus pacificus Lockinghton, 1879), également appelée “Dover Sole”, est assez semblable à la Sole commune. On la trouve dans les eaux allant de la mer de Béring à la basse Californie.
La Sole nue (Gymnachirus nudus Kaup, 1858) est un petit poisson d’environ 12-15 cm répandu dans les eaux de l’Atlantique ouest, depuis la côte du Mexique jusqu’au Rio Grande do Sul au Brésil.
On trouve cette espèce dans les eaux côtières sur des fonds vaseux et sablonneux, de 2 à quelque 130 m de profondeur.

Il y a aussi des poissons à l’aspect singulier chez les Pleuronectiformes, comme la sole nue (Gymnachirus nudus) qui vit entre le Mexique et le Brésil © Mickey Charteris
La Plagusie longue (Symphurus ligulatus Cocco, 1844) présente un corps allongé d’environ 10 cm de long, et une nageoire dorsale soutenue par plus d’une centaine de rayons. La livrée est brun-jaunâtre avec des taches brunâtres sur la face oculaire, blanchâtre sur la face aveugle.
On la trouve dans la ceinture tropicale et subtropicale de l’Est de l’Atlantique, et elle n’est pas rare non plus dans l’Ouest de la Méditerranée. Elle mène une vie benthique sur des fonds sablonneux ou vaseux entre 200 et 800 mètres de profondeur.
La Plagusie sombre (Symphurus nigrescens Rafinesque, 1810) ressemble beaucoup à la Plagusie longue, dont elle diffère cependant par un corps plus trapu d’un peu plus de 10 cm de long et un nombre moindre de rayons de la nageoire dorsale (moins de 90).

Le profil de la Langue joue noire (Symphurus plagiusa), abondant en Atlantique ouest et dans les eaux saumâtres, est également étonnant © johnwilliams
La livrée est brunâtre marbrée avec des taches claires et foncées irrégulièrement agencées. Les nageoires dorsale et anale sont fusionnées avec la nageoire caudale comme chez l’anguille. Il n’y a pas de nageoires pectorales. On trouve cette espèce dans les eaux chaudes de la ceinture tropicale de l’Atlantique Est ainsi qu’en Méditerranée, où elle est cependant assez rare.
La Langue joue noire (Symphurus plagiusa Linnaeus, 1766) est un Pleuronectiforme d’environ 20 cm ou un peu plus, caractérisé par une grande tache noirâtre sur l’opercule. Espèce démersale, on la trouve couramment dans l’Atlantique ouest où elle explore les fonds meubles des eaux côtières et saumâtres jusqu’à une profondeur d’environ 180 mètres.
Ordre des Scorpaeniformes

Les Scorpaeniformes regroupent plus de 300 espèces, la plupart marines ou saumâtres, mais aussi, comme ce Cottus gobio, des eaux douces froides à fort courant © Julien Renoult
On attribue à cet ordre plus de 300 espèces ; la plupart d’entre elles sont largement diffusées dans toutes les mers, y compris les mers polaires. Certaines espèces vivent dans les eaux saumâtres et douces, et d’autres dans les eaux douces froides à fort courant, comme le Chabot (Cottus gobio Linnaeus, 1758) et Cottus scaturigo, Jörg Freyhof et alii, 2005, dont la position taxinomique est incertaine.
La taille des Scorpaeniformes varie d’environ 4 cm pour la Limace de Méditerranée (Eutelichthys leptochirus Tortonese, 1959), espèce exclusive à la Méditerranée où elle est d’ailleurs très rare, à près de 80 cm pour le Cabezòn (Scorpaenichthys marmoratus Ayres, 1854), présent dans les eaux du Pacifique Nord-Est, de l’Alaska à la Californie.

Dit poisson-lion pour sa voracité, Rascasse volante ou Poisson-scorpion pour le venin de ses rayons dorsaux et l’élégance de ses nageoires, Pterois volitans vient des eaux tropicales de l’est de l’océan Indien et du Pacifique. Il a été introduit accidentellement en Floride, causant de gros dégâts aux espèces locales et caribéennes © G. Mazza
De nombreuses espèces sont pourvues d’épines venimeuses sur le corps et les nageoires. Ces poissons prédateurs vivent dans des environnements variés.
Beaucoup d’espèces habitent les eaux marines et saumâtres des océans de l’hémisphère boréal, surtout froids et même arctiques ; certaines sont abyssales, comme les Abyssocottidae, endémiques des eaux profondes du lac Baïkal, en Sibérie.
La mer Méditerranée accueille le rarissime Chabot de mer (Taurulus bubalis Euphrasen, 1786), petit poisson dont la taille avoisine une douzaine de centimètres, et la Limace de Méditerranée (Eutelichthys leptochirus Tortonese, 1959), petit poisson endémique des eaux méditerranéennes profondes, déjà mentionné.

On retrouve également les traits typiques de l’ordre chez ce Ptérois nain (Dendrochirus brachypterus), Scorpaeniformes dont le nom scientifique du genre vient du grec Dendron (arbre) et Cheiros (main), allusion aux pectorales ouvertes qui évoquent les anneaux de croissance concentriques caractéristiques d’un tronc d’arbre recépé © Giuseppe Mazza
Parmi les représentants les plus typiques de cet ordre figurent les espèces appelées de façon générique rascasse et poisson-scorpion.
La Rascasse volante (Pterois volitans Linnaeus, 1758), appelée aussi Poisson scorpion ou Poisson de feu, mesure généralement un peu moins de 40 cm.
Il se caractérise par une petite tête avec une large bouche et de grands yeux saillants ; deux petites excroissances sont implantées sur le menton et au-dessus des yeux. Le corps, incurvé dorsalement et aplati ventralement, se rétrécit en une longue queue large et arrondie.
Les premiers rayons des nageoires dorsale et anale sont des épines venimeuses qui se redressent en cas de danger.

Il en existe également une version jaune et noire, un véritable joyau de 15 cm à peine, pour lequel les aquariophiles sont prêts à payer n’importe quel prix © Ian Shaw, Reef Life Survey
Largement répandue dans l’océan Pacifique et la mer Rouge, la Rascasse volante vit sur des fonds pierreux, généralement jusqu’à 150 m de profondeur. Au siècle dernier, l’espèce a été introduite accidentellement dans l’océan Atlantique ; elle a récemment été signalée à plusieurs reprises dans les eaux méditerranéennes.
Le Ptérois nain (Dendrochirus brachypterus Cuvier, 1829) est un Scorpaeniformes marin dont la taille dépasse légèrement 15 cm.
Appelé aussi Poisson-dindon, ce poisson se caractérise par une sorte de petit tentacule au-dessus de chaque œil et d’appendices en forme de feuilles plus ou moins développées sur la tête et le long de la ligne latérale. La nageoire dorsale est munie d’épines venimeuses, d’où le nom générique de rascasse.

Scorpaena maderensis de l’Atlantique Est, commune à Madère mais aussi en Méditerranée est de taille similaire © Giuseppe Mazza
De mœurs nocturnes, il s’agit d’un prédateur de petits crustacés des océans Pacifique et Indien.
La Rascasse de Madère (Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833) est un petit Scorpaeniformes de mer, généralement de moins de 15 cm. Sa livrée peut varier du noir au rouge, mais elle est généralement marbrée de brun clair et de taches plus foncées.
Présente dans l’Atlantique oriental, où elle est très commune dans les eaux de Madère, d’où son nom spécifique, cette espèce se trouve aussi en Méditerranée. Elle vit dans les eaux côtières parmi la végétation dense des fonds compacts.
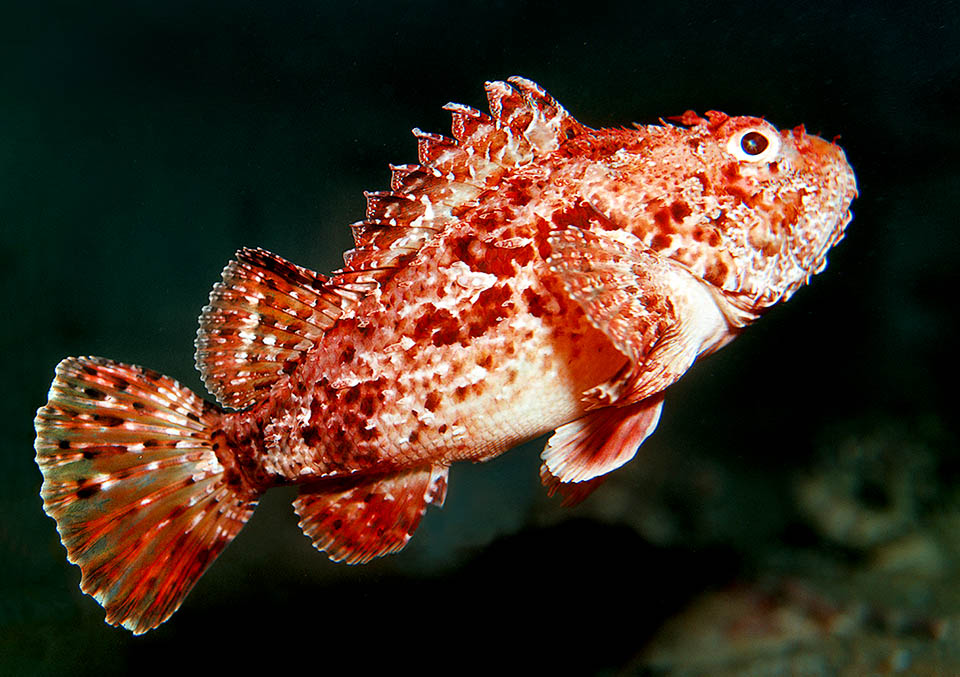
La Rascasse rouge (Scorpaena scrofa), avec une distribution comparable, est le géant du genre avec un record de 3 kg et 50 cm © Giuseppe Mazza
La Rascasse rouge (Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758) est l’une des plus grandes, avec une longueur pouvant atteindre 50 cm. Sa tête massive est munie d’épines et d’appendices charnus.
La livrée est généralement rouge vif panachée de sombre avec une tache noire sur la nageoire dorsale ; les spécimens jaunes, roses ou bruns se rencontrent plus rarement. La Rascasse rouge se trouve dans l’Atlantique oriental et la Méditerranée où elle vit sur des fonds durs ou coralligènes, de quelques mètres à environ 200 mètres de profondeur.
La Rascasse brune (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758), également appelée Rascasse porc ou Petite rascasse, est un poisson Scorpaeniformes qui, comme les autres espèces du genre, présente un corps trapu à tête massive ornée d’appendices charnus typiques et d’épines.

Image rare d’un Poisson-pierre (Synanceia verrucosa) en train de nager. Semblable à un rocher, c’est le représentant le plus redoutable et le plus venimeux de cet ordre © Frank Käck
Largement répartie dans l’Atlantique Est, la Méditerranée et la mer Noire, la Rascasse brune se rencontre principalement sur les fonds rocheux ou dans les herbiers de posidonies. Comme chez les autres membres de l’ordre, les épines des nageoires de ce poisson sont connectées à des glandes à venin.
Le plus dangereux des Scorpaeniformes reste cependant le Poisson-pierre (Synanceia verrucosa) des eaux peu profondes de la zone tropicale de l’Indo-Pacifique. Bien camouflé sur les fonds marins, il porte sur le dos 12 à 14 épines solides et cannelées, chacune reliée à la base à deux glandes à venin. Elles sont capables de percer la semelle d’une chaussure légère et injectent le venin le plus puissant du monde des poissons, mortel même pour l’homme. Sa composition est très proche de celle du cobra, et en cas de morsure, il faut agir immédiatement avec le sérum spécifique.
Ordre des Stephanoberyciformes
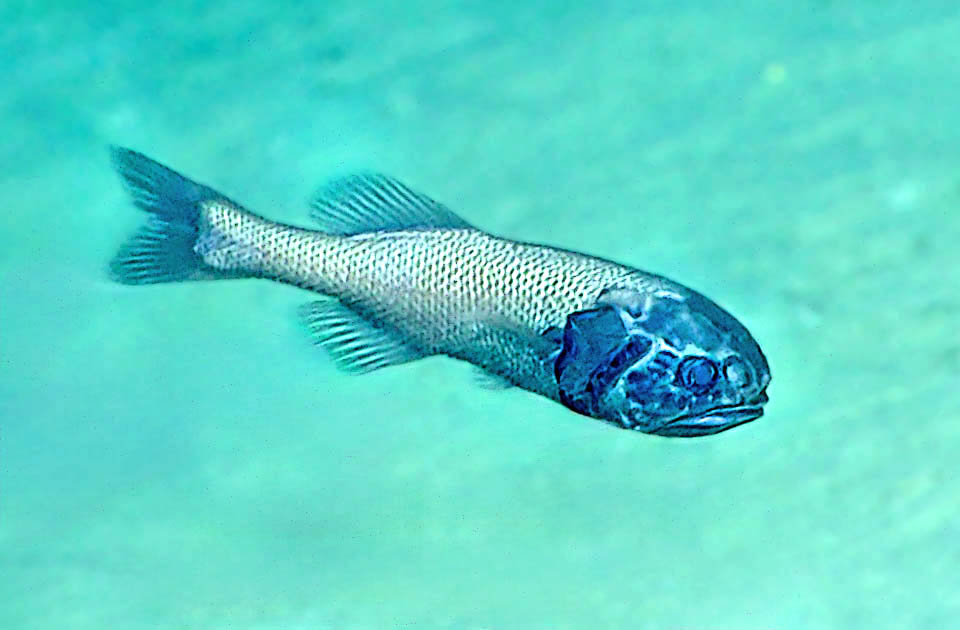
Stephanoberyx monae. Les Stephanoberyciformes sont rares et peu connus. Ils vivent jusqu’à près de 5 000 m de profondeur dans toutes les mers, sauf la Méditerranée – NOAA Okeanos Explorer Program
Cet ordre de poissons Actinoptérygiens regroupe une soixantaine d’espèces, qui se distinguent par le fait que leur tête, généralement large, est recouverte de crêtes osseuses et d’épines.
Les Stephanoberyciformes sont des poissons rares et mal connus qui vivent dans les profondeurs des mers du monde entier, à l’exception de la mer Méditerranée.
L’espèce type de cet ordre, Stephanoberyx monae Gill, 1883, s’appelle Pricklefish en anglais. Il s’agit d’un petit poisson qui vit dans les eaux de l’Atlantique à des profondeurs allant d’environ 900 m à près de 5 000 m.
Ordre des Synbranchiformes

L’Anguille de feu (Mastacembelus platysoma) vit dans le lac Tanganyika en Afrique. Son corps allongé présente une série d’épines dorsales et des narines tubulaires © Ad Konings
Cet ordre encore très discuté regroupe de nombreuses espèces d’eau douce et d’eau saumâtre dont le nom scientifique fait référence au fait que leurs ouvertures branchiales convergent en une seule ouverture ventrale. En raison de leur ressemblance avec les Anguilliformes, dont ils diffèrent par des nageoires soutenues par des rayons épineux, les Synbranchiformes sont souvent appelés anguilles épineuses.
Le corps de ces poissons est nu et peut atteindre 150 cm. Les nageoires dorsales sont continues, les nageoires pectorales et parfois les nageoires pelviennes sont absentes. Les Synbranchiformes n’ont pas de vessie natatoire et sont capables de vivre hors de l’eau pendant de longues périodes.
Avec une centaine d’espèces, les Synbranchiformes habitent presque tous les environnements marécageux d’eau douce et d’eau saumâtre du sud-est de l’Asie, de l’Inde et de l’Australie, ainsi que de l’Amérique et de l’Afrique tropicale.

L’Anguille aveugle des marais (Ophisternon infernale) est un Synbranchiformes qui ne vit que dans des grottes du Mexique © indie peach nature
Ophisternon bengalense McClelland, 1844, dont la présence est signalée dans une large aire de répartition comprenant des rivières et des marais d’eau douce et d’eau saumâtre d’Asie du Sud et d’Océanie, est une espèce dont la biologie est mal connue.
Une autre espèce de l’ordre aux mœurs troglobies est Ophisternon infernale Hubbs, 1938. Il s’agit d’un poisson à tête globulaire riche en pores sensoriels et au corps allongé et vermiforme mesurant en moyenne 30 cm. Vivant dans un environnement souterrain sans lumière, ce poisson n’a pas d’yeux et son corps est dépourvu d’écailles et de pigments.
Connu dans le Yucatan au Mexique, il vit dans les eaux douces peu profondes, sous les pierres ou dans la boue des gouffres et des grottes calcaires. Il se nourrit de petits crustacés et d’excréments de chauves-souris et d’hirondelles.

Pouvant atteindre 150 cm de long, le Symbranche marbré (Synbranchus marmoratus) se déplace aussi hors de l’eau, entre les étangs, les canaux et les rizières d’Amérique centrale et d’Amérique latine. La présence d’un réseau de vaisseaux sanguins sur la paroi de sa bouche permet à ce Synbranchiformes de respirer aussi l’oxygène de l’air © Lucas Fornero
Toujours chez les Synbranchiformes, il faut mentionner Mastacembelus platysoma (Poll et Matthes, 1962), présent dans le lac Tanganyika, en Afrique. Comme ses congénères, cette espèce ressemble à une anguille et présente un corps étiré et une série d’épines dorsales. Le museau est bien développé et doté d’une paire de narines tubulaires. Sa longueur moyenne est d’un peu plus de 15 cm.
Le Symbranche marbré (Synbranchus marmoratus Bloch, 1795) peut mesurer jusqu’à 150 cm de long ; il se distingue par la présence de vestiges de nageoires dorsale et anale et par l’absence de nageoires pectorale et pelvienne. Grâce à la présence d’un riche réseau de vaisseaux sanguins sur la paroi de sa bouche, le Symbranche marbré, présent dans les étangs, les canaux et les rizières d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, est également capable de respirer l’oxygène atmosphérique.
Ordre des Syngnathiformes

Museau tubulaire et petite bouche, les Syngnathiformes vivent souvent parmi les algues. Le Dragon de mer feuillu (Phycodurus eques) en imite les détails à la perfection © Rafi Amar
Cet ordre d’Actinoptérygiens présente une composition et une position systématique encore controversées. Des espèces d’aspect très insolite y sont rattachées, telles que les trompettes, les aiguilles, les dragons de mer, les hippocampes, d’autres encore.
Outre leur apparence, ces poissons se caractérisent par une bouche de petite taille qui s’ouvre sur un museau tubulaire, d’où leur nom scientifique, littéralement “mâchoires soudées”, dont la longueur varie en fonction des proies dont ils se nourrissent habituellement. Le museau est plus court chez les espèces qui se nourrissent d’invertébrés vivant sur le fond, plus développé chez celles qui se nourrissent de proies, généralement de minuscules crevettes, qu’elles aspirent en nageant dans la colonne d’eau.
Le corps des Syngnathiformes est rigide ou semi-flexible, de forme étroite et allongée, recouvert de plaques osseuses et généralement cerclé d’une série d’anneaux osseux.
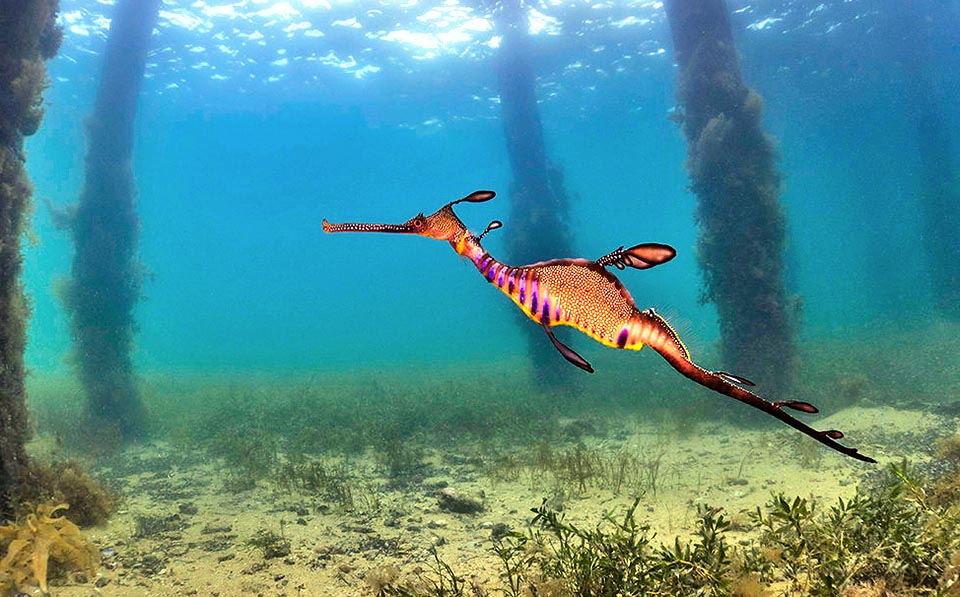
Phyllopteryx taeniolatus est un autre dragon de mer. Les Syngnathiformes incluent aussi les célèbres hippocampes, les poissons-tuyaux, les poissons-trompettes et autres © Rafi Amar
Les nageoires sont petites et ne permettent que des mouvements très lents, ce qui donne à ces poissons peu d’occasions d’échapper aux prédateurs ou de poursuivre d’éventuelles proies avec succès.
Divers représentants de l’ordre vivent au milieu des algues, où leur camouflage est assuré par leur apparence et le fait qu’ils nagent en gardant leur corps à la verticale, tête vers le haut et queue vers le bas. La queue elle-même est utilisée comme organe préhensile, avec lequel l’animal s’accroche aux algues ou aux gorgones.
De plus, importante stratégie de défense et d’alimentation, certains Syngnathiformes ont la capacité de changer de couleur rapidement, ou de produire des excroissances dermiques foliacées supplémentaires qui ne servent pas aux déplacements, mais uniquement au camouflage parmi les algues marines dans lesquelles ils vivent.

Hippocampus hippocampus, fréquent en Méditerranée et en Atlantique Est, est l’un des plus connus. Sa tête est pointue, son museau court et il ne porte pas d’excroissances © Glenn Biscop
Cette capacité semble être renforcée chez le Dragon de mer feuillu (Phycodurus eques Günther, 1865), poisson des eaux marines du sud et de l’ouest de l’Australie, et de la Tasmanie.
Un autre trait particulièrement distinctif des espèces de l’ordre est leur organisation sexuelle inversée, dite “gestation masculine” : les femelles pondent des œufs dans une poche incubatrice que les mâles portent sur leur ventre, près de l’ouverture anale.
Les mâles transportent ainsi les œufs, qui se transforment entre-temps en embryons nourris par les capillaires entourant les œufs. Lorsque les œufs éclosent, les mâles, par des contractions abdominales, expulsent des jeunes très semblables aux adultes.

L’Hippocampe à long bec (Hippocampus guttulatus), dont l’aire de répartition est similaire avec, en plus, la mer Noire, est courant également © Maurizio-Pasi
Plusieurs espèces de cet ordre sont gravement menacées par des activités humaines inadaptées, qui entraînent de graves dégradations de leurs habitats, et par l’augmentation de la demande pour leur utilisation comme souvenirs touristiques et aussi en médecine traditionnelle chinoise.
Le commerce de spécimens vivants pour aquarium est aussi une cause du déclin inquiétant des populations d’hippocampes dans de nombreux pays d’Asie.
Ces poissons singuliers sont présents dans pratiquement toutes les mers tropicales, subtropicales et tempérées chaudes. On les trouve principalement dans les habitats à algues marines, dans les récifs coralliens et dans les mangroves. Certaines espèces remontent les rivières et s’installent dans des habitats d’eau douce.

L’Hippocampe de White ou Hippocampe de Sydney (Hippocampus whitei) vit le long des côtes sud-ouest de l’océan Pacifique © David Harasti
Parmi toutes les espèces des Syngnathiformes, on peut mentionner les suivantes.
L’Hippocampe à nez court (Hippocampus hippocampus, Linné, 1758) est une des espèces les plus connues. Il mesure un peu moins de 30 cm de long et est dépourvu d’excroissances dermiques ; sa livrée plus ou moins colorée va du jaune au rouge grisâtre ou au brun. La tête finit en pointe et le museau est plutôt court. Les nageoires pectorales sont peu développées. On le trouve en Méditerranée et dans l’Atlantique oriental, généralement au milieu d’algues auxquelles il s’attache avec sa queue et dans lesquelles il se fond parfaitement.
L’Hippocampe à long bec ou Hippocampe moucheté (Hippocampus guttulatus Cuvier,1829) est une espèce proche du précédent, dont il se distingue principalement par les excroissances dermiques effilées présentes sur le corps et la tête.

Fréquent dans les aquariums domestiques, l’Hippocampe doré ou Hippocampe d’estuaires (Hippocampus kuda) présente des protubérances arrondies © Giuseppe Mazza
Grand au plus de 15 cm, sa livrée très variée peut être parfois éclaircie par des bandes blanches longitudinales. Cet animal vit dans les eaux de la Méditerranée, de l’Atlantique Est et de la mer Noire, à moins de 30 mètres de profondeur en général.
L’Hippocampe de White (Hippocampus whitei Bleeker, 1855), également connu sous les noms d’Hippocampe de Nouvelle-Hollande ou d’Hippocampe de Sydney, est mentionné exclusivement dans les eaux côtières du sud-ouest de l’océan Pacifique. Long en moyenne de 10 cm, ce poisson présente un corps doté d’épines, une tête étroite et un museau bien développé. La couleur de la livrée varie habituellement du brun clair au brun foncé ou au noir, voire parfois entièrement jaune.
L’Hippocampe pygmée de Coleman (Hippocampus colemani Kuiter, 2003), signalé dans les eaux côtières au large de l’île Lord Howe en Australie, est une espèce dont la chorologie est encore mal définie.

Découvert par hasard en 1969, l’Hippocampe pygmée rose (Hippocampus bargibanti) mesure moins de 2 cm et passe toute sa vie sur une gorgone © Francois-Libert
Il s’agit d’un petit hippocampe d’environ 2,5 cm, à tête petite et au museau court. La livrée habituelle varie du blanchâtre au jaunâtre, ornée d’étroites bandes circulaires ou elliptiques blanchâtres soulignées de fines lignes rouges sur le tronc, de bandes brun foncé rayonnant à partir de l’œil et d’appendices brun-rouge. La queue est brune marquée de rouge.
L’Hippocampe d’estuaires ou Hippocampe doré (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) est un Syngnathiforme de 20 à 30 cm environ.
Le corps, doté de protubérances arrondies et dépourvu d’épines, présente une tête relativement grande avec un museau bref et tronqué. La queue est préhensile. La livrée est de couleur variée, allant du beige au jaune avec de nombreuses mouchetures sombres.

L’Hippocampe à long nez (Hippocampus reidi) est le plus doué pour le camouflage, grâce à d’incroyables changements de couleur dans des zones prédéfinies © Terence Zahner
Cet hippocampe est présent dans le sud-est du Pacifique, où il fréquente les herbiers marins des eaux côtières, les estuaires et même les ports du sud-est asiatique.
L’Hippocampe de Bargibant ou Hippocampe pygmée rose (Hippocampus bargibanti Whitley, 1970) est un poisson minuscule ne dépassant généralement pas 2 cm de long. De l’apparence typique des Syngnathidae, ce poisson a un corps vertical, une tête allongée en tête de cheval, et une partie ventrale proéminente et arrondie.
Présente dans les océans Indien et Pacifique, cette espèce vit exclusivement sur les gorgones des récifs coralliens dont elle imite la livrée et la forme.

Grâce à ses excroissances et à sa taille de moins de 5,5 cm, l’insolite Idiotropiscis australis, hippocampe pygmée endémique des mers australiennes, est à peine visible © J. Martin Crossley
L’Hippocampe à long nez (Hippocampus reidi Ginsburg, 1933), ou Hippocampe à long museau, atteint une longueur d’un peu plus de 15 cm en moyenne.
La livrée diffère en général entre les deux sexes, les femelles étant jaunes et les mâles orange, parfois égayés par des taches sporadiques brunes ou pâles. L’espèce est très présente dans l’Atlantique ouest où elle se retient souvent aux gorgones ou aux phanérogames marines.
En raison de leur petite taille, les espèces d’Idiotropiscis (Whitley, 1947) sont appelées “Southern pygmy pipehorse” par les Australiens. Actuellement, le genre est réputé regrouper 3 espèces de ces hippocampes endémiques des mers australiennes, la plus connue étant le “Southern little pipehorse”, Idiotropiscis australis (Waite et Hale, 1921).

Macroramphosus scolopax, Syngnathiformes dit Trompette en raison de son long “museau” tubulaire, peut descendre jusqu’à 500 m de profondeur © Giuseppe Mazza
On appelle Pégases, parfois aussi Poissons-papillons, certaines espèces de Syngnathiformes au corps aplati, au museau bien développé et aux grandes nageoires pectorales en forme d’ailes. En outre, ces animaux présentent des nageoires pelviennes modifiées qui leur permettent de “marcher” sur les fonds marins où ils vivent.
Les Pégases forment la famille des Pegasidae, à laquelle on attribue actuellement cinq espèces, longues généralement de 10 à 20 cm, originaires des récifs coralliens des océans Pacifique et Indien. L’espèce la plus connue est le Petit dragon ou Petit poisson-dragon (Eurypegasus draconis Linnaeus, 1766).
La Bécasse de mer, ou Trompette, (Macroramphosus scolopax Linné, 1758) est un animal au corps comprimé dans le sens latéral et dépourvu d’écailles, habituellement de moins de 20 cm de long.

Parfois long de 1 m, le Poisson trompette des Caraïbes (Aulostomus maculatus) à la livrée irisée chasse en embuscade, à l’abri de coraux ou de prédateurs en mouvement © Kevin Bryant
Doté d’un long “museau” tubulaire à l’extrémité duquel s’ouvre la petite bouche, d’où un de ses noms communs, le Poisson trompette présente typiquement une première nageoire dorsale dotée d’une épine robuste, longue et dentée ; la seconde nageoire dorsale est très petite.
La livrée est uniformément argentée avec des nuances rosées. La présence de ce poisson est signalée dans les eaux tempérées et subtropicales de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, entre 50 et 500 m de profondeur.
La Trompette tachetée ou Poisson-trompette des Caraïbes, Aulostomus maculatus (Valenciennes, 1841), est un Syngnathiforme qui peut atteindre jusqu’à 1 m de long.

Similaire par la variabilité chromatique, la taille et le comportement opportuniste, le Poisson-trompette chinois (Aulostomus chinensis) sait se cacher derrière des tortues © Giuseppe Mazza
Ce poisson au corps allongé est doté d’une grosse tête et d’une bouche retroussée qui évoque une petite trompette, d’où son nom commun, et de plusieurs filaments tactiles implantés sur la lèvre inférieure.
Les nageoires sont situées sur la partie inférieure du corps et sont souvent repliées. Dotée de fortes capacités mimétiques, la Trompette tachetée est capable d’adapter la couleur de son corps à son environnement et, chez les mâles, de la modifier pendant la saison des amours. L’espèce fréquente les eaux de l’Atlantique où elle affectionne les algues et les récifs coralliens.
Le Poisson-trompette, Poisson-trompette chinois ou encore Poisson-trompette de l’Indo-Pacifique (Aulostomus chinensis Linnaeus, 1766) est un poisson au corps quelque peu comprimé latéralement, qui atteint environ 80 cm. L’espèce se caractérise par un long museau tubulaire à bouche proéminente dotée d’un petit barbillon à l’apex inférieur.

Le Syngnathe pélagique (Syngnathus pelagicus) se trouve dans l’Atlantique ouest, de la Nouvelle-Écosse jusqu’au Brésil © Pauline Walsh Jacobson
La nageoire dorsale est divisée en deux parties : la première est composée d’épines isolées, la seconde est une petite nageoire analogue à la nageoire anale sous-jacente.
Les nageoires pelviennes sont peu développées également et sont ornées à la base d’une tache noire. La livrée est variable, uniforme ou panachée de couleurs nuancées, allant du gris au brun en passant par le vert foncé. Certaines variétés phénotypiques sont uniformément jaune vif. La partie postérieure du corps est habituellement noirâtre et ponctuée de blanc.
Le Poisson trompette est un habile prédateur de petits poissons et de crustacés. Il vit dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien et Pacifique, où il affectionne les récifs coralliens, jusqu’à une profondeur d’environ 120 m.

Long d’un peu plus de 5 cm, l’insolite Bulbonaricus brauni est une sorte d’anguille qui aurait perdu la quasi-totalité de ses nageoires, avec le museau allongé typique des Syngnathiformes. Il ne conserve ces caractéristiques qu’au stade de larve nageuse, avant de passer à la vie démersale caché parmi les polypes des madrépores en plateaux © Christian Gloor
Le Syngnathe de lagune, ou Syngnathe de rivière, Syngnathus abaster Risso, 18279, est d’apparence filiforme, très semblable aux autres membres de sa famille (Syngnathidae). Sa longueur est de l’ordre de 15 à 20 cm.
La bouche est très petite et s’ouvre à l’extrémité d’un museau court et droit, surmonté d’une carène. La nageoire dorsale est peu élevée et de hauteur égale sur toute sa longueur ; la nageoire caudale est petite, la nageoire anale est très réduite. La livrée est généralement brune ou vert vif, les femelles matures présentant des rayures verticales sur l’abdomen.
Espèce strictement côtière, le Syngnathe de lagune est commun dans l’océan Atlantique, du golfe de Gascogne au Maroc, dans toute la Méditerranée et en mer Noire. Poisson remarquablement euryhalin, il vit également à l’embouchure des rivières et souvent sur de très longues périodes où il s’installe en populations stables.

Plus normale est l’allure du Syngnathe zébré (Dunckerocampus dactyliophorus), long d’un peu moins de 20 cm et courant dans la zone tropicale de l’Indo-Pacifique © Paddy Ryan
Un autre représentant des Syngnathidae est le Syngnathe pélagique, ou Syngnathe des Sargasses (Syngnathus pelagicus Linnaeus, 1758), largement répandu dans l’Atlantique Ouest, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu’au Brésil.
Ce poisson atteint environ 20 cm, voire un peu plus, et se distingue par l’absence de nageoires pelviennes. La livrée est brunâtre sur les parties dorsales, lesquelles, chez les spécimens immatures, sont traversées par 11-13 barres brunes. Les parties ventrales sont blanchâtres.
Cette espèce doit son nom commun au fait qu’on la trouve souvent en pleine mer parmi les amas flottants de Sargassum, un genre d’algues brunes, où elle semble se nourrir d’invertébrés planctoniques. Bulbonaricus brauni, Dawson et Alle, 1978, est un petit Syngnathidae d’une taille d’environ 5 cm.

Mais ce n’est par hasard que le Poisson fantôme arlequin (Solenostomus paradoxus), d’un peu plus de 10 cm de long, est qualifié de paradoxal dans son nom scientifique © Bernd-Hoppe
Evoquant une petite anguille, sa livrée est brun-rougeâtre tachetée de blanc.
Au stade adulte, ce poisson présente un front proéminant et ne possède ni nageoires dorsales ni nageoires pectorales. L’espèce se rencontre dans les récifs coralliens de l’océan Indien oriental.
Le Syngnathe annelé ou Syngnathe zébré (Dunckerocampus dactyliophorus Bleeker, 1853) est un autre membre de la famille des Syngnathidae. Il doit son nom aux nombreux anneaux de couleur foncée qui ornent son corps et à la bande foncée qui traverse son opercule. Long d’un peu moins de 20 cm en moyenne, le Syngnathe annelé vit habituellement dans les récifs coralliens, les bassins de marée et les grottes côtières submergées du Pacifique et de l’océan Indien.

Non moins étonnant, le Poisson-fantôme robuste (Solenostomus cyanopterus) peut prendre n’importe quelle couleur pour se fondre dans son environnement, rouge inclus © Benoit Lallement
Sous le terme générique de poissons-tuyaux fantômes sont également connus les Solenostomidae, famille de Syngnathiformes à laquelle on attribue quelques espèces du seul genre Solenostomus. On les nomme aussi poissons-fantômes, en raison de la facilité avec laquelle ils peuvent se fondre dans les algues, les gorgones, les bras d’étoiles de mer, les débris flottants, etc. grâce à leur remarquable capacité à changer de couleur et de forme corporelle.
Les Solenostomidae se distinguent des autres espèces de l’ordre par la présence de deux nageoires dorsales. De plus, contrairement aux hippocampes, ce sont les femelles Solenostomidae qui couvent les œufs dans une poche spéciale ménagée entre l’abdomen et des nageoires pelviennes bien développées.
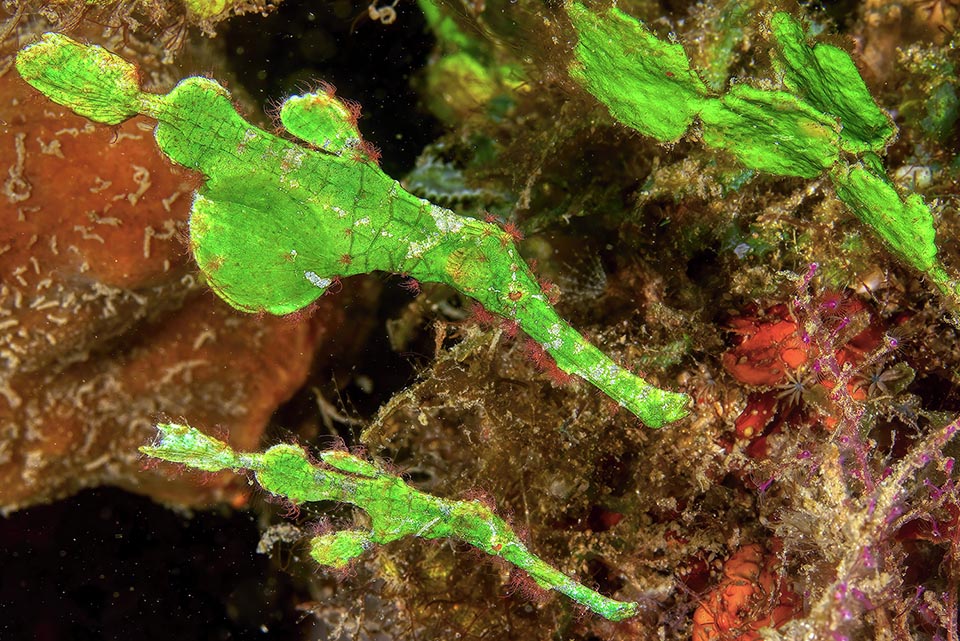
L’aspect de Solenostomus halimeda est similaire. Comme pour le précédent, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles et imitent les algues du genre Halimeda © Sonja Ooms
Le Poisson-fantôme arlequin ou Poisson-fantôme orné (Solenostomus paradoxus Pallas, 1770) est un poisson d’un peu plus de 10 cm de long, les femelles étant plus grandes et plus larges que les mâles.
La couleur de la livrée varie du noir au jaune et au rouge, agrémentés de points et de taches.
Cette espèce est signalée dans l’Ouest de l’océan Pacifique et de l’océan Indien.
Le Poisson-fantôme robuste (Solenostomus cyanopterus Bleeker, 1854), également appelé Poisson-fantôme rugueux ou Poisson fantôme moucheté, mesure un peu plus de 15 cm. La forme de son corps et sa facilité à changer de couleur lui permettent de se fondre dans un herbier, où il séjourne volontiers.

Le Dragon de mer commun (Phyllopteryx taeniolatus), présent entre le sud de l’Australie et la Tasmanie, évoque des hippocampes à protubérances feuillues © Paddy Ryan
Enfin, le Poisson-fantôme Halimeda (Solenostomus halimeda Fritzsche et Randall 2002) se caractérise en particulier par des nageoires dorsale, pelvienne et caudale très peu développées, ainsi que par une nageoire caudale tronquée. Il est courant dans les récifs coralliens des eaux côtières.
Les dragons de mer sont des Syngnathiformes à l’apparence très proche de celle des hippocampes mais au corps particulièrement doté de protubérances dermiques mimétiques grâce auxquelles ont les confond avec des algues flottantes. Le corps des dragons de mer a une longueur d’environ 20 cm mais peut dépasser 45 cm. Ces poissons étranges sont très répandus dans les mers d’Australie du Sud où l’on signale les espèces suivantes.
Le Dragon de mer commun (Phyllopteryx taeniolatus Lacepède, 1804) est un poisson d’environ 45 cm. D’apparence similaire à celle des hippocampes, il s’en différencie par la présence de protubérances foliacées qui lui permettent de se confondre aux plantes aquatiques parmi lesquelles il vit, le long de la côte méridionale de l’Australie.

Solegnathus spinosissimus, le Dragon épineux , est présent jusqu’en Nouvelle-Zélande. Tel un hippocampe, sa queue est préhensile, mais il évoque plutôt un poisson-aiguille © Paddy Ryan
Le Dragon de mer épineux (Solegnathus spinosissimus Günther, 1870), appelé aussi Hippocampe épineux d’Australie ou de Poisson-aiguille à bandes, est un poisson d’un peu moins de 50 cm de long. Il vit dans les eaux de l’Australie du Sud et de la Nouvelle-Zélande.
Enfin, il convient de mentionner les Fistulariidae, famille de poissons Syngnathiformes à l’aspect particulièrement élancé et allongé, dépourvus de barbillons sur le menton contrairement à d’autres représentants de l’ordre. Les yeux sont gros et le museau allongé présente des mâchoires réunies en tube. Les nageoires dorsale et anale, petites et asymétriques l’une par rapport à l’autre, et les nageoires ventrales sont également très en arrière. Pouvant mesurer plus de 2 m de long, les Fistulariidae sont parmi les plus grands représentants de l’ordre. De petits tubercules sporadiques sont présents sur le corps. La livrée est généralement verdâtre, avec parfois des marbrures sombres sur le dos.

Prédateurs voraces, les Fistulariidae rappellent les Aulostomus. Le Poisson flûte (Fistularia commersonii) d’environ 1 m de long a gagné la Méditerranée par le canal de Suez © Rafi Amar
La famille, représentée par un seul genre divisé à son tour en environ 4 espèces, est présente dans les eaux tropicales de tous les océans, le plus souvent sur les fonds durs et les récifs coralliens.
Suite aux migrations lessepsiennes, le Poisson-flûte (Fistularia commersonii Rüppel, 1838), Syngnathiformes de taille moyenne d’environ 1 m, s’est solidement implanté en Méditerranée.
Aeoliscus strigatus Günther, 1861, est un Syngnathiformes appelé Poisson-couteau ou Poisson rasoir strié. Comme celui des membres de la famille des Centriscidae à laquelle il appartient, son corps est protégé par un revêtement de plaques minces et transparentes qui s’étendent au-delà de l’extrémité du corps et au-dessus de la nageoire caudale, elle-même munie d’une épine pointue.
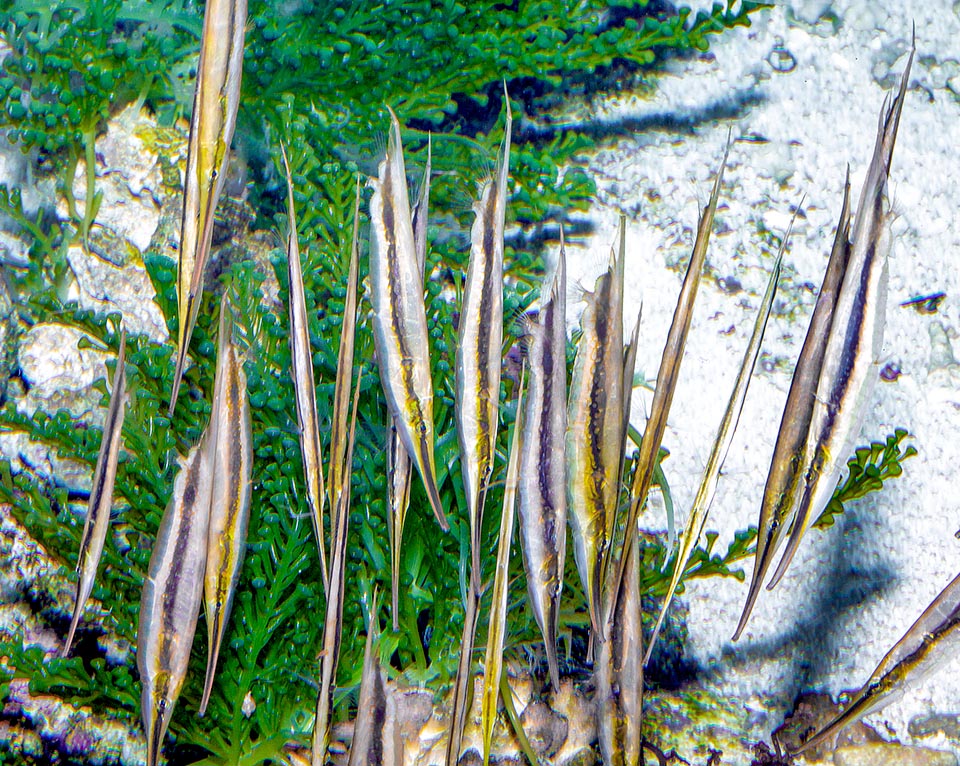
Les poissons rasoirs, qui se déplacent tête en bas comme, ici, Aeoliscus strigatus, sont aussi des Syngnathiformes du fait de leur museau tubulaire caractéristique © Giuseppe Mazza
Ce poisson présente également la caractéristique, unique parmi les membres de l’ordre, de nager la tête en bas et la queue en haut.
Long d’environ 15 cm, la livrée du Poisson-couteau peut varier, selon l’habitat, du blanchâtre avec une raie noire au jaune verdâtre avec une bande foncée diffuse.
On le trouve dans les eaux côtières occidentales de l’océan Pacifique et de l’océan Indien, parmi les herbiers marins et les récifs coralliens. Il se nourrit principalement de petits invertébrés.
Ordre des Tetraodontiformes

Balistoides conspicillum. Les Tetraodontiformes comptent environ 400 espèces, surtout marines. Tels des dents, les os de la mâchoire sont fusionnés par paires en 2 plaques © Giuseppe Mazza
Ces poissons représentent un ordre de Actinopterygii dont les espèces présentent à la mâchoire des os ressemblant à des dents, fusionnés par paires en deux plaques, l’une supérieure et l’autre inférieure, pour former une sorte de bec, d’où le nom scientifique. En outre, compte tenu du fait que ces poissons se nourrissent principalement de proies à coquille dure, comme les mollusques et les crustacés, de nombreuses espèces possèdent également des dents pharyngiennes. Il convient par ailleurs de noter qu’il n’y a pas d’unanimité quant à la position systématique de cet ordre, parfois considéré comme un sous-ordre des Perciformes.
L’aspect général des Tetraodontiformes est lui aussi très singulier et varie de la forme cubique des poissons-coffre, à la forme globulaire des poissons-globe et poissons porc-épic ou à la forme latéralement comprimée des balistes et poissons-lime. À l’exception des balistes, le corps de ces poissons est protégé par une cuirasse rigide faite de robustes plaques ou épines ou par une peau très dure et coriace, qui leur interdit toutefois la flexion latérale. Du fait de la rigidité de leur corps, ces poissons ne peuvent nager que très lentement, sous la seule poussée de leurs nageoires (nage ostraciforme).
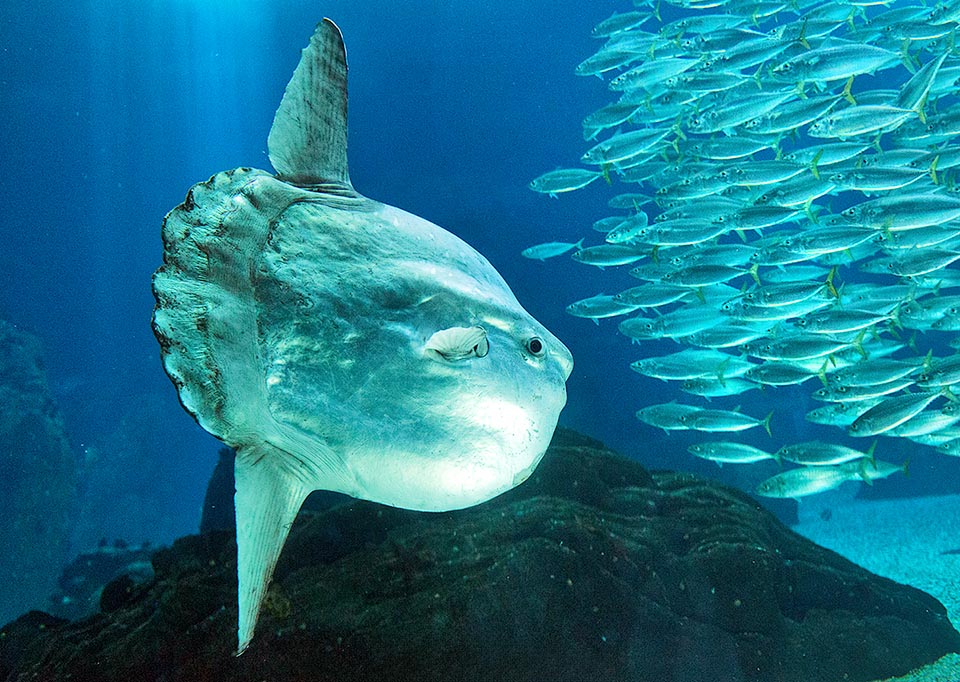
Les tailles sont très variables. Le Poisson-lune (Mola mola) est le plus grand de l’ordre, avec une longueur d’environ 3 m et un poids de 2 tonnes © Giuseppe Mazza
Leur taille varie de 2 cm pour Rudarius excelsus Hutchins, 1977, jusqu’à voisiner 3 m de long et 2 000 kg pour le Poisson lune (Mola mola Linnaeus, 1758), un des plus grands poissons osseux de la planète.
Pour pratiquement toutes les espèces de l’ordre, les nageoires sont simples, petites et arrondies. Les nageoires pelviennes sont généralement absentes ; lorsqu’elles sont présentes, elles sont fusionnées et à peine visibles. Les espèces de la famille des Molidae ont des nageoires dorsales et anales très hautes et sont dépourvues de vessie natatoire et d’épines.
Une autre caractéristique défensive extraordinaire des poissons-globe et des poissons-porcs-épics est qu’ils peuvent enfler considérablement en aspirant de grandes quantités d’eau grâce à un diverticule placé dans leur estomac. Ainsi gonflés, ces poissons deviennent difficiles à avaler, même pour les grands prédateurs.

Le plus petit est Rudarius excelsus, poisson lime de seulement 2 cm de long © Kelly-Anne Masterman
En outre, chez la plupart des Tetraodontiformes, les muscles et les viscères contiennent une neurotoxine, la tétradotoxine, puissant inhibiteur de la fonction respiratoire qui entraîne rapidement la mort.
Les Tetraodontiformes comportent environ 400 espèces et vivent principalement dans les eaux marines où ils privilégient les milieux associés aux récifs coralliens tropicaux ; diverses espèces peuvent cependant être rencontrées dans les estuaires et les cours d’eau douce.
La systématique de cet ordre est assez controversée, notamment en ce qui concerne sa subdivision en familles dont certaines, d’après certains experts, devraient être attribuées à l’ordre des Perciformes. Nous examinerons ici la position qui réunit dans l’ordre des Tetraodontiformes environ 400 espèces réparties en 10 familles, dont nous décrirons certains des principaux traits distinctifs.
Famille des Monacanthidae – Poissons lime

Le Poisson lime gribouillé (Aleturus scriptus) peut atteindre 110 cm de long. Il compte parmi les plus grands poissons de la famille des Monacanthidae © Paddy Ryan
Ils doivent leur nom générique de Poisson-lime à leur peau particulièrement rugueuse. Ils constituent une famille dont les membres se caractérisent par un corps allongé et légèrement rhomboïde, avec une tête munie sur la crête d’une épine érectile. Le museau est allongé et arqué en rostre.
Les Monacanthidae regroupent des poissons dépourvus de nageoires ventrales, remplacées par deux épines reliées à l’abdomen par une membrane épidermique. Les nageoires dorsale et anale sont allongées et la queue est robuste. Leur taille varie de quelques centimètres à 1 m.
Selon l’espèce, la livrée peut être de type camouflage ou de couleur vive tachée ou rayée. Les formes juvéniles se caractérisent par une tête grosse et une queue longue, et leur livrée diffère nettement de celle des adultes. Largement distribués dans les eaux tropicales de tous les océans, principalement dans les mers d’Australie, les Monacanthidae comprennent plus de 100 espèces parmi les plus connues, dont certains traits sont présentés ci-dessous.

Oxymonacanthus longirostris, long d’environ 12 cm, est l’un des plus colorés. Noter, sur son dos, le solide stylet défensif qui peut être bloqué en position relevée © François Libert
La Bourse orange ou Poisson lime orange (Aleturus schoepfii Walbaum, 1972) atteint ou dépasse les 40 cm de longueur. Poisson benthique, il se rencontre généralement parmi la végétation des fonds sablonneux ou vaseux à des profondeurs variées.
Le Poisson lime gribouillé (Aleturus scriptus Hospeck, 1765) présente un corps ovale allongé et fortement comprimé, ainsi qu’une petite bouche qui s’ouvre à l’extrémité d’un museau en pointe. Appelé aussi Bourse écriture, ce poisson peut atteindre 110 cm de long.
Animal aux capacités mimétiques poussées, le corps du Poisson lime gribouillé présente une couleur de fond qui, selon les caractéristiques du milieu, peut varier du brun au verdâtre en passant par le blanc marbré de taches et de bandes sombres disposées plutôt sur la tête. On le rencontre dans une aire circumtropicale où il fréquente de préférence les milieux à algues et associés aux récifs coralliens, de même que ceux des lagons.
Famille des Balistidae – Les balistes

Ce stylet érectile, qui persiste même dans le ventre des prédateurs, est l’arme défensive typique des Balistidae. Ici, le Baliste ondulé (Balistapus undulatus) © G. Mazza
Les poissons de cette famille sont désignés par le nom générique de balistes, dérivé du latin balista, en référence à la forme particulière de leurs nageoires, qui évoque celle de cette arme mortelle. La gâchette du baliste est constituée du premier des trois rayons épineux en lesquels la nageoire dorsale est transformée. Ce rayon est érectile et pourvu d’une sorte de verrou de sécurité constitué par le deuxième rayon épineux.
Les nageoires pectorales sont petites mais robustes, les nageoires ventrales sont inexistantes.
De forme ovoïde, fortement comprimée latéralement, les balistes ont une tête volumineuse aux yeux saillants et à la bouche forgée en un bec puissant armé de dents acérées.
Les Balistidae mesurent généralement entre 30 et 75 cm de long, en fonction de l’espèce.

Balistes vetula. Nageoires repliées, les balistes sont capables d’entrer dans un terrier par la porte basse et, en l’obstruant, de dormir tranquillement, à l’abri des courants © Giuseppe Mazza
Les balistes sont également facilement reconnaissables à leur nage caractéristique obtenue en agitant alternativement à droite et à gauche les nageoires dorsale et anale, très visibles et proches de la queue.
La famille des Balistidae, considérée comme particulièrement proche des poissons limes des Monacanthidae, regroupe des espèces distribuées dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Indien, Pacifique et Atlantique, ainsi que dans les eaux tempérées de la Méditerranée.
De mœurs diurnes et très territoriaux, les Balistidae se nourrissent principalement d’invertébrés, d’algues et de zooplancton.
Voici quelques-unes des plus de 40 espèces attribuées à la famille.
Le Baliste étoilé (Abalistes stellaris Bloch et Schneider, 1801) est le seul représentant du genre.
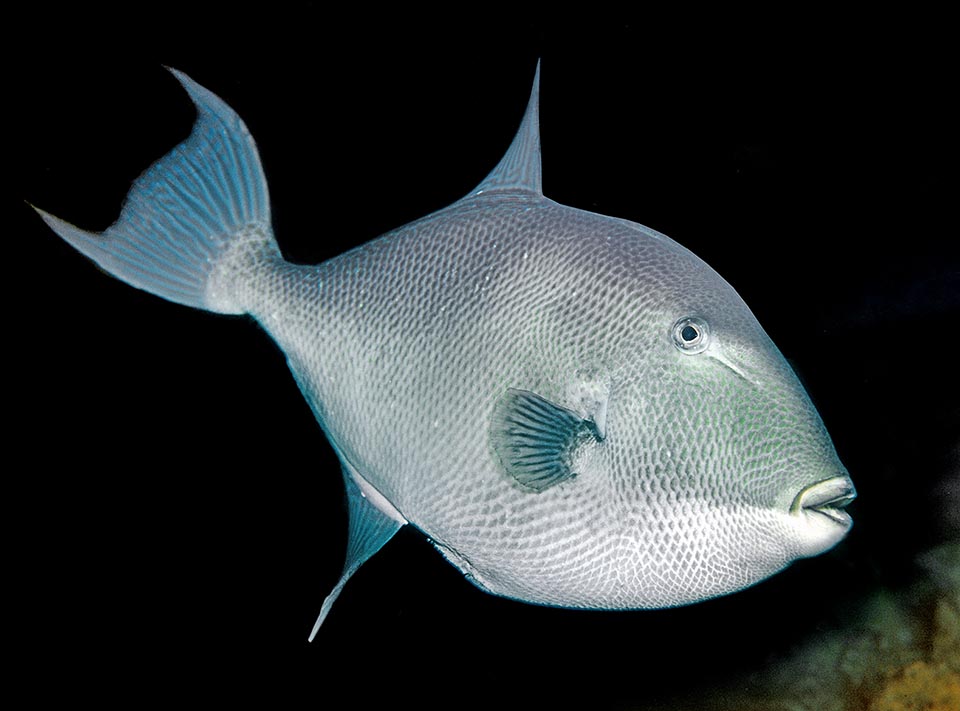
Pendant la nage, cependant, ce stylet n’est pas nécessaire et la première nageoire dorsale disparaît souvent dans un logement spécial, comme chez ce Balistes capriscus © Giuseppe Mazza
Long d’environ 60 cm, on le trouve sur les fonds vaseux et dans les récifs coralliens des eaux occidentales de l’océan Pacifique, de l’océan Indien et de la mer Rouge. De couleur grisâtre, tacheté de points blancs, le Baliste étoilé se caractérise par la présence d’un profond sillon devant l’œil.
Le Baliste strié ou Baliste ondulé (Balistapus undulatus Park, 1797), seul représentant du genre, arbore une livrée très vive et polychrome. Il vit dans les récifs coralliens et les lagons des atolls du Pacifique et de l’océan Indien.
Le Baliste gris, Baliste porc ou encore Baliste cabri (Balistes capriscus Melin, 1789), est un poisson d’une longueur moyenne de 60 cm. Espèce des eaux côtières peu profondes de l’Atlantique et de la Méditerranée, le Baliste cabri y privilégie les récifs coralliens.
Une autre espèce du genre est le Baliste royal, Baliste de Sa Majesté, ou Bourse (Balistes vetula Linné, 1758). Ce Balistidae, qui peut mesurer une cinquantaine de centimètres ou un peu plus, se rencontre en Atlantique.

Avec ses 75 cm de long, le Baliste titan (Balistoides viridescens) de l’Indo-Pacifique tropical est le plus grand Balistidae existant © Gianni Neto
Le Baliste clown (Balistoides conspicillum Bloch et Schneider, 1801) et le Baliste titan, ou Baliste à tête jaune (Balistoides viridescens Bloch et Schneider, 1801), vivent au milieu des récifs coralliens de l’océan Pacifique et de l’océan Indien.
Parmi les autres Balistidae des récifs coralliens de l’océan Indien et du Pacifique, on trouve le Baliste bleu ou Baliste à dents rouges (Odonus niger, Rüppell, 1836), seul représentant du genre, le Baliste à marges jaunes ou Baliste à face jaune (Pseudobalistes flavimarginatus, Richardson, 1845), et le Baliste jaune et bleu ou Baliste vermiculé (Pseudobalistes fuscus, Bloch et Schneider, 1801).
Leurs congénères, le Baliste écharpe, Baliste-Picasso à bandeau noir ou Baliste-Picasso à chevrons (Rhinecanthus rectangulus Bloch et Schneider, 1801), et le Baliste taché ou Baliste-Picasso à tâche noire (Rhinecanthus verrucosus Linnaeus, 1758), fréquentent les eaux tropicales du Pacifique. Le Baliste-Picasso à piquants, Baliste Picasso ou Baliste Picasso clair (Rhinecanthus aculeatus Linnaeus 1758), est présent aussi dans les eaux côtières de l’Atlantique oriental. Le Baliste-Picasso arabe (Rhinecanthus assasi Forsskål, 1775) est rattaché au même genre et se rencontre principalement dans l’océan Indien et dans la mer Rouge.
Famille des Ostraciidae – Poissons-coffres

Ostracion meleagris. Une coque osseuse rigide recouvre les poissons-coffres, ne laissant apparaître que la bouche, les yeux, les branchies, les nageoires et le tractus caudal © Brian Cole
Le corps des poissons de cette famille est protégé par un revêtement osseux dur (carapace) qui ne laisse à découvert que la bouche, les yeux, l’ouverture des branchies, les nageoires et la queue.
Étroitement liés aux poissons-lime (Monacanthidae) et aux poissons-globe (Tetraodontidae), les membres de cette famille, appelés aussi poissons boîtes, poissons-gâchette ou encore poissons à détente, sont largement disséminés dans les océans et les mers de la ceinture tropicale, où ils affectionnent les eaux peu profondes et les récifs coralliens.
On attribue un peu plus de 20 espèces aux Ostraciidae, parmi lesquelles on peut citer les suivantes.
Le Poisson-coffre jaune (Ostracion cubicus Linnaeus, 1758) est l’espèce type qui a donné son nom à la famille. Originaire de l’Indo-Pacifique et de la mer Rouge, ce poisson mesure environ 45 cm de long.

Une cuirasse parfois hérissée d’épines défensives, comme chez ce Tetrosomus gibbosus insolite à section triangulaire © Giuseppe Mazza
Le Poisson vache cornu, ou Poisson vache (Lactoria cornuta Linnaeus, 1758), mesure environ 40 cm de long et est connu principalement dans le Centre-Ouest du Pacifique, où on le trouve sur des fonds vaseux et pierreux peu profonds et sur les récifs coralliens.
Le Coffre bossu, ou Poisson-coffre pyramide (Tetrasomus gibbosus Linnaeus, 1758), appelé ainsi en raison de la forme singulière de son corps, mesure de 12 à 20 cm de long. Originaire des eaux du Pacifique occidental et de l’océan Indien, cette espèce a atteint la Méditerranée par migration lessepsienne.
Famille des Tetraodontidae – Poissons globe
Les Tetraodontidae sont une famille dont le nom scientifique fait référence aux quatre larges dents qui fusionnent pour former deux plaques de broyage, l’une inférieure et l’autre supérieure, caractéristique commune aux individus de cette famille.

Les poissons-globes, comme cet Arothron hispidus, se défendent en se gonflant d’eau pour paraître plus gros et être moins vulnérables aux prédateurs © Giuseppe Mazza
Le nom générique de Poisson-globe, quant à lui, provient de leur faculté, en cas de menace, de faire enfler considérablement et rapidement leur corps en avalant une grande quantité d’eau.
Cette faculté de dilatation se retrouve également chez les Diontidae (poissons porc-épic) dont les Tetraodontidae se différencient immédiatement par leur corps recouvert de minuscules épines et non de longues épines.
Présents dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien, principalement dans les habitats marins, mais aussi saumâtres et d’eau douce, les Tetraodontidae comptent environ 200 espèces.
Le Tétrodon pintade, ou Poisson-ballon pintade (Arothron meleagris Lacépéde, 1798), peut mesurer une cinquantaine de centimètres de long, avec une livrée caractéristique uniformément noire, mouchetée de blanc ou de jaune vif.

Peau et entrailles sont imbibées de tétrodotoxine, poison qui bloque la respiration. Qui avale cet Arothron meleagris, s’il n’en meurt pas, évitera l’espèce par la suite © Giuseppe Mazza
Le Canthigaster d’Ambon (Canthigaster amboinensis Bleeker, 1824) est un poisson d’environ 15 cm de long qui se distingue par sa livrée polychrome et particulièrement voyante.
Le Poisson-ballon à points blancs d’Hawaï (Canthigaster jactator Jenkins, 1901) est un petit poisson d’un peu moins de 10 cm de long, des eaux chaudes de l’archipel hawaïen.
Le Tétrodon nain, ou Canthigaster des Caraïbes (Canthigaster rostrata Bloch, 1876), est un petit poisson d’environ 12 cm, vivant dans les eaux du centre-ouest de l’Atlantique.
Famille des Diodontidae – Poissons porcs-épics

A ces défenses efficaces, les poissons porc-épic associent, en enflant comme ce Diodon liturosus, une allure épineuse © Giuseppe Mazza
Ces poissons composent une famille de Tétraodontiformes dont les individus portent le nom générique de Poissons porcs-épics.
Ce nom résulte de leur principale caractéristique, à savoir leur capacité à gonfler rapidement en avalant de l’eau, comme les poissons-globes ; cependant, à la différence de ces derniers, leur corps est hérissé de longues épines cornées.
Les Diodontidae sont répandus dans les eaux tropicales et subtropicales de tous les océans, où leurs représentants mesurent entre 30 et 90 cm.
Cette famille regroupe une vingtaine d’espèces, dont voici quelques-unes.

Chez certaines espèces, comme Chilomycterus antillarum, les épines, à base triangulaire et régulièrement disposées, restent toujours dressées © Kevin Bryant
Le Poisson porc-épic réticulé (Chilomycterus antillarum Jordan et Rutter, 1897), également appelé Diodon réticulé, est un Diodontidae d’environ 30 cm de long, de l’Atlantique occidental.
Le Porc-épic ballon, ou Poisson porc-épic à taches (Diodon holocanthus Linnaeus, 1758), peut atteindre une cinquantaine de centimètres et vit dans les récifs coralliens, en eaux tropicales de tous les océans.
Le Poisson porc-épic ballon, ou Poisson globe (Diodon nicthemerus Cuvier, 1818), mesure environ 40 cm de long et vit dans les eaux de l’Australie méridionale.
Famille des Molidae – Poissons lune

Il existe environ 5 espèces de Molidae ou poissons-lune, dont le corps circulaire évoque une meule de moulin. Ici, Mola alexandrini, qui peut atteindre 3 m de diamètre © Simon Pierce
Ils doivent leur nom à la forme circulaire de leur corps qui rappelle une meule de moulin, “mola” en latin. Les Molidae représentent une famille de Tétraodontiformes qui possède plusieurs caractères distinctifs. En plus d’être parmi les plus grands poissons télostéens, les Molidae ne possèdent pas d’os caudal ; leur structure squelettique est principalement constituée de cartilage et leur peau ne comporte pas de plaques osseuses.
Une autre caractéristique des Molidae est qu’ils nagent avant tout à l’aide de leurs nageoires dorsale et anale. On présume que les nageoires pectorales servent de stabilisateurs.
Poissons pélagiques, les Molidae sont de piètres nageurs et restent généralement près de la surface en dérivant au gré des courants. Présents dans toutes les mers, ils se répartissent en environ 5 espèces dont le Poisson lune (Mola mola Linnaeus, 1758).
Ordre des Zeiformes

Le Saint-Pierre (Zeus faber) ainsi appelé en raison du dessin sur ses flancs d’une pièce de monnaie évoquant un épisode de l’Évangile (Matthieu 17.24-27) est un Zeiformes © Pierre Corbrion
Cet ordre d’Actinopterygii comprend des espèces caractérisées principalement par la conformation particulière de la bouche, qui peut s’étirer en forme de tube destiné à capturer les proies. D’apparence et de taille variables, les Zeiformes ont un corps haut et très comprimé latéralement, parfois recouvert de plaques osseuses épineuses. La vessie natatoire est présente. Les nageoires comportent de nombreux rayons épineux. Chez certains représentants de la famille des Zeidae, la nageoire dorsale présente des rayons allongés, parfois filiformes. Leur taille varie de quelques centimètres, de 7 à 15 cm chez les Zenionidae, à environ 90 cm chez le Poisson Saint-Pierre ou Saint-Pierre (Zeus faber Linnaeus, 1758).
Les Zeiformes comprennent des espèces qui sont toutes marines et qui vivent dans des environnements variés, souvent à des profondeurs considérables. La chair de certaines espèces est particulièrement appréciée. Le Saint-Pierre est une espèce des eaux tropicales et tempérées, notamment de Méditerranée et de la mer Noire, où il préfère les fonds sableux ou vaseux, à des profondeurs généralement comprises entre 50 et 400 m.
Ordre des Clupeiformes
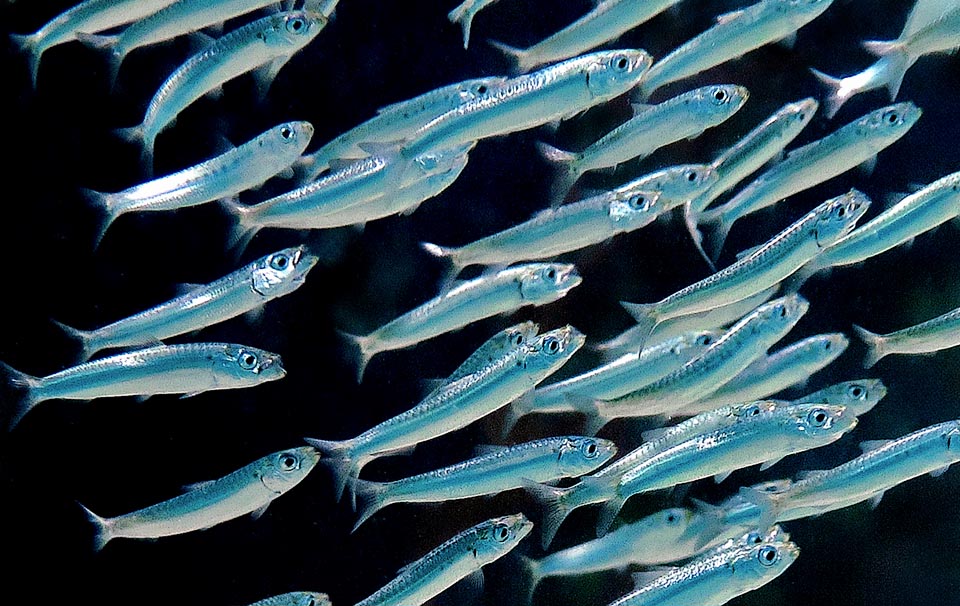
Banc de sardines (Sardina pilchardus). Elles appartiennent à l’ordre des Clupeiformes, groupe de poissons importants pour l’alimentation humaine © Roberto Pillon
Ordre d’Actinopterygii dans lequel on regroupe des espèces au corps effilé, plus ou moins haut et comprimé latéralement, recouvert d’écailles à l’exception de la tête.
Les représentants de cet ordre ont une bouche non protractile, leurs nageoires n’ont pas de rayons épineux et la nageoire caudale a toujours deux lobes.
Il n’y a de ligne latérale que sur la tête. Les Clupeiformes sont des poissons physostomes, dont la vessie natatoire communique avec l’intestin par le canal pneumatique. De nombreuses espèces largement distribuées dans les mers et les eaux douces comptent au nombre de cet ordre. Elles forment des maillons importants des réseaux trophiques et constituent la principale source de nourriture de nombreux prédateurs.
La chair de certaines espèces de Clupeiformes – anchois, sardines, harengs et autres -, d’une importance fondamentale pour l’alimentation humaine, est riche en vitamines et en minéraux, et particulièrement en oméga-3 et en autres graisses insaturées.

Insolite gros plan sur Clupea pallasii. Il renvoie au drame existentiel de l’homme moderne dépeint dans le célèbre tableau “Le cri” de Munch, et semble rappeler que le triste destin de tous les clupéiformes est d’être prédaté © Roberto Pillon
Regroupés, pour ces caractéristiques nutritionnelles, sous le nom générique de “poissons bleus” avec des espèces d’autres ordres dont celui des Perciformes, les Clupeiformes figurent également parmi les principaux maillons du réseau trophique des océans du globe.
En effet, ils constituent la principale source de nourriture de nombreux prédateurs, non seulement de poissons (thons, requins, espadons et autres), mais aussi de cétacés (baleines, dauphins et autres), de pinnipèdes (phoques, otaries, lions de mer, lions de mer…), ou encore d’oiseaux marins comme les pingouins, les cormorans, les pélicans.
Ci-après sont présentés les caractéristiques essentielles des espèces les plus connues des Clupeiformes. Pour plus de détails, on se référera aux pages spécifiques de cette encyclopédie.
La Sardine (Sardina pilchardus Walbaum, 1792), la seule espèce du genre, ressemble à l’Anchois mais s’en distingue facilement par un corps plus grand, plus comprimé latéralement et recouvert de grandes écailles qui se détachent facilement au contact.
Par ailleurs, la Sardine a une tête en pointe avec des yeux de grande taille recouverts d’une paupière adipeuse qui rappelle celle de l’Alose feinte (Alosa fallax Linnaeus, 1803).
La bouche est grande et tournée vers le haut, avec la mandibule plus longue que la mâchoire, et équipée de petites dents.
Sur ses parties ventrales, la Sardine porte une rangée d’écailles pointues (scutelles) qui, à la différence du Sprat (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758), ne forment pas une véritable carène.
Les opercules branchiaux présentent des carènes osseuses disposées en éventail. La livrée est bleue ou verdâtre iridescente sur les parties dorsales, argentée sur les flancs avec de petites taches noires, blanchâtre sur les parties ventrales.
D’une longueur typique de 15 à 20 cm, ce poisson peut aussi atteindre les 30 cm. Espèce pélagique vivant généralement en haute mer, la Sardine fréquente également les eaux côtières peu profondes pendant la belle saison.
La reproduction a lieu tout au long de l’année, avec un pic en période hivernale. Très productive, chaque femelle de Sardine pond un grand nombre d’œufs pélagiques qui éclosent au bout de quelques jours. Les larves prennent rapidement une livrée semblable à celle des adultes.

Ici, un banc entier d’Engraulis mordax est la proie d’une Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) © Donna Pomeroy
D’une importance économique considérable, la Sardine est victime d’une surexploitation particulièrement marquée, entraînant une forte baisse des stocks de poissons.
L’Allache, ou Z’anchois (Sardinella aurita Valenciennes, 1847), ressemble beaucoup à la Sardine, dont elle se différencie par une forme trapue et la présence d’une ligne de couleur dorée bien visible sur ses flancs.
Il s’agit d’une espèce pélagique dont l’aire de répartition englobe l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, où on la trouve à des profondeurs variées.
Une autre espèce qui occupe une place très importante dans l’économie humaine est l’Anchois européen ou Anchois (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758.). A première vue, ce poisson peut être confondu avec la Sardine, mais il s’en distingue facilement par toute une série de caractères.

Ici encore, un Goéland à ailes grises (Larus glaucescens) profite sans retenue d’un banc de Clupea pallasii en surface © Liam Ragan
Le corps de l’Anchois européen est effilé et mince, long de 15 à 18 cm, et dépourvu de la crête d’écailles rigides présente chez la Sardine.
La tête, conique, présente de grands yeux placés très en avant. La bouche est très grande, avec le maxillaire plus long que la mandibule et de nombreuses petites dents. Le corps est bleu-vert sur le dos, argenté fréquemment avec une bande sombre sur les flancs, blanchâtre sur les parties ventrales.
L’Anchois européen est un poisson pélagique typique présent également en haute mer ; en mai-juin, il se rapproche de la côte pour frayer. Espèce modérément euryhaline, il tolère également les eaux saumâtres et il n’est pas rare qu’il pénètre dans les estuaires et les lagunes. C’est l’une des rares espèces à pouvoir migrer de la Méditerranée à la mer Rouge, empruntant ainsi le chemin inverse de celui des migrateurs lessepsiens.

Là, ce Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) transporte allègrement vers sa “salle à manger” un Clupéiforme pouvant dépasser 30 cm de long, Brevoortia tyrannus © Sean Werle
Les autres espèces désignées sous le nom générique d’anchois, auxquelles elles ressemblent du reste, sont l’Anchois péruvien (Engraulis ringens Jenyns, 1842), ou Anchois du Pérou, une des espèces de poisson les plus pêchées commercialement, et l’Anchois indien (Stolephorus indicus van Hasselt, 1823), ou Anchois d’Hardenberg, largement utilisé en cuisine dans les régions maritimes de l’Asie du Sud-Est.
Une autre espèce de Clupeiformes de grande importance pour la pêche commerciale et l’économie de l’Europe du Nord est le Hareng de l’Atlantique (Clupea harengus Linnaeus, 1758), habitant des eaux côtières de l’Atlantique Nord. Il est totalement absent de la Méditerranée.
Le corps de ce poisson est fusiforme, comprimé dans le sens latéral, recouvert de petites écailles qui forment ventralement une quille peu marquée.

De taille similaire, le Hareng de l’Atlantique (Clupea harengus) est pêché intensivement pour la consommation humaine sur les deux côtes de l’Atlantique Nord © hunterefs
Typiquement, les opercules branchiaux sont lisses avec un bord postérieur arrondi. La bouche, pointue et munie de dents minuscules, présente un maxillaire qui dépasse la mâchoire. La taille du hareng avoisine généralement les 30 cm, bien que certains individus puissent atteindre 50 cm. La couleur du corps est uniformément bleue avec des tons verdâtres sur le dos et blanc argenté sur les flancs et les parties ventrales.
Le Hareng est un poisson pélagique qui vit en bancs de grande taille, dont la nourriture principale est constituée de petits crustacés copépodes. À son tour, il constitue une source importante de nourriture pour de nombreux prédateurs. Des poissons, dont les requins, les raies, les saumons, les cabillauds, des mammifères comme les dauphins, les orques et les marsouins, ou encore de grands oiseaux comme les harles et les fous, comptent parmi les principaux prédateurs du Hareng. Pendant la saison de reproduction, ce poisson quitte la haute mer et migre vers les eaux côtières. Les femelles pondent un grand nombre d’œufs non pélagiques dans les zones à fond caillouteux.

L’Allache (Sardinella aurita), très proche de la sardine, s’en distingue par sa forme trapue et une ligne dorée sur les flancs © Allison & Carlos Estape
Sous le nom générique de Alosa sont connues plus de 25 espèces du genre du même nom, caractérisées par l’absence de dents au niveau du palais, du vomer et de la langue. Ces espèces ne dépassent généralement pas 40 à 50 cm de long. Presque toutes marines, les aloses remontent les rivières au printemps pour se reproduire.
Alosa alosa (Linnaeus, 1758), la Grande Alose, est une espèce de l’Atlantique Est comparable à l’Alose feinte, dont elle se distingue visuellement par la présence d’une unique tache sombre à l’arrière de l’opercule.
L’Alose feinte méditerranéenne (Alosa agone Scopoli, 1786) est l’une des quelques espèces du genre vivant en eau douce. Signalée dans plusieurs lacs préalpins du nord de l’Italie, ce poisson est en général plus petit que les autres espèces du genre et est très apprécié comme nourriture.

Longue d’au plus 50 cm, l’Alose feinte (Alosa fallax) est pêchée en Atlantique de l’Est et en Méditerranée et mer Noire occidentales © Hans Hillewaert
Le Sprat ou Anchois de Norvège (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758) est une espèce de Clupeiformes très proche de la Sardine, dont il se distingue pourtant aisément par ses nageoires ventrales, implantées plus en avant et à la même hauteur que la nageoire dorsale, ainsi que par la présence d’une robuste crête ventrale formée d’écailles dures. En outre, le sprat ne dépasse pas 15 cm et présente une livrée bleu vif sur les parties dorsales et blanc argenté sur les parties ventrales. Cette espèce est répartie sur une large aire de distribution composée des eaux marines septentrionales. Le sprat est très rare en Méditerranée.
L’Alose feinte (Alosa fallax Linnaeus, 1803) est un poisson au corps ovale, comprimé latéralement, qui atteint chez l’adulte une taille moyenne de 35 à 50 cm. Cette espèce se caractérise par une membrane adipeuse épaisse et transparente qui recouvre les yeux, et les opercules marqués par des stries rayonnantes. La carène ventrale est composée de boucliers osseux avec une épine tournée vers l’arrière. L’Alose feinte est présente dans l’est de l’Atlantique, dans l’ouest de la Méditerranée et dans la mer Noire.
Ordre des Aulopiformes

De l’ordre des Aulopiformes relèvent des poissons apparus au Miocène et largement disparus. Ici, Synodus intermedius, un poisson-lézard bien connu © Brian-Cole
Aussi appelés Alepisauriformes, ces poissons sont considérés comme un ordre de poissons Actinopterygii presque complètement éteint dont la composition taxonomique n’est pas clairement définie.
De nombreux Aulopiformes sont des poissons des grands fonds et leur biologie n’est elle aussi que mal connue. Certaines espèces présentent des caractères d’hermaphrodisme, voire d’autogamie.
D’ailleurs, selon l’avis de certains experts, avis d’ailleurs très débattu, cet ordre n’est aujourd’hui représenté que par les espèces de Synodus (Scopoli, 1777). Pour compliquer encore les choses, l’attribution du genre Synodus aux Aulopiformes est elle-même toujours discutée. Au-delà des controverses taxonomiques, on citera les espèces suivantes parmi celles attribuées à l’ordre.
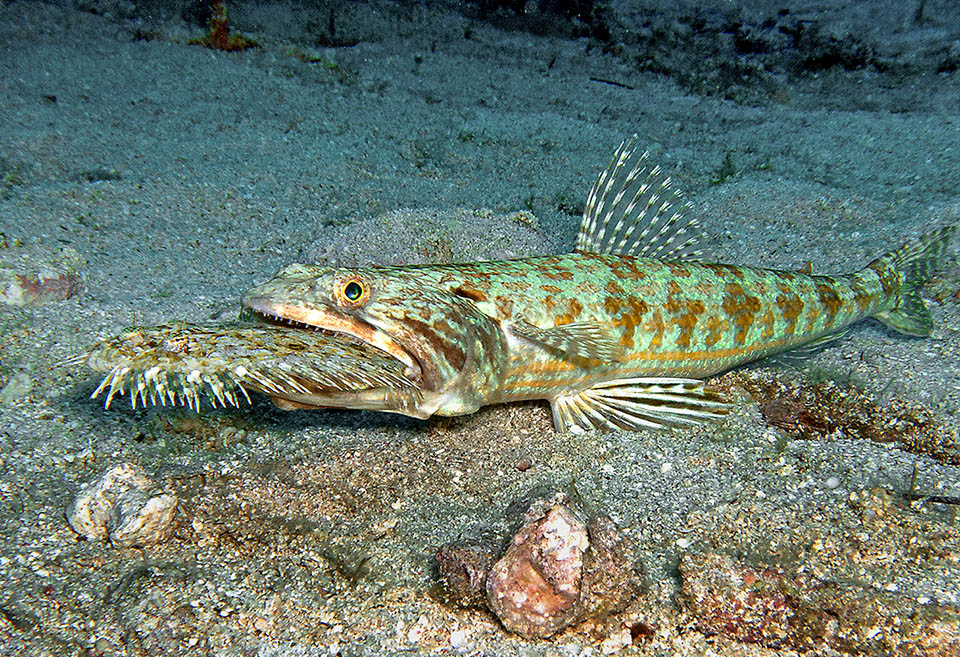
Il est souvent embusqué sur les fonds marins de l’Atlantique tropical. Ici, en Floride, il vient de capturer un Bothus ocellatus © Mickey Charteris
Le genre Synodus comprend des espèces de petite et moyenne taille, au corps fusiforme et à la bouche large avec de nombreuses dents de formes diverses qui sont également implantées sur la langue. La livrée est variée, vivement colorée chez certaines formes tropicales.
Ce genre est largement réparti dans les mers tropicales et subtropicales, où il est présent dans les environnements côtiers peu profonds, en particulier rocheux, et dans les récifs coralliens. Tel est le cas, dans les Caraïbes, de Synodus intermedius (Spix & Agassiz 1829).
En Méditerranée, le genre est représenté par le Poisson-lézard rayé (Synodus saurus Linnaeus, 1758). Ce petit poisson de moins de 20 cm présente une très grande bouche dotée de nombreuses dents pointues de différentes tailles. La couleur de sa livrée varie du gris au brun sur les parties dorsales, elle est blanchâtre sur les parties ventrales ; sur les flancs, elle est ornée de bandes verticales bleues ou bleu clair.

Latropiscis purpurissatus est un Aulopiformes endémique de la côte australienne. Dit “Sergent Baker”, il fait partie des poissons à nageoires en drapeau © Sascha Schulz
Aux Aulopiformes, plusieurs chercheurs attribuent également le genre Aulopus, dont le représentant le plus connu est le Limbert royal (Aulopus filamentosus Bloch, 1792), poisson de taille moyenne d’environ 40 cm, présent en Atlantique oriental et en Méditerranée.
Les autres espèces du genre sont Aulopus bajacali (Parin & Kotlyar, 1984), le Limbert du Pacifique oriental, et Aulopus chirichignoae (Béarez et al., 2024). Très semblables en apparence et souvent confondus l’un avec l’autre, ce sont des poissons d’environ 30 cm de long qui vivent sur les fonds vaseux et sablonneux du plateau continental du Pacifique Est.
Enfin, mentionnons Latropiscis purpurissatus J. Richardson, 1843, poisson d’environ 60 cm endémique d’Australie.
Ordre des Abuliformes
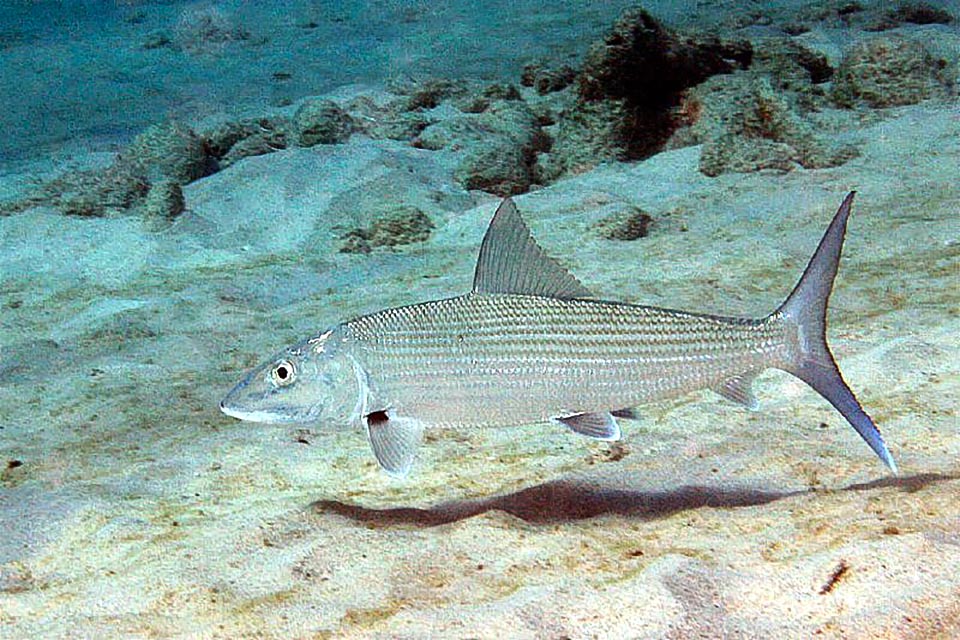
Les Abuliformes comptent un peu plus d’une douzaine d’espèces. La plus commune, Albula vulpes, peut atteindre 1 m de long et 10 kg © Kevin Bryant
On considère que cet ordre d’Actinopterygii regroupe des espèces au corps allongé avec une tête conique et un museau allongé sur la face inférieure duquel s’ouvre une bouche plutôt petite. Les nageoires n’ont que des rayons mous et la nageoire caudale est nettement fourchue. Ces poissons peuvent mesurer jusqu’à 1 m de long et peser environ 10 kg.
Très présents dans les mers tropicales, où ils vivent dans des environnements côtiers aux eaux peu profondes et aux fonds sablonneux et vaseux, les Abuliformes comprennent un peu plus d’une douzaine d’espèces, dont la plus commune est le Tarpon (Albula vulpes Linnaeus, 1758). La couleur du corps est argentée et marquée de lignes sombres longitudinales semblables à celles du Mulet à grosse tête (Mugil cephalus Linnaeus, 1758). Le Tarpon est une espèce euryhaline répandue dans les eaux marines américaines, où il préfère les environnements côtiers.
Ordre des Anguilliformes

Les Anguilliformes incluent des poissons à l’allure de serpents, comme cet Ophichthus ophis, et mesurent de 30 cm à 3 m de long © Gustavo F. de Carvalho-Souza
Considéré comme un ordre de poissons Actinopterygii, les Anguilliformes regroupent des espèces caractérisées par une forme allongée rappelant un peu celle d’un serpent.
La taille varie selon les espèces, allant d’environ 30 cm pour le Congre bec-fin à 3 m pour le Congre commun.
La plupart des Anguilliformes n’ont pas de nageoires ventrales mais des nageoires dorsales et anales très allongées. En revanche, les nageoires pectorales sont petites et arrondies.
La livrée des espèces de cet ordre est très variée, mais elle prend la plupart du temps une coloration sombre uniforme qui permet à ces poissons de se fondre dans les milieux fangeux dans lesquels ils vivent habituellement.

Il s’agit de poissons marins, sauf les espèces du genre Anguilla, comme cette Anguilla anguilla, qui vivent en eau douce et rejoignent ensuite la mer pour se reproduire © Giuseppe Mazza
Pour d’autres espèces, la livrée est claire et ornée de taches et de points sombres, comme chez le Serpenton tacheté (Ophichthus ophis Linnaeus, 1758) ou le Serpenton à selles (Pisodonophis semicinctus Richardson, 1848).
Les Anguilliformes comprennent des espèces pour la plupart réparties en milieu marin. Seules les espèces du genre Anguilla vivent en eau douce et migrent vers la mer au moment du frai. L’Anguille ou Anguille européenne (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) est un poisson téléostéen de la famille des Anguillidae. Les œufs des Anguilliformes donnent naissance à des formes larvaires spéciales à aspect feuillu appelées leptocéphales.
Parmi les nombreuses espèces de cet ordre, on ne s’intéressera ici qu’à quelques unes, présentes régulièrement ou plus ou moins accidentellement en Méditerranée.

Les larves des Anguilliformes ont toutes l’apparence d’une feuille de saule transparente et sont dites leptocéphales © Gonzalo Mucientes Sandoval
Plusieurs espèces relèvent des Congridae, famille dont les membres sont appelés Congres et Anguilles de jardin.
Le Congre commun (Conger conger Linnaeus, 1758), déjà cité, est le géant de l’ordre ; il peut atteindre 3 m de long et peser jusqu’à 70 kg.
Très courant en Méditerranée à différentes profondeurs, on le trouve aussi en Atlantique Est et, accessoirement, dans la partie occidentale de la mer Noire.
Le Congre des Baléares (Ariosoma balearicum Delaroche, 1809) est une espèce de petite taille, mesurant jusqu’à 50 cm, largement distribuée en Atlantique, dans l’océan Indien, en mer Rouge et en Méditerranée.

Le Congre commun (Conger conger), commun en Méditerranée et dans l’Atlantique Est, est le géant de l’ordre avec ses 3 m de long et ses 70 kg © Tamsyn Mann
Le Congre bec-fin (Gnathophis mystax Delaroche, 1809) est un petit Congridae anguilliforme d’environ 30 cm qui se caractérise par un museau pointu et proéminent et de très grands yeux.
C’est un poisson commun de Méditerranée et de l’Atlantique central et oriental, où il fréquente les fonds vaseux, en général à des profondeurs comprises entre 100 et 800 mètres.
Toujours chez les Congridae, citons Rhynchoconger trewavasae (Ben-Tuvia, 1993), largement diffusé dans les eaux profondes de l’ouest de l’océan Indien. Il s’agit d’un Anguilliformes de taille moyenne, environ 50 cm, dont la biologie est peu connue et dont un seul spécimen a été observé en Méditerranée.

Par contre le Congre des Baléares (Ariosoma balearicum), très présent dans l’Atlantique, l’océan Indien, la mer Rouge et la Méditerranée, ne dépasse pas 50 cm © Luis P. B.
Dans une autre famille, celle des Muraenesocidae, le Congre-brochet féroce ou Murénésoce de Guinée (Cynoponticus ferox Costa, 1846) est d’aspect très proche du Congre. Ce poisson peut atteindre 2 m de long, il est brun rouge sur le dos, gris foncé sur les flancs et sur les parties ventrales. Les nageoires sont bordées de noir, sauf les nageoires pectorales qui sont entièrement noires.
Présent dans l’Atlantique Est, ce poisson est l’un des rares représentants du genre à fréquenter également la Méditerranée, où il semble relégué aux eaux occidentales. On le trouve généralement au-dessus des fonds sableux où il se nourrit principalement de crustacés et de poissons.
Les Muraenesocidae comptent également en leur sein la Murène japonaise (Muraenesox cinereus (Forsskål, 1775), largement distribuée dans les océans Pacifique et Indien et dont quelques individus auraient atteint la Méditerranée orientale à la faveur de migrations lessepsiennes.

Le Congre jardinier, Heteroconger longissimus, de taille similaire, émerge des fonds marins atlantiques comme des brins battus par le vent © Pascal Girard
Appelé aussi Congre-brochet à dents de sabre, ce poisson mesure habituellement 80 cm mais il peut atteindre et même dépasser les 2 m. Sa livrée prend des tonalités grises, avec des couleurs foncées en bordure des nageoires impaires.
Parmi les Anguilliformes qui peuvent se trouver accidentellement en Méditerranée, figurent les espèces suivantes d’Ophichthidae, famille dont les représentants sont communément appelés anguilles-serpents.
Le Serpenton tacheté (Ophichthus ophis Linnaeus, 1758), originaire de l’Atlantique, reste généralement autour de 1 m mais peut parfois dépasser 2 m de long.

Sur fonds meubles ou sableux entre -100 et -300 m vit Ophisurus serpens, l’Anguille des profondeurs, en Atlantique Est, dans l’ouest de l’océan Indien et en Méditerranée © josepvilanova
Le corps est jaune clair, plus foncé ou orange sur les parties dorsales, orné de taches brunes de taille variable. La présence de cette espèce en Méditerranée reste à confirmer.
Un autre exemple d’Ophichthidae est l’Anguille serpent à selles, ou Poisson-serpent rayé (Leiuranus semicinctus Lay et Bennet,1839), qui peut atteindre près de 70 cm. L’espèce s’identifie aisément par sa livrée, faite de bandes semi-circulaires foncées sur la quasi-totalité du corps, dont la couleur de fond est uniformément blanchâtre. La queue est pointue et rigide. Il vit dans les récifs et les lagons des eaux tropicales des océans Indien et Pacifique.
Le Serpenton à long nez ou Anguille des profondeurs (Ophisurus serpens Linnaeus, 1758) est un Ophichthidae des fonds meubles ou sablonneux, entre 100 et 300 m de profondeur, de l’Atlantique Est, de l’Océan Indien occidental et aussi de la Méditerranée occidentale.

Dans l’Indo-Pacifique tropical, de l’Afrique à Hawaii, voici le Poisson-serpent rayé, Leiuranus semicinctus, qui dépasse à peine les 60 cm © Claire Goiran
Il s’agit d’un Anguilliforme au corps particulièrement longiligne qui peut atteindre jusqu’à 2,5 m.
La livrée est vert-grisâtre sur le dos, argentée sur le ventre.
Le Serpenton à selles (Pisodonophis semicinctus Richardson, 1848) est lui aussi une espèce d’Ophichthidae de l’Atlantique Est, arrivée depuis la Mer Rouge jusqu’en Méditerranée, où elle reste rare.
Cet Anguilliforme de taille moyenne, mesurant habituellement 80 cm, se caractérise par une livrée gris jaunâtre avec des taches noires circulaires sur le dos et des taches foncées sur la tête.

Contrairement aux anguilles, les murènes, fréquentes dans toutes les mers, n’ont pas de nageoires pectorales. Ici, Muraena clepsydra et Gymnomuraena zebra © Allison & Carlos Estape
Le nom générique de Murène fait clairement référence aux espèces d’Anguilliformes classées dans la famille des Muraenidae, famille qui se trouve principalement dans les eaux tropicales et tempérées. Les murènes sont particulièrement courantes dans les récifs coralliens, généralement à faible profondeur sur des fonds durs.
La Murène commune (Muraena helena Linnaeus, 1758) et, moins courante, la Murène brune (Gymnothorax unicolor Delaroche, 1829) se rencontrent dans les eaux méditerranéennes. De temps en temps, la présence accidentelle de quelques espèces de la mer Rouge est signalée en Méditerranée.
Parmi les espèces présentes en Atlantique Ouest, on trouve trois espèces du même genre, la Murène verte (Gymnothorax funebris Ranzani, 1829), la Murène dorée (Gymnothorax miliaris Caup, 1856) et la Murène tachetée (Gymnothorax moringa Cuvier, 1829). Beaucoup plus nombreuses sont les murènes qui vivent dans les eaux tropicales des récifs coralliens de l’océan Indien et de l’océan Pacifique.

Pourtant toutes n’ont pas un air inquiétant. La Murène ruban (Rhinomuraena quaesita) de l’Indopacifique tropical, étonne par ses couleurs et ses drôles expansions nasales © Francois Libert
Citons ici la Murène étoilée (Echidna nebulosa Ahi, 1789), la Murène-zèbre (Gymnomuraena zebra Shaw, 1797) et la Murène léopard (Gymnothorax favagineus Bloch et Schneider, 1801).
Terminons ce rapide aperçu des Muraenidae tropicaux avec d’autres espèces du genre Gymnothorax, comme la Murène tatouée (Gymnothorax griseus Lacépède, 1823), la Murène à taches noires (Gymnothorax isingteena Richardson, 1845), et la Murène javanaise (Gymnothorax javanicus Bleeker, 1859), le géant de la famille avec 3 m de long et 30 kg de poids.
La Murène ruban (Rhinomuraena quaesita Garman, 1888), Anguilliforme de plus de 1 m de long qui vit dans les récifs coralliens et les lagons des atolls de l’océan Indien et du Pacifique, et la Murène de Brummer ou Murène ruban blanc (Pseudechidna brummeri Bleeker, 1858), longue d’environ 30 à 70 cm, originaire de l’Indo-Pacifique, sont singulières par leur forme particulièrement comprimée.
Ordre des Elopiformes

Les Elopiformes ont des larves leptocéphales comme les Anguilliformes et rappellent des harengs. Le Tarpon (Megalops atlanticus) peut atteindre 2,5 m et 160 kg © Wolfram Sander
Considérés comme un ordre d’Actinoptérygiens, les Elopiformes regroupent des poissons de taille moyenne à grande dont le museau n’est pas saillant et dont la bouche apicale ou supérieure est caractérisée par des plaques gulaires bien développées. La mâchoire dépasse l’œil. Les ouvertures branchiales sont larges. La nageoire caudale est généralement fortement fourchue.
A première vue, les Elopiformes ressemblent aux Harengs, mais leurs larves leptocéphales les rapprochent des Anguilliformes. L’ordre des Elopiformes est présent dans les mers tropicales où il est représenté par des espèces des eaux côtières mais qui peuvent aussi s’aventurer dans les eaux saumâtres et les eaux douces.
Dans cet ordre, il faut mentionner le Tarpon (Megalops atlanticus Valenciennes, 1847), poisson qui peut atteindre 2,5 m de long et peser jusqu’à 160 kg. En référence à la livrée bleu verdâtre de son dos et à ses flancs argentés, ce poisson est également appelé Roi d’argent.
Ordre des Notacanthiformes

Les Notacanthiformes ont eux aussi des larves leptocéphales. Ils vivent en eaux profondes : Halosaurus pectoralis peut atteindre 1 200 m, d’autres espèces 5 000 m © Ken Graham
Les Notacanthiformes représentent un ordre d’Actinopterygii regroupant des espèces au corps allongé, au museau arrondi et proéminent avec une bouche petite et ventrale située sous les yeux.
En raison de leurs larves leptocéphales, les Notacanthiformes sont considérés comme apparentés aux Anguilliformes.
Largement répandu dans toutes les mers, l’ordre est représenté par des espèces vivant entre 100 et 5 000 m de profondeur.
Parmi les quelques espèces de Notacanthiformes présentes en Méditerranée, on citera les suivantes.
Le Poisson-tapir clair (Notacanthus bonaparte Risso, 1840) est un poisson de taille modeste, d’un peu moins de 30 cm, au corps jaune brunâtre sur le dos, argenté sur les côtés et au ventre bleu. Il est signalé dans les eaux de l’Atlantique Est et de l’Ouest de la Méditerranée.

Le Grandgousier pélican (Eurypharynx pelecanoides), d’environ 2 m et à bouche énorme, est un Saccopharyngiformes, poissons abyssaux à larves leptocéphales © Gonzalo Mucientes Sandoval
Le Poisson-tapir à petites épines (Polyacanthonotus rissoanus De Filippi et Vérany, 1857) est un poisson mesurant généralement moins de 20 cm de long, que l’on trouve dans tout l’Atlantique et en Méditerranée.
Le Longnaze long boyau (Halosaurus ovenii Johnson, 1864) est un Notacanthiformes peu signalé en Méditerranée occidentale. Ce poisson d’environ 50 cm de long présente des parties dorsales d’une couleur rosée foncée avec des reflets métalliques.
Ordre des Saccopharyngiformes
Les Saccopharyngiformes constituent un ordre d’Actinoptérygiens dans lequel on trouve des espèces d’apparence variée mais caractérisées par leurs mâchoires très allongées, sauf pour les membres de la famille des Monognathidae qui n’ont pas de mâchoires. Une autre caractéristique de l’ordre est l’absence d’écailles, de vessie natatoire, de nageoires ventrales et, chez de nombreuses espèces, de nageoire caudale. Chez les espèces où elle est présente, la nageoire caudale est rudimentaire.
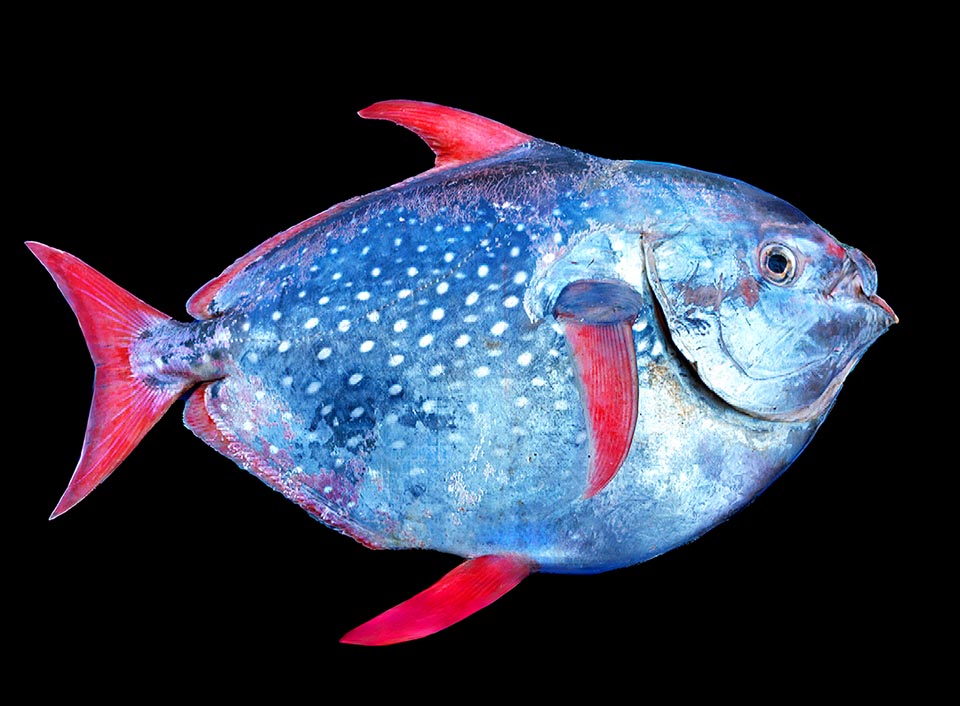
Le Saumon des Dieux (Lampris guttatus) est un Lampridiformes pélagique atteignant les 2 m de long. Répandu dans toutes les mers, on le trouve aussi en Méditerranée © Giuseppe Mazza
Apparentés aux Anguilliformes du fait de la présence de larves leptocéphales, les Saccopharyngiformes sont des poissons abyssaux présents dans toutes les mers sauf en Méditerranée. La biologie de ces poissons est peu connue, en voici deux espèces.
L’Avaleur feu-arrière (Saccopharynx ampullaceus Cuvier, 1829), signalé dans l’Atlantique à des profondeurs allant jusqu’à 3 000 mètres, peut atteindre 1,5 m de long.
Le Grandgousier pélican (Eurypharynx pelecanoides Vaillant, 1882), qui mesure un peu moins de 2 m, doit son nom commun à sa bouche énorme dotée d’une ouverture incroyable, utilisée pour attraper les petites proies dont il se nourrit. Le Grandgousier pélican est présent dans toutes les mers tropicales et tempérées, à l’exception de la Méditerranée.
Ordre des Lampridiformes
Considérés comme un ordre d’Actinoptérygiens, les Lampridiformes, également appelés Lampriformes ou Allotriognathes, doivent leur nom scientifique à leur livrée typiquement colorée, en mode brillant.

Courants au Paléocène, il reste une vingtaine d’espèces pélagiques ou abyssales de Lampridiformes. Avec ses 30 cm, Metavelifer multiradiatus est l’un des plus petits © J. Martin Crossley
Les Lampridiformes regroupent des espèces d’aspect très varié mais au corps comprimé latéralement, le plus souvent très allongé.
Les tailles sont également très variables, allant de moins de 30 cm chez Metavelifer multiradiatus Regan, 1907, à plus de 15 m chez le Ruban de mer (Regalecus glesne Ascanio, 1772).
À l’instar de nombreux mollusques céphalopodes, les Lampridiformes actuels sont équipés d’une poche à encre qui s’ouvre dans le cloaque et qui leur permet de produire un nuage noir pour échapper aux prédateurs.
Largement représentés dès le Paléocène, il y a plus de 60 millions d’années, les Lampridiformes ne comptent plus aujourd’hui qu’une vingtaine d’espèces pélagiques et abyssales.
Le Poisson-crête du Pacifique Nord (Lophotus capellei Temminck et Schlegel, 1845) est appelé ainsi en raison de la crête formée par la nageoire dorsale qui dépasse du museau.
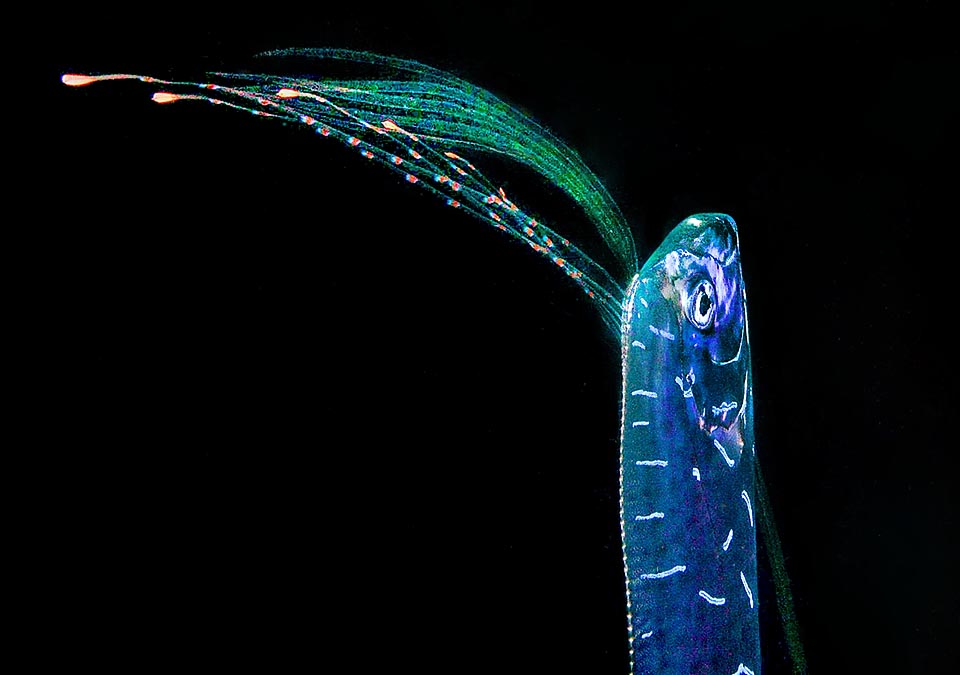
Présent dans toutes les mers, Regalecus glesne est le géant de l’ordre avec ses 15 m de long © Thomas Menut
Également appelé Poisson-licorne , il atteint une longueur de 2 m et vit dans les eaux tropicales et subtropicales des océans Atlantique et Pacifique.
Le Ruban de mer (Regalecus glesne Ascanio, 1772), appelé aussi Régalec ou Roi des harengs, est l’un des plus grands poissons vivants. Il est présent dans toutes les mers, y compris en Méditerranée où il est cependant rare.
Le Saumon des dieux ou Lampris-lune (Lampris guttatus Brünich, 1788), nommé aussi Opah ou encore Lampris royal, peut lui aussi atteindre 2 m de long. C’est un poisson pélagique largement distribué dans toutes les mers, y compris la Méditerranée.
Enfin, Trachipterus altivelis Kner, 1859, Re del salmone en italien, peut atteindre 180 cm de long et vit dans les eaux du Pacifique Est.
Ordre des Characiformes

Les Characiformes comprennent de nombreuses espèces d’eau douce. Avec environ 120 cm de long, le terrifiant Hydrocynus goliath en est le plus grand © Gwili Gibbon
Ce groupe est considéré comme un ordre d’Actinopterygii regroupant de nombreuses espèces d’eau douce.
À première vue, les espèces de ce groupe ressemblent aux Cypriniformes auxquels elles sont apparentées, mais elles s’en distinguent par la présence d’une courte nageoire adipeuse charnue située entre la nageoire dorsale et la queue.
La taille des Characiformes varie d’un peu moins de 2 cm chez Xenurobrycon polyancistrus (S.H. Weitzman, 1987) à 120 cm de long chez le Poisson-tigre Goliath (Hydrocynus goliath Boulenger, 1898).
De nombreuses espèces sont vivement colorées. Les Characiformes comptent plusieurs centaines d’espèces et sont présents dans les eaux douces d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et d’Afrique.
Du fait de la beauté de leur livrée et de leur facilité de reproduction, certaines espèces sont devenues des hôtes privilégiés des aquariums. Les Tétra néons sont particulièrement recherchés par les aquariophiles. Il s’agit d’un terme générique désignant les Characiformes à la livrée brillante et aux nageoires carrées.

Commun dans les aquariums domestiques, le Cardinalis (Paracheirodon axelrodi) atteint 2,5 cm au maximum et compte parmi les plus petits © Giuseppe Mazza
On se limitera ici à un rapide aperçu des formes les plus connues et les plus représentatives de l’ordre, renvoyant pour tout détail supplémentaire aux notices respectives dans cette Encyclopédie.
Le Néon bleu (Paracheirodon innesi Myers, 1936) est un petit Poisson tétra, d’une longueur moyenne d’un peu plus de 2 cm, originaire du bassin de l’Amazone. Par ses couleurs, sa robustesse et sa vivacité, le Néon est l’un des poissons d’aquarium les plus populaires. Le Cardinalis (Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956)), qui lui ressemble, vit dans les affluents de l’Orénoque et du Rio Negro.
Le Tétra vampire ou Payara (Hydrolycus scomberoides G. Cuvier, 1819) est un Poisson tétra dont la caractéristique la plus évidente réside dans ses longues dents en forme de crocs qui dépassent la mâchoire de 10 à 15 cm.
Le Payara est un Characiformes de plus de 1m et de plus de 15 kg, qui vit dans les eaux du bassin amazonien où il se nourrit de petits poissons.
Le Poisson-tigre Goliath (Hydrocynus goliath Boulenger, 1898), également nommé Poisson-chien ou Mbenga, vit en Afrique dans les eaux du bassin du fleuve Congo et du lac Tanganyika. De grande taille, il mesure en moyenne 1,5 m de long et pèse 50 kg. Le Poisson-tigre Goliath est un prédateur caractérisé par ses longues dents, plus de 2,5 cm, d’où son nom commun.

Long d’environ 3 cm, le Poisson hachette marbré (Carnegiella strigata) est aussi un Characiformes souvent présent dans les foyers © Giuseppe Mazza
D’une manière générique, on appelle communément Dorado ou Dourado les quelques espèces de Salminus (Agassiz, 1829), poissons dont la longueur est généralement de 120 à 140 cm. Ce genre est originaire des grandes rivières d’Amérique latine où il se répartit en environ 4 espèces, dont Salminus brasiliensis G. Cuvier, 1816 ; les Characiformes sont très appréciés des pêcheurs sportifs.
Le Poisson-tigre géant ou Aymara (Hoplias aimara Valenciennes, 1847), encore appelé Traíra et Manjuma, est un poisson de plus d’un mètre de long, commun dans les rivières d’Amérique du Sud.
Le Piranha à ventre rouge ou plus simplement Piranha rouge (Pygocentrus nattereri Kner, 1858), originaire des rivières et des lacs d’Amérique du Sud, est un poisson d’aquarium très apprécié.
Le Poisson hachette marbré (Carnegiella strigata Eigenmann, 1909), est un petit poisson de 3 cm, originaire du bassin de l’Amazone, en Amérique du Sud. Il s’agit d’un Characiformes appelé aussi Hachette marbrée ou Poisson hachette, en raison de la forme particulière de son corps, comprimé latéralement et dont la partie ventrale est nettement arquée alors que le dos est presque horizontal.
Ordre des Cypriniformes

Le célèbre Poisson rouge (Carassius auratus), décliné sous toutes les formes en aquarium, fait partie de l’immense ordre des Cypriniformes, de près de 5 000 espèces © Giuseppe Mazza
Les poissons de ce groupe forment un ordre très hétérogène comptant une grande variété d’espèces, près de 5 000, communément appelées carpes, gobies, botia et autres. Ce nombre ne cesse de croître car on continue d’en décrire de nouveaux taxons. Compte tenu de la complexité de l’ordre et de la disparité des positions sur sa systématique, nous nous contenterons ici d’examiner brièvement les principales familles auxquelles on attribue parfois le statut de sous-ordre.
Tel est le cas des Cyprinidae, qui constituent un vaste groupe d’Actinopterygii d’eau douce regroupant quelque 3 000 espèces, dont la Carpe et le Barbeau.
Les Cyprinidae sont des poissons caractérisés par l’absence d’estomac (agastrique) et par une mâchoire dépourvue de dents. En revanche, ils sont équipés de fortes dents pharyngiennes et d’une plaque masticatrice formée par un processus du crâne, qui leur permet de broyer les coquilles dures des mollusques dont ils se nourrissent en priorité. Les dents pharyngiennes diffèrent selon les espèces et sont utilisées pour l’identification taxonomique.
La plupart des Cyprinidae ont une paire de barbillons.

La famille des Cyprinidae compte 3 000 espèces, généralement dotées d’une paire de barbillons. Ici, une jeune Carpe commune (Cyprinus carpio) qui peut atteindre 27 kg © Giuseppe Mazza
Leur taille varie d’environ 10 mm chez Paedocypris progenetica (Kottelat, Britz, Tan & Witte, 2006) à 3 mètres chez la Carpe Géante Siamoise (Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898).
Espèces d’Amérique du Nord, d’Afrique et d’Eurasie, les Cyprinidae vivent dans les eaux douces de la plupart des régions tempérées et tropicales ; ils sont absents des zones plus septentrionales.
De nombreuses espèces de Cyprinidae sont communément désignées par le nom générique de Carpe, dont la plus connue est la Carpe commune (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), appelée également Carpat, ou encore Carpe européenne.
La Carpe commune est un poisson des eaux douces d’Europe et d’Asie, largement introduit dans une bonne partie du monde. Une caractéristique comportementale et biologique de ce poisson est sa capacité à se croiser avec d’autres espèces de la famille, en particulier avec le Carassin doré ou Poisson rouge (Carassius auratus Linnaeus, 1758), donnant alors naissance à différentes variétés, les carpes koi, qui diffèrent les unes des autres par leurs combinaisons de couleurs, leur décoration et la qualité de leurs écailles.

Le Barbeau fluviatile (Barbus barbus), naturellement présent en Europe centrale et orientale, a été introduit dans une grande partie du continent © Giuseppe Mazza
D’autres Cyprinidae très connus sont les espèces du genre Barbus (Cuvier & Cloquet, 1816), qu’on appelle communément Barbeaux à cause de deux paires de barbillons sur le museau ; la lèvre inférieure présente une proéminence postérieure, appelée lobe médian.
Dans le genre, il faut mentionner le Barbeau fluviatile (Barbus barbus Linnaeus, 1758), naturellement présent en Europe centre-orientale mais introduit dans une grande partie du continent, le Barbeau étrusque (Barbus tyberinus Bonaparte, 1839), aussi nommé, en Italie, Barbo tiberino ou Barbo del Tevere, et le Barbeau de la vallée du Pô ou Barbeau italien (Barbus plebejus Bonaparte, 1839).
Le nom collectif de Gobies est attribué aux Gobiidae, une famille d’Actinoptérygiens dont la position systématique est incertaine. Certains experts les considèrent comme les seuls représentants d’un ordre distinct, les Gobiiformes, d’autres les incluent dans l’ordre des Perciformes, d’autres encore dans l’ordre des Cypriniformes.
Au-delà des questions systématiques, la famille des Gobiidae comprend des espèces caractérisées par une ventouse ventrale en forme de disque issue de la fusion des nageoires pelviennes.

Les Gobiidae, généralement caractérisés par une ventouse qui leur permet de s’accrocher aux rochers, sont presque tous marins, comme ce splendide Amblygobius phalaena © Giuseppe Mazza
La plupart des Gobiidae sont des poissons de petite taille, comme le Gobie pygmée nain ou Gobie des Philippines (Pandaka pygmaea Qui, 1927) et le Gobie nain (Trimmatom nanus Winterbottom & Emery, 1981), qui atteignent à peine 1 cm de long.
Avec plus de 2000 espèces connues, les Gobiidae sont des poissons de grande importance écologique, largement répandus dans les environnements marins, côtiers, saumâtres et d’eau douce des régions tropicales et tempérées. De nombreuses espèces ont une grande valeur écologique et se rencontrent dans des environnements extrêmes, comme certaines espèces de Chlamydogobius (Whitley, 1930) qui vivent dans l’eau des sources géothermiques.
Les gobies sont généralement des poissons de fond, certaines espèces du genre Glossobius (Gill, 1859) se trouvant également dans des grottes submergées. Parmi les nombreuses espèces de la famille, il convient de mentionner le Gobie tacheté (Pomatoschistus microps Krøyer, 1838), d’environ 9 cm de long, des eaux côtières douces et saumâtres du centre-nord de l’Atlantique ; le Gobie à tache noire (Neogobius melanostomus Pallade, 1814), d’environ 20 cm et qu’on trouve dans les milieux marins et dulçaquicoles du centre-ouest de l’Asie ; et le Gobie du désert (Chlamydogobius eremius Zietz, 1896).

Gobiodon okinawae, long au plus de 3,5 cm, est l’un des plus petits vertébrés existants, souvent présenté comme une curiosité dans les aquariums publics © G. Mazza
Dans les eaux de la Méditerranée, de l’Atlantique Est et de la mer Noire vivent le Gobie paganel (Gobius paganellus Linnaeus, 1758), et le Gobie noir (Gobius niger Linnaeus, 1758). Ces deux espèces d’environ 15 cm sont particulièrement résistantes à la pollution des eaux.
Enfin, il convient de mentionner le poisson appelé, en italien, Ghiozzo padano, ou Ghiozzo d’acqua dolce europeo (Padogobius bonelli Bonaparte, 1846 : cette espèce est originaire des cours d’eau du nord de l’Italie, de la Suisse et du nord de la péninsule balkanique. Sa taille n’atteint généralement pas 10 cm, les femelles étant plus petites que les mâles.
Les Cobitidae, jugés par certains spécialistes comme les seuls représentants d’un sous-ordre distinct, les Cobitoidei, sont considérés comme une famille qui, avec plus de 250 espèces, est présente dans les eaux douces du continent eurasien et du nord-ouest de l’Afrique.
De forme variable, fusiforme ou anguilliforme (Pangio Blyth, 1860), les Cobitidae sont des poissons dont la taille, qui reste généralement autour de 10 cm, peut néanmoins varier d’un peu plus de 2 cm (Lepidocephalichtys zeppelini Havird&Tangjitjaroen, 2010) à plus de 50 cm (Lepidocephalichthys manipurensis Arunkumar, 2000).

Le Gobie noir (Gobius niger), qui peut atteindre 25 cm de long, est le plus grand du genre. Il est fréquent en Méditerranée, dans l’Atlantique Est et dans la mer Noire © Giuseppe Mazza
La Loche de rivière (Cobitis taenia Linnaeus, 1758) vit dans les cours d’eau à faible courant et à fond sablonneux ou vaseux d’Europe centrale et orientale ; elle est absente d’Italie.
On signale également la Loche d’étang (Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758) dans les eaux douces d’Europe.
La Loche asiatique ou Loche baromètre (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) est une espèce originaire du sud-est de l’Asie et introduite dans diverses régions d’Europe.
Exclusivement dans les eaux douces de l’Italie péninsulaire, on trouve la Loche transalpine ou Loche italienne (Cobitis bilineata Canestrini, 1886), la Cobite del Volturno des italiens (Cobitis zanandreai Cavicchioli, 1965) et la Cobite mascherato (Sabanejewia larvata De Filippi, 1859). Il s’agit de petits poissons d’un peu moins de 10 cm pour les femelles, 6 cm pour les mâles.
Le Botia clown, ou Loche-clown (Chromobotia macracanthus Bleeker, 1852), mérite également d’être mentionné. Originaire des eaux fluviales d’Indonésie, cette espèce est réputée auprès des aquariophiles pour sa livrée flamboyante, mais sa biologie reste peu connue.

Absente d’Italie, la Loche de rivière (Cobitis taenia) se rencontre dans les cours d’eau lents à fond sablonneux ou vaseux d’Europe centrale et orientale © Giuseppe Mazza
Originaires des eaux douces d’Amérique du Nord, les Catostomidae, poissons Cypriniformes, comprennent environ 80 espèces, la plupart d’entre elles mesurant une soixantaine de centimètres. Communément appelés Poissons à ventouses, les Catostomidae se caractérisent principalement par leur bouche à ouverture subterminale dotée de grosses lèvres charnues.
L’espèce la plus populaire est sans aucun doute le Poisson-soleil chinois (Myxocyprinus asiaticus Bleeker, 1865), qu’on appelle aussi Catostomide du Yang-tsé-kiang. Une autre espèce digne d’être mentionnée est le Meunier rouge (Catostomus catostomus Forster, 1773).
Les cours d’eau à forts courants des montagnes d’Asie du Sud-Est abritent les Gyrinocheilidae, famille de poissons Cypriniformes dont les espèces disposent d’une bouche en ventouse avec laquelle elles se fixent au substrat. Les Gyrinocheilidae sont communément appelés Loches à ventouse alguivore, leur régime alimentaire se composant d’algues et de débris organiques. L’espèce la plus connue est le Gyrino (Gyrinocheilus aymonieri Tirant, 1883), qui mesure environ 25 cm et est originaire des eaux douces du Sud-Est asiatique.
Ordre des Gonorynchiformes

L’espèce la plus connue de l’ordre des Gonorynchiformes est le Poisson-lait ou Chanos (Chanos chanos), qui peut dépasser 150 cm de long, avec un record à 180 cm et 14 kg © anarid
Il s’agit d’un ordre de Actinopterygii comprenant des espèces dotées d’un appareil de Weber primitif basé sur les trois premières vertèbres et une ou plusieurs côtes, ainsi que de petites bouches édentées.
Cet ordre, qui compte un peu moins de 40 espèces de 10 à 150 cm, est présent dans le Pacifique et l’océan Indien et, pour certaines, dans les eaux douces d’Afrique tropicale.
L’espèce la plus connue des Gonorynchiformes est certainement le Poisson-lait ou Chano (Chanos chanos Forsskål 1775). Ce grand poisson, qui peut dépasser 150 cm de long, présente un corps blanc argenté, des nageoires bordées de noir et une queue particulièrement fourchue.
Le Poisson-lait vit habituellement dans les eaux marines tropicales peu profondes, le long des plateaux continentaux et autour des îles. Il pénètre souvent dans les estuaires et remonte le cours des fleuves.
Ordre des Gymnotiformes

Tel Electrophorus electricus, les Gymnotiformes regroupent des poissons à très longue nageoire anale en forme de voile, seul organe de propulsion touchant presque la tête © Giuseppe Mazza
On leur attribue souvent le nom générique de Poissons-couteaux à cause de leur forme allongée et comprimée latéralement, et de leur queue très étroite. Les Gymnotiformes forment un ordre d’Actinopterygii qui comprend des espèces d’eau douce des rivières du Nord de l’Argentine.
Les Gymnotiformes sont des poissons caractérisés par une très grande nageoire anale en forme de voile, qui court sur toute la partie inférieure du corps, presque jusqu’à la tête, et qui est leur unique instrument de propulsion. Les Poissons-couteaux sont dépourvus de nageoires dorsale et pelvienne. La plupart des espèces possèdent des organes capables de générer de faibles champs électriques, qui servent à l’orientation et à la recherche de nourriture. Certaines espèces, comme la célèbre Anguille électrique d’Amérique du Sud (Electrophorus electricus Linnaeus, 1766), peuvent produire de puissantes décharges à haut voltage qui peuvent étourdir ou tuer les proies, et repousser les prédateurs.
La consistance du patrimoine taxonomique des Gymnotiformes est encore largement à préciser et dépasse actuellement 150 espèces. Certains Gymnotiformes sont des poissons d’aquarium très appréciés, comme le Poisson-couteau de verre Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847), le Poisson-couteau noir de jais Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766) et le Gymnote rayé ou Poisson-couteau à bandes, Gymnotus carapo (Linnaeus, 1758).
Ordre des Siluriformes

Espèces variées avec souvent 1-5 paires de barbillons, les Siluriformes sont dits poissons-chats. Malapterurus electricus chasse par des décharges pouvant atteindre 400 V © Giuseppe Mazza
Couramment appelés poissons-chats, les Siluriformes représentent un ordre d’Actinoptérygiens qui doit son nom commun à la présence d’une à cinq paires de barbillons évoquant les moustaches des chats ; une de ces paires est plus longue et implantée sur la mâchoire et les autres sont plus petites sur le mandibule. Quelques espèces, cependant, sont totalement dépourvues de barbillons.
Les Siluriformes composent un groupe très hétérogène du point de vue de la physionomie et des comportements.
Le corps de la plupart des poissons-chats est effilé mais aplati sur le ventre, dépourvu d’écailles et souvent doté de plaques osseuses cutanées. La bouche est presque toujours équipée de nombreuses petites dents.
Chez de nombreux Siluriformes, les nageoires pectorales et dorsales comportent une forte raie épineuse, acérée et souvent dentelée, souvent reliée à des glandes à venin. Une nageoire adipeuse est souvent présente.

Le Silure glane (Silurus glanis) est un poisson monstrueux qui peut dépasser 2,50 m de long et 130 kg © Giuseppe Mazza
Certaines espèces sont dotées d’organes respiratoires additionnels qui leur permettent d’utiliser l’oxygène atmosphérique et de survivre pendant une durée prolongée hors de l’eau. Des poissons-chats (Malapterurus Lacépede, 1803) ont aussi développé des organes capables de produire des décharges électriques à haut potentiel pouvant atteindre 350 volts.
De même, les habitudes des Siluriformes varient en fonction de leur mode de vie. La plupart des poissons-chats vivent en eau douce, pour autant un nombre important d’espèces se rencontrent dans les eaux marines et saumâtres. Certaines d’entre elles vivent essentiellement dans des grottes, comme Phreatobius cisternarum (Goeldi, 1905), petit poisson de 5 cm qui vit dans des habitats phréatiques superficiels à l’embouchure de l’Amazone.
L’ordre des Siluriformes regroupe un bon millier d’espèces, dont les plus représentatives sont évoquées ci-dessous.
Le Silure glane (Silurus glanis Linnaeus, 1758) est un poisson de grande taille qui peut dépasser 2,50 m et 130 kg.
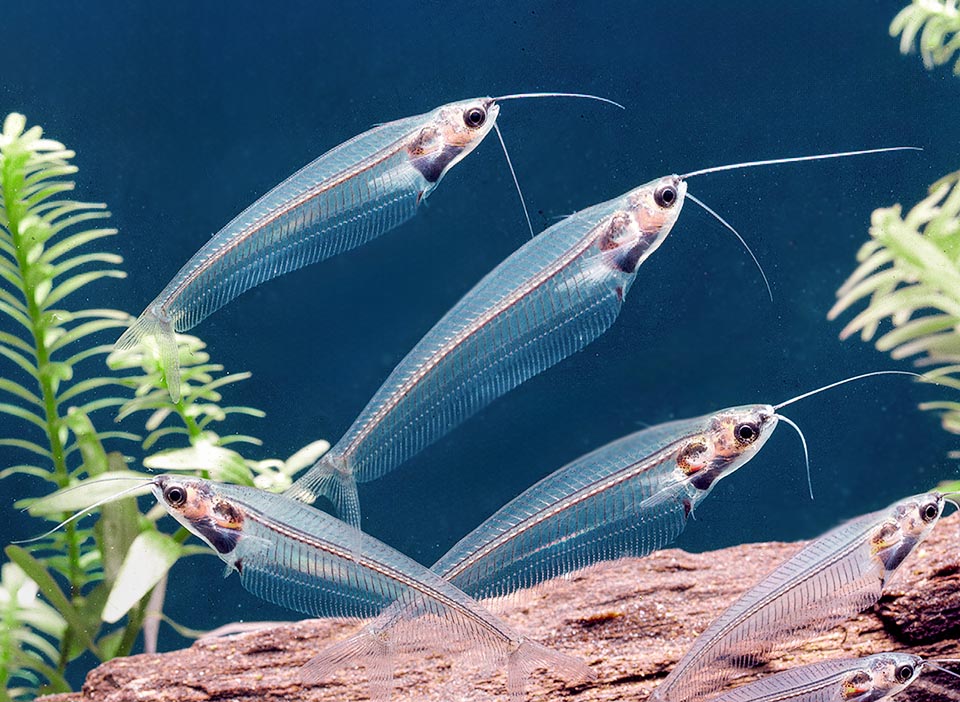
Le fragile et transparent Silure de verre (Kryptopterus bicirrhis), de moins de 15 cm de long et avec une seule paire de barbillons, appartient lui aussi à ce groupe © Giuseppe Mazza
Cette espèce exclusivement d’eau douce est originaire d’Europe centrale et orientale. Le Silure glane a été introduit dans un grand nombre de pays européens et, plus récemment, sur le continent américain, causant souvent de graves dommages à l’ichtyofaune locale.
La famille des Siluridae comprend également le Silure de verre, ou Silure de verre indien (Kryptopterus bicirrhis Valenciennes, 1840), courant dans les eaux calmes et les prairies inondées de l’Asie du Sud-Est.
Il s’agit d’un petit poisson d’environ 15 cm, qu’on appelle aussi Poisson-chat fantôme, en raison de la transparence totale de son corps.
La famille des Plotosidae regroupe une quarantaine d’espèces qui se distinguent par leur longue queue rappelant celle de l’anguille. Ces poissons mesurent environ 30 cm de long et sont originaires des eaux côtières du Pacifique occidental.

Les Siluriformes comptent aussi des espèces marines, comme le poisson-chat rayé (Plotosus lineatus) de l’Indopacifique tropical. Depuis la mer Rouge via le canal de Suez, il a gagné la Méditerranée. La première nageoire dorsale et les nageoires pectorales sont munies de dangereuses épines venimeuses, les piqûres peuvent être mortelles © Sebastiano Guido
Chez certaines espèces de Plotosidae, la première nageoire dorsale et les nageoires pectorales sont équipées d’épines venimeuses qui peuvent provoquer des lésions douloureuses.
En particulier, le Poisson-chat rayé, ou Balibot rayé (Plotosus lineatus Thunberg, 1787), inflige des piqûres qui peuvent être mortelles. Cette espèce, originaire des eaux tropicales du Pacifique et de l’océan Indien, est récemment arrivée en Méditerranée orientale.
Les Loricariidae ont un aspect très particulier. Cette famille compte près d’un millier d’espèces dont la plupart vivent dans les eaux douces aux courants turbulents, voire dans de véritables rapides, depuis les plaines jusqu’à 3 000 m d’altitude. Certains Loricariidae vivent dans des eaux saumâtres calmes, d’autres dans des habitats souterrains.
Originaires d’Amérique du Sud, les Loricariidae doivent leur nom scientifique à la présence sur leurs parties supérieures et leurs flancs d’une véritable carapace protectrice composée de plaques osseuses et d’écailles robustes disposées en 3-4 rangées longitudinales.

Le Pléco commun (Hypostomus plecostomus), quant à lui, est un ami précieux des aquariophiles car il nettoie parfaitement le verre des algues encroûtantes © G. Mazza
Mais la particularité anatomique la plus visible des Loricariidae est leur bouche en forme de ventouse aux grandes lèvres plates grâce auxquelles ils peuvent se fixer sur le substrat et se nourrir d’herbes et de détritus sans risquer d’être emportés par le courant.
Parmi les Loricariidae, il convient encore de mentionner le Pléco commun, Hypostome ou encore Laveur de vitres (Hypostomus plecostomus Linnaeus, 1758), l’un des premiers membres de la famille à avoir été introduit en aquarium, et le Silure aiguille ou Poisson brindille (Farlowella acus Kner, 1853), qu’on appelle aussi parfois Poisson-phasme. Ces deux espèces viennent des eaux douces tropicales d’Amérique du Sud.
Evoquons pour finir le Poisson-chat commun ou Greffier Barbicho (Ameiurus melas Rafinesque, 1820), espèce d’origine nord-américaine, aujourd’hui largement introduite dans de nombreuses régions du monde. Exceptionnellement résistant, ce poisson préfère les habitats d’eau douce à faible courant, mais il tolère également les environnements pollués et peut survivre plusieurs heures hors de l’eau. La longueur ordinaire du Poisson-chat commun est une trentaine de centimètres, mais elle peut dépasser les 50 centimètres.
Ordre des Osteoglossiformes

Avec le record de 4,5 m et 200 kg, Arapaima gigas est le plus grand poisson d’eau douce actuel. Il respire l’air atmosphérique en inspirant bruyamment à la surface © Giuseppe Mazza
Cet ordre d’Actinopterygii, les poissons osseux, inclut des espèces dont la principale caractéristique est de présenter une langue ossifiée ou dentée, d’où leur nom scientifique.
La taille et la forme des Osteoglossiformes sont très variables. Avec à peine 2 cm, Pollimyrus castelnaui (Boulenger, 1911) est le plus petit représentant de l’ordre, tandis que les Arapaima (J.P. Müller, 1843) sont des géants d’environ 3 m. Certaines espèces ont la capacité de produire de faibles champs électriques qui leur permettent de détecter la présence d’éventuelles proies. Certains Osteoglossiformes des familles Mormyridae et Gymnarchidae font partie des rares vertébrés dont le spermatozoïde est dépourvu de flagelle. Avec plus de 250 espèces, l’ordre des Ostéoglossiformes est largement répandu dans les eaux douces d’Amérique du Sud, d’Australie, d’Asie du Sud et d’Afrique.
Le Gymnarque du Nil (Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829), appelé aussi Aba, est la seule espèce connue de la famille des Gymnarchidae. Ce poisson est bien connu en Afrique où on le trouve dans le bassin du Nil et dans d’autres cours d’eau. Son corps long et mince est dépourvu de nageoires caudale et pelvienne et doté d’une nageoire dorsale très allongée.

Pouvant atteindre 165 cm, le Gymnarque du Nil (Gymnarchus niloticus) est commun dans le bassin du Nil. Sans caudale ni pelvienne, sa nageoire dorsale est bien visible © J.C. Harf, eigene Aufnahme
Sa taille est généralement de 1,5 m et son poids est légèrement inférieur à 20 kg.
On connaît les Mormyridae, famille d’Osteoglossiformes originaire d’Afrique, sous les noms communs de Poissons éléphants ou de Brochets du Nil. Cette famille compte plus de 200 espèces. Le nom de Poisson-éléphant fait référence à la présence d’excroissances charnues particulièrement proéminentes sur leur bouche.
Les Mormyridae sont des poissons faiblement électriques, fort hétérogènes en taille et en forme. Les plus petits ne mesurent que 5 cm de long, les plus grands atteignent 1,5 m. Plusieurs espèces de Mormyridae peuvent s’adapter à la vie en aquarium. Pollimyrus castelnaui (Boulenger, 1911) est un petit Mormyridae de seulement 2 cm qui vit dans les habitats d’eau douce fermés du centre-ouest du sud de l’Afrique.
Arapaima (J.P. Müller, 1843) est un genre d’Osteoglossiformes dont la composition spécifique n’est pas encore clairement définie, et dont les représentants comptent parmi les plus grands poissons d’eau douce du monde, atteignant parfois 3 mètres de long.

Le Poisson-éléphant (Gnathonemus petersii) atteint 35 cm. Sa trompe insolite dispose de nerfs tactiles et gustatifs. La queue émet un champ électrique utilisé comme radar © Giuseppe Mazza
Connus localement sous les noms de Pirarucu ou Paiche, qui signifie poisson rouge, les Arapaima sont originaires du bassin de l’Amazone et de l’Essequibo en Amérique du Sud.
L’un des traits distinctifs du genre est certainement la structure de la vessie natatoire, particulièrement bien développée et constituée d’un tissu qui, à l’instar d’un poumon, permet d’utiliser l’oxygène de l’air.
L’Arowana du Nil ou Arowana africain (Heterotis niloticus G. Cuvier, 1829) mesure jusqu’à 100 cm de long et pèse une dizaine de kilos ; son apparence est proche de celle des Arapaima. Originaire des bassins hydrographiques d’Afrique centrale, l’espèce a été introduite dans plusieurs autres bassins africains.
D’une grande importance nutritionnelle pour les populations locales, l’Arowana africain fait l’objet de pratiques aquacoles très performantes grâce à la facilité de son alimentation et à sa bonne tolérance à la densité.
Ordre des Batrachoidiformes

Sanopus splendidus est le plus élégant des Batrachoidiformes, les poissons-crapauds, présents plutôt sous les tropiques mais aussi en eaux tempérées © Allison & Carlos Estape
Cet ordre d’Actinopterygii regroupe des espèces dont la forme très inhabituelle rappelle celle d’un amphibien, d’où le nom scientifique de Batrachoidiformes, ainsi que le nom commun de Poissons-crapauds ou de Poissons-grenouilles.
La physionomie des Batrachoidiformes est incomparable, avec une tête large et aplatie et la partie postérieure du corps comprimée latéralement. Les yeux, assez gros, sont en position dorsale et très avancés.
La bouche est large et équipée de dents fortes et pointues. Sous la mâchoire se trouvent des protubérances dermiques ou barbillons qui ressemblent à ceux des rascasses. Chez certains, d’autres appendices cutanés entourent les narines. Chaque opercule branchial possède des épines et les écailles peuvent manquer ou être très petites. Il peut également exister deux lignes latérales et certaines espèces possèdent des organes bioluminescents (photophores).
La première nageoire dorsale est très courte et comporte des rayons épineux rigides, la seconde est longue et soutenue par des rayons mous. Les nageoires pectorales sont grandes et la nageoire caudale est arrondie. Une autre caractéristique très singulière des poissons-crapauds est leur capacité à produire des sons à l’aide de leur vessie natatoire.

Halobatrachus didactylus, présent mais rare en Méditerranée, peut atteindre 50 cm. Ce poisson benthique à tête large et plate, camouflée par des barbillons, ingère petits poissons, gastéropodes et vers polychètes. Isolé et sédentaire, on peut le rencontrer pendant la période de reproduction, où il émet des sons forts avec sa vessie natatoire © Ana Santos
Poissons de taille petite à moyenne, d’une longueur maximale d’environ 60 cm, les Batrachoidiformes présentent généralement une livrée uniforme allant du brun au verdâtre. Cependant, les espèces aux couleurs vives ne manquent pas, comme le Poisson-crapaud corail ou Poisson-crapaud de Cozumel (Sanopus splendidus Collette et alii, 1974), dans les récifs coralliens de la mer des Caraïbes.
Avec près d’une centaine d’espèces, les Batrachoidiformes sont présents dans toutes les mers tropicales et, de façon plus marginale, dans les mers tempérées. Ils sont particulièrement fréquents dans les eaux américaines. Poissons benthiques et prédateurs, les poissons-crapauds vivent généralement en eaux côtières sur des fonds durs ou vaseux, et sont également présents dans les récifs coralliens.
Certaines espèces sont euryhalines et vivent également en eaux saumâtres. D’autres poissons-crapauds sont dulçaquicoles en permanence. Le Poisson-crapaud lusitanien (Halobatrachus didactylus Bloch & Schneider, 1801), qui peut mesurer 50 cm de long, est présent mais rare en Méditerranée. Il se reconnaît à la présence de quatre taches dorsales sombres en forme de selle sur une livrée dont la couleur varie du brun rougeâtre au jaune en passant par le vert.
Ordre des Gadiformes
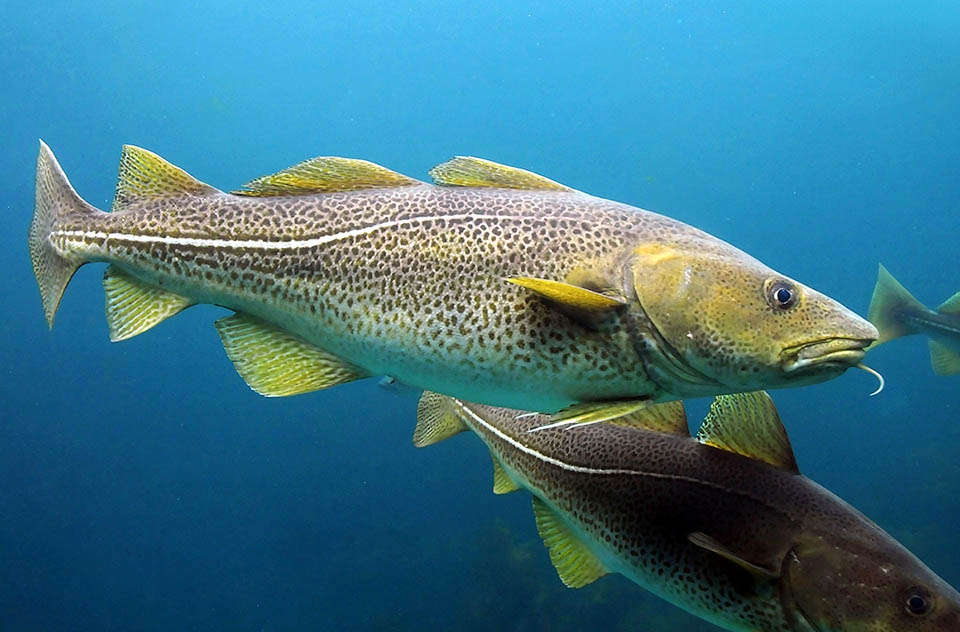
Pouvant atteindre 2 m, le Cabillaud (Gadus morhua) est le plus grand des Gadiformes, poissons surtout marins aux nageoires pelviennes avancées, à hauteur des pectorales © Joachim S. Müller
Également appelés Anacanthini à cause de l’absence de rayons spiniformes, les Gadiformes constituent un ordre dont les espèces se distinguent notamment par la structure unique et variée de leurs nageoires.
En effet, contrairement aux formes les plus évoluées chez lesquelles la nageoire caudale est clairement séparée, les espèces les plus primitives présentent des nageoires dorsale, caudale et anale réunies pour former une structure continue comme chez les Anguilliformes.
Au sein de cet ordre, les Bregmacerotidae se distinguent principalement par la présence d’un long rayon épineux sur la première nageoire dorsale, qui dépasse la tête comme une sorte de corne.
Les nageoires ventrales portent souvent de très longs rayons filamenteux et les nageoires pelviennes, lorsqu’elles sont présentes, sont généralement placées devant ou sous les nageoires pectorales. La queue est courte et fourchue.

La Morue du Pacifique (Gadus macrocephalus) atteint 1 m de long. Dans les eaux nordiques, elle vit en bancs entre 100 et 400 m de profondeur et peut descendre à 1280 m © Gregory C Jensen
Les Gadiformes sont des poissons physoclistiques, c’est-à-dire qu’ils possèdent une vessie natatoire qui ne communique pas avec le système digestif.
Les Gadiformes comprennent de nombreuses espèces, distribuées surtout dans les eaux marines des régions froides ou tempérées. En Méditerranée, les Gadiformes ne comptent que peu d’espèces, certaines divisées en sous-espèces.
D’une grande valeur écologique, ils sont largement présents dans divers environnements, côtiers comme abyssaux. Certaines espèces vivent dans les eaux saumâtres des estuaires, d’autres sont dulcicoles en permanence.
Les espèces tropicales sont typiquement d’eau profonde.
Seule la Lotte de rivière, ou Lote (Lota lota Linnaeus, 1758) est considérée avec certitude comme un poisson d’eau douce.

Le Merlan bleu (Micromesistius poutassou) peut atteindre 1000 m. Fréquent dans l’Atlantique et la Méditerranée, on le reconnaît à sa petite bouche et à ses grands yeux © Vsevolod Rudyi
De nombreuses espèces de Gadiformes sont comestibles et ont une grande valeur commerciale.
Compte tenu du grand nombre d’espèces de Gadiformes, on présentera ci-après de brèves informations sur les espèces les plus représentatives de l’ordre. On trouvera pour certaines plus d’informations dans les articles correspondants de l’Encyclopédie. Plusieurs espèces appartenant à différents genres, notamment Gadus, sont désignées par le nom générique de Morue, ou Cabillaud.
La Morue de l’Atlantique (Gadus morhua Linnaeus, 1758), appelée aussi communément Cabillaud ou Morue franche et commercialement appelée “morue”, est sans aucun doute l’un des poissons les plus importants pour la consommation humaine dans le monde entier. La morue est soit séchée (stockfish), soit salée et séchée (codfish).
D’ autres espèces du genre sont la Morue du Groenland (Gadus ogac Richardson, 1836) et la Morue du Pacifique (Gadus macrocephalus Tilesio, 1810).

Le Capelan (Trisopterus minutus) est un poisson de taille modeste inférieure à 25 cm, présent dans l’Atlantique Nord-Est © Sylvain Le Bris
Le Merlan argenté (Gadiculus argenteus Guichenot, 1850) est un petit poisson de mer ne dépassant habituellement pas 9 cm de long. Il se caractérise par une tête et des yeux très gros, une bouche oblique et la présence de 3 petites nageoires dorsales. La livrée est gris-rose sur les parties dorsales, argentée sur les flancs et le ventre. Le Merlan argenté vit dans les eaux profondes, généralement au-delà de 200 m de profondeur.
Le Merlan (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758) peut atteindre une longueur de 50 cm. Son museau est proéminent et sa bouche, petite. Il possède trois nageoires dorsales contiguës, dont la centrale est plus développée. La livrée du Merlan est brune sur le dos, blanchâtre sur le ventre.
Largement répandue dans l’Atlantique, cette espèce est également présente dans la mer Noire et l’Adriatique. Elle vit généralement sur des fonds meubles où elle se nourrit de petits poissons et de crustacés comme la Crevette grise (Crangon crangon Linnaeus, 1758), à la raréfaction de laquelle elle est réputée contribuer fortement.
Le Merlan bleu (Micromesistius poutassou Risso, 1827) est largement répandu dans l’Atlantique ainsi qu’en Méditerranée.

L’aire de répartition du Lieu jaune ou Pollak (Pollachius pollachius), qui atteint jusqu’à 130 cm, s’étend au nord jusqu’en Islande © trece_grados
Appelé aussi Poutassou, le Merlan bleu est un Gadiforme d’environ 25 cm qui se distingue par sa petite bouche et ses gros yeux. Poisson pélagique, le Merlan bleu vit en pleine mer à des profondeurs comprises entre 100 et 1000 m.
Le Capelan de l’Atlantique ou Capelan (Trisopterus minutus Linnaeus, 1758), encore appelé Petit tacaud, se distingue par un petit barbillon sous la bouche et par deux nageoires anales bien séparées. Le Capelan est un poisson de taille modeste, moins de 25 cm, dont le corps est uniformément brun jaunâtre sur la face dorsale, argenté sur les côtés et blanc sur la face ventrale.
On trouve cette espèce dans l’océan Atlantique et dans la partie occidentale de la Méditerranée. Elle forme généralement des bancs qui vivent sur des fonds vaseux à des profondeurs variées.
Le Tacaud commun (Trisopterus luscus Linnaeus, 1758) est une espèce de l’Atlantique Nord dont la présence dans les eaux méditerranéennes est à confirmer.

D’environ 50 cm, le Mora (Mora moro) est un Gadiforme abyssal des fonds sableux, généralement au-delà de 1000 m. Un court barbillon est présent sur la mandibule © jgrimshawl
Le Merlu européen ou Merlu commun (Merluccius merluccius Linnaeus, 1758) se reconnaît à sa bouche largement incisée et rectiligne, armée de dents fortes et saillantes et d’une mandibule plus longue que la mâchoire. Le corps du Merlu européen est élancé et peut atteindre 140 cm et 15 kg. La livrée prend des tons sombres sur le dos, argentés sur les flancs. Ce poisson vit dans les eaux de l’Atlantique Est, de la Méditerranée et de la mer Noire, où il fréquente les fonds vaseux ou sablonneux, même par des profondeurs inférieures à 400 mètres.
Le Lieu jaune (Pollachius pollachius Linnaeus, 1758) est un Gadiformes vivant dans les eaux de l’Atlantique Nord-Est, à des profondeurs inférieures à 100 mètres.
Très proche en apparence du Lieu noir (Pollachius virens Linnaeus, 1758) avec lequel il partage une partie de son aire de répartition, le Lieu jaune atteint ou dépasse les 120 cm de long et présente une livrée uniforme de couleur bronze sur les parties dorsales et blanchâtre sur les parties ventrales. Le museau est pointu et la mâchoire largement saillante.

Long de 40 à 50 cm, la Mostelle de roche (Phycis phycis) est un Gadiforme de Méditerranée et des côtes de l’Atlantique-Est, entre la France, l’Espagne et la Macaronésie © Bernat Espigulé
L’Aiglefin, Églefin ou Èglefin (Melanogrammus aeglefinus Linnaeus, 1758), est d’apparence très proche de la Morue de l’Atlantique (Gadus morhua Linnaeus, 1758), dont il diffère cependant par un corps plus haut, une tête plus massive et des yeux nettement plus gros. Un petit barbillon se trouve sous la bouche. Il y a trois nageoires dorsales et la nageoire anale est large.
La couleur de la livrée varie de l’argenté au verdâtre sur le dos, avec une tache noire ronde caractéristique au niveau des nageoires pectorales. Il est généralement plus petit que la Morue de l’Atlantique mais peut mesurer jusqu’à un mètre.
L’aire de répartition de ce poisson comprend l’Atlantique Nord, où il vit dans des eaux fraîches à fond sablonneux ou caillouteux. Il se nourrit d’invertébrés marins et de petits poissons.
Le Moro commun ou Mora (Mora moro Risso, 1810) est un Gadiformes qui se distingue par ses très gros yeux de couleur argentée.
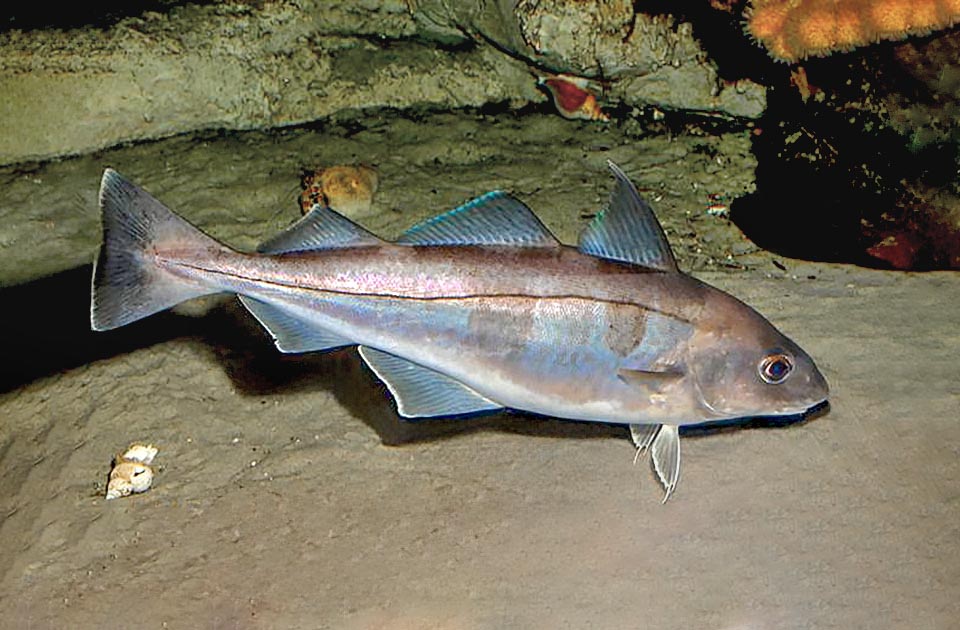
L’Aiglefin (Melanogrammus aeglefinus) est un poisson similaire au Cabillaud, mais au corps plus haut et aux yeux nettement plus grands © Biopix
Son corps allongé, d’une longueur moyenne de 50 cm, se rétrécit postérieurement au niveau du pédoncule caudal. Un court barbillon est présent sur la mandibule. Les nageoires dorsales sont au nombre de deux, l’antérieure étant légèrement plus haute que la postérieure et de forme triangulaire. La livrée est brunâtre à reflets argentés sur le dos et les flancs, plus foncée sur le ventre.
Il s’agit d’un poisson des abysses qui fréquente les fonds sableux en eaux profondes, à plus de 1 000 mètres en général. Le Mora est répandu dans une vaste zone qui comprend l’Atlantique nord-oriental, la Méditerranée occidentale et les régions tempérées de l’océan Pacifique et de l’océan Indien.
La Mostelle de roche (Phycis phycis Linnaeus, 1766) est un Gadiformes de taille moyenne, environ 40 à 50 cm.
D’apparence similaire à de nombreux autres représentants de l’ordre, la Mostelle de roche se distingue par une bouche large aux lèvres épaisses. La livrée est uniformément foncée, brune ou grise.

La Lote de rivière (Lota lota) des eaux douces arctiques et des grands lacs préalpins d’Europe du Nord, est le seul Gadiforme dulcicole à être élevé © lindra
La Mostelle de roche est très présente en Atlantique Nord-Est sur les fonds sableux ou caillouteux jusqu’à environ 60 m de profondeur.
La Lote de rivière (Lota lota Linnaeus, 1758) est la seule espèce de l’ordre dont les mœurs dulçaquicoles sont certaines. C’est un poisson au corps très allongé, d’une taille moyenne de 100 cm, parfois même 180 cm et pesant plus de 30 kg. La bouche est très grande avec un barbillon sur la mâchoire. Les nageoires dorsales sont généralement au nombre de deux, la nageoire antérieure étant courte et la nageoire postérieure très allongée.
La livrée est de couleur marbrée allant du brun au vert en passant par le jaune sur le dos, blanchâtre sur le ventre.
La Lote de rivière est largement diffusée dans les eaux douces des régions arctiques et peut être observée dans les grands lacs préalpins d’Europe du Nord, y compris l’Italie.
Ordre des Lophiiformes
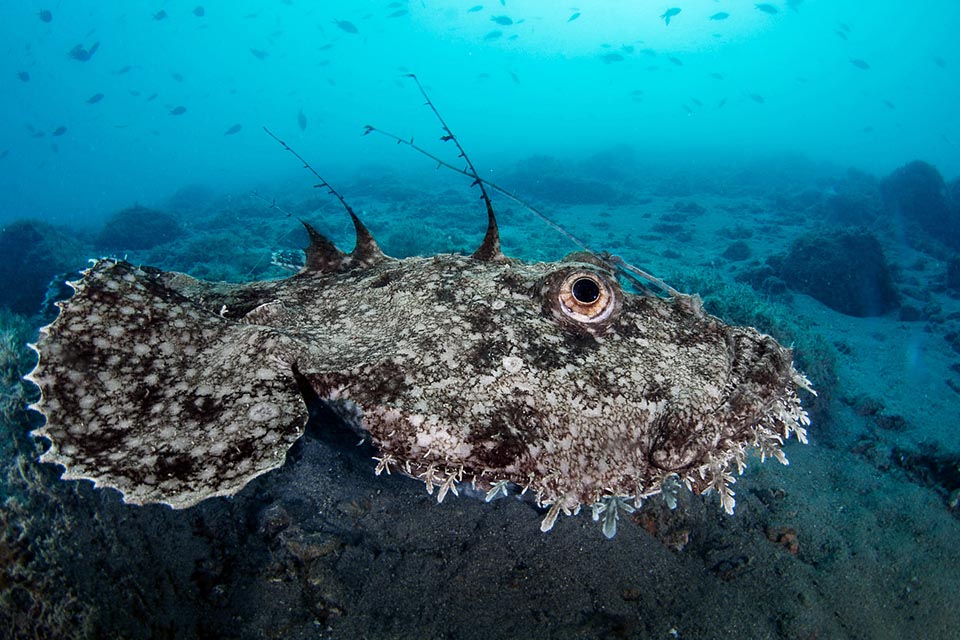
La baudroie (Lophius piscatorius) atteint 2 m de long. Elle vit dans l’Atlantique Est, la Méditerranée et la mer Noire, et est le plus grand des Lophiiformes actuels © Pietro Formis
Les espèces de cet ordre d’Actinopterygii se caractérisent par la présence d’un appendice charnu ou d’une antenne mobile sur le front, l’illicium. Il s’agit d’une structure bioluminescente qui leur permet d’attirer les proies dont ils se nourrissent. La tête est large et ornée de crêtes osseuses et d’épines, avec une large bouche armée de nombreuses dents pointues. Le corps des Lophiiformes est dépourvu d’écailles. Une autre caractéristique de nombreux Lophiiformes est leur capacité de distendre leur mâchoire et leur estomac, particulièrement élastiques, ce qui leur permet d’avaler des proies faisant jusqu’au double de leurs propres dimensions. Les Lophiiformes sont également reconnus pour leur dimorphisme sexuel marqué, les mâles étant considérablement plus petits que les femelles. Une autre particularité de plusieurs espèces de ces poissons singuliers est le phénomène du parasitisme sexuel. Pendant la reproduction, le mâle s’attache à la femelle et, tout en lui transmettant son sperme, il se nourrit du corps de sa compagne.
Présents dans tous les océans, la plupart des Lophiiformes se trouvent à des profondeurs de 1 000 m et plus. On en compte actuellement environ 350 espèces, regroupées en 18 familles, dont certaines sont brièvement présentées ci-après.
Famille des Antennariidae – Les Poissons-grenouilles

Antennarius multiocellatus. Les Antennarius utilisent le pelvis comme patte pour se déplacer, parfois en sautillant sur le fond, d’où peut-être le nom de poisson grenouille © Allison & Carlos Estape
Couramment appelés Poissons-grenouilles, ces animaux composent une famille à laquelle on attribue des espèces marines au corps trapu, sphérique et comprimé latéralement ; la bouche relevée vers le haut contient 2 à 4 rangées plus ou moins irrégulières de petites dents hérissées sur les mâchoires supérieures et inférieures.
Il y a trois épines sur la tête dont l’antérieure, libre et mobile, est transformée en leurre (illicio).
Les yeux sont petits et placés latéralement. Les nageoires pectorales saillantes servent à se déplacer entre les coraux et sur les rochers.
L’ouverture branchiale en forme de tube est utilisée comme organe de propulsion par jet.
Animaux benthiques jusqu’à environ 300 m, ces poissons ont une livrée mimétique avec le milieu, dont la couleur varie du rouge à l’orange en passant par le jaune.

Leur illicium, véritable ligne de pêche appâtée, remue de haut en bas à la vue d’un petit poisson. Cet appendice attire le poisson, dévoré ensuite en entier © Giuseppe Mazza
Les femelles de beaucoup d’espèces pondent des milliers d’œufs immergés en une masse gélatineuse flottante ; chez d’autres espèces, en revanche, les femelles portent les œufs attachés à leur corps.
Avec une cinquantaine d’espèces, les Antennariidae sont présents dans toutes les mers tropicales et subtropicales, à l’exception de la Méditerranée. Ils vivent de préférence sur des fonds coralliens et rocheux, jusqu’à 300 mètres de profondeur, .
Voici les espèces les plus connues de la famille.
Le Poisson grenouille de Commerson ou Poisson grenouille géant (Antennarius commerson Lacépède, 1798) est un poisson euryhalin qui peut atteindre 45 cm. On le trouve dans l’océan Indien et dans le Pacifique oriental.
Comme les autres poissons-grenouilles, le Poisson-grenouille de Commerson pond des œufs encapsulés dans une masse muqueuse flottante, dite “radeau d’oeufs”.

Tel cet Antennarius striatus, ces poissons ont une bouche énorme et un estomac extensible qui leur permet d’avaler des proies deux fois plus grosses qu’eux © Sebastiano Guido
Le Poisson crapaud à longue ligne (Antennarius multiocellatus Valenciennes, 1837), ou Antennaire à longue ligne, se distingue par son corps recouvert d’écailles modifiées en spicules dermiques qui lui donnent un aspect verruqueux rappelant quelque peu les verrues d’un crapaud.
La livrée est très variable, mais toujours utilisée pour le camouflage. La couleur de fond peut varier du rouge au jaune, au vert foncé, au brun, avec des taches noires éparses et divers motifs ocellaires, qui imitent les oscules des éponges avec lesquelles ce poisson se mêle, et ont inspiré le nom scientifique. Dans certaines circonstances, ce poisson peut prendre une coloration presque entièrement noire. Le Poisson crapaud à longue ligne vit dans les eaux de l’Atlantique ouest.
Le Poisson-grenouille strié (Antennarius striatus Shaw, 1794) est un Antennariidae qui peut atteindre environ 25 cm. Il se distingue par son corps couvert d’épines dermiques fines et fourchues évoquant des poils, d’où son nom commun de Poisson-grenouille poilu.
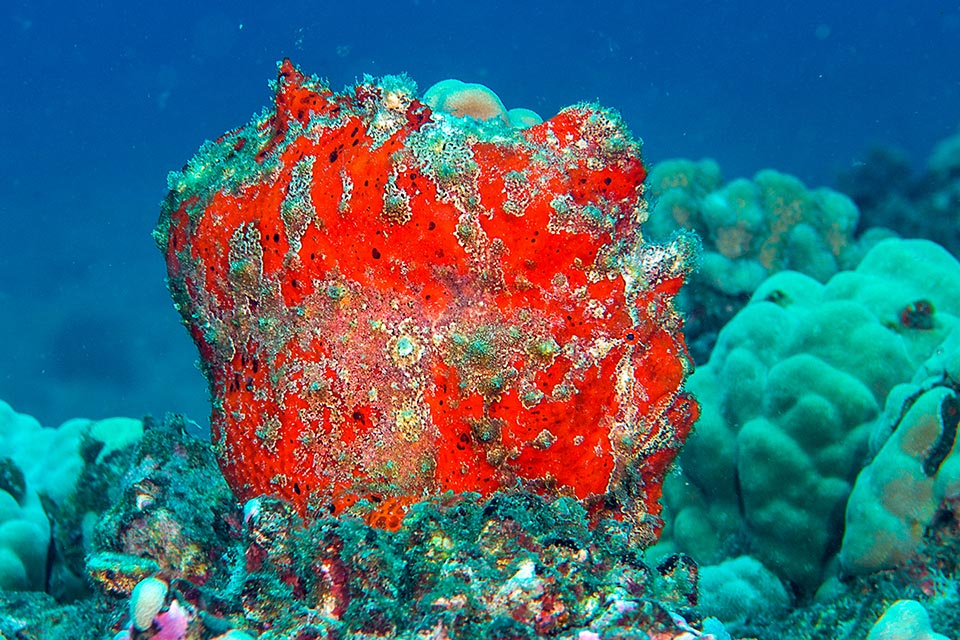
Ils savent se camoufler : ce Poisson grenouille géant (Antennarius commerson) peut prendre n’importe quelle couleur et n’importe quelle forme comme, ici, une éponge © Keoki Stender
Le nom spécifique provient de la présence d’un certain nombre de stries subparallèles se ramifiant à l’arrière de chaque œil.
On trouve ce poisson dans l’Atlantique oriental, dans des milieux associés aux récifs coralliens.
Une autre espèce congénère est l’Antennaire peint (Antennarius pictus Shaw, 1794), poisson de la famille des Antennariidae appelé aussi Poisson-grenouille peint ou encore Poisson-crapaud peint.
Mesurant habituellement un peu moins de 30 cm, il s’agit d’une espèce des eaux indo-pacifiques caractérisé par un corps partiellement recouvert de quelques excroissances verruqueuses ; de nombreux motifs ocellaires imitent les oscules des éponges avec lesquelles ce poisson se confond. L’Antennaire peint vit dans les récifs coralliens des eaux des océans Pacifique et Indien.
Famille des Lophiidae – Baudroies

Lophius budegassa, qui peut atteindre 1 m de long, est une espèce comparable au Diable des mers, dont l’aire de répartition est proche © Luis Pérez Berrocal
Il s’agit d’une famille de Lophiiformes dont les membres sont communément appelés Crapauds de mer, ou Baudroies.
Cette famille compte 30 espèces répertoriées et est présente dans toutes les mers, tempérées, subtropicales et tropicales, à l’exception de l’Antarctique. L’espèce la plus connue de la famille et de l’ordre est certainement la Baudroie (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758). Également appelée Lotte, la Baudroie se caractérise par sa grande bouche tournée vers le haut ; la mâchoire inférieure fait saillie par rapport à la mâchoire supérieure et est pourvue d’une frange d’appendices cutanés. La bouche est équipée de nombreuses dents pointues. La livrée est essentiellement brun verdâtre sur les parties dorsales, blanche sur les parties ventrales. Les nageoires sont bordées d’un liseré sombre. La taille atteint généralement 90 cm chez la femelle, avec un record à 2 m, et un peu plus de la moitié chez le mâle.
La Baudroie se trouve en Mer du Nord, dans l’Atlantique Est, en Méditerranée et en Mer Noire, où elle affectionne les fonds sablonneux et caillouteux entre 20 et 1000 mètres de profondeur. Une autre espèce, Lophius budegassa (Spinola, 1807), est un poisson très similaire à la Baudroie avec laquelle il partage son aire de répartition.
Famille des Ogcocephalidae – Poissons chauves-souris

Les poissons chauves-souris ne sont pas beaux. Cet Ogcocephalus nasutus, avec ses quatre pattes et sa corne, évoque davantage un rhinocéros qu’un poisson © Mickey Charteris
Souvent appelés Poissons chauves-souris en raison de leur apparence singulière rappelant celle des raies, les Ogcocephalidae constituent une famille de Lophiiformes dont les membres sont pour la plupart adaptés aux mœurs benthiques, d’où le nom commun de Chauves-souris des profondeurs. Il faut cependant noter que certaines espèces se rencontrent dans les eaux côtières peu profondes ou dans les estuaires.
Le Poisson chauve-souris à ventre rouge, Poisson chauve-souris unicorne ou Diable de mer (Ogcocephalus nasutus Cuvier, 1829), est une espèce des grands fonds de l’ouest de l’océan Atlantique et des Caraïbes, où il préfère les fonds sableux ou vaseux avec des détritus ou des herbiers marins.
Ce poisson, qui peut mesurer un peu moins de 40 cm, doit son nom de genre à la forme presque crochue de sa tête, tandis que son nom spécifique fait allusion au rostre pointu de son museau.
La tête est aplatie et le reste du corps est déprimé et de forme triangulaire.

Le Poisson-chauve-souris à pois (Ogcocephalus radiatus) n’est guère plus attrayant. Son illicium est si court que les proies doivent presque rejoindre sa gueule © G. Mazza
La couleur de la livrée varie du noirâtre au gris, en passant par le rougeâtre sur les parties dorsales, parfois ornées de taches sombres et claires. Les femelles de ce poisson pondent leurs œufs, à partir desquels se développent des larves nageuses qui se déposent sur le fond et se transforment en formes juvéniles.
Une autre espèce de la famille et du genre est le Poisson-chauve-souris à pois (Ogcocephalus radiatus Mitchell, 1818), qui mesure un peu moins de 38 cm et est originaire de la côte atlantique.
Semblable à une raie, le corps du Poisson-chauve-souris à pois est large, déprimé et en forme de flèche.
De mœurs benthiques, il préfère les fonds marins où il se nourrit de crustacés, de mollusques et même de jeunes poissons, qu’il attire à l’aide d’une substance contenue dans son rostre.
Ordre des Ophidiiformes

Les Ophidiiformes rassemblent des espèces au corps très allongé, presque en forme d’anguille. Leur tête est généralement petite, leur corps recouvert d’écailles lisses ou inexistantes. L’Aurin (Carapus acus), particulièrement élancé et long de moins de 10 cm, vit en parasite dans le tube digestif des Echinodermes © Xavier Rufray
Longtemps considérés comme un sous-ordre parmi les Perciformes, les Ophidiiformes sont aujourd’hui reconnus comme un ordre distinct d’Actinoptérygiens dont les espèces ont typiquement un corps allongé, presque en forme d’anguille. Le corps des poissons Ophidiiformes est généralement recouvert d’écailles lisses ; elles peuvent aussi être inexistantes. La tête est de petite taille. Les nageoires dorsales sont longues, la nageoire anale est généralement très longue et se prolonge par la nageoire caudale. Les nageoires ventrales, absentes chez certaines espèces, sont implantées très antérieurement et évoquent souvent des barbillons.
La taille des Ophidiiformes est très variable, allant de 5 cm pour Grammanopides opisthodon, Smith 1934, à environ 2 m pour la Donzelle grand peigne (Lamprogrammus shcherbachevi Cohen & Rohr, 1933). Les Ophidiiformes sont largement répartis dans les eaux marines tropicales et subtropicales, souvent en eaux profondes. Certaines espèces colonisent les eaux souterraines dans les grottes, d’autres sont présentes dans les eaux douces. En Méditerranée sont signalés la Donzelette de Allen (Cataetyx alleni Byrne, 1906), poisson abyssal d’à peine plus de 10 cm, l’Aurin (Carapus acus Brünnich, 1768), très longiligne, ne dépassant pas 10 cm et vivant en parasite dans le tube digestif des Échinodermes, et le Fanfre jaune (Benthocometes robustus (Goode et Bean, 1886), qui atteint une longueur maximale de 15 cm.

Avec ses 20-25 cm de long, la Donzelle à nageoire noire (Parophidion vassali), de Méditerranée et des régions atlantiques adjacentes, fait figure de géante © Sylvain Le Bris
D’autres Ophidiiformes vivent en Méditerranée : la Donzelle à nageoire noire (Ophidion barbatum Linnaeus, 1758) et la Donzelle à nageoires rouges ou Donzelle dorée (Parophidion vassali Risso, 1810), qui mesurent tous deux environ 25 cm.
Ordre des Percopsiformes
Originaires des eaux douces d’Amérique du Nord, les Percopsiformes sont considérés comme un ordre de poissons Actinoptérygiens dont le nom scientifique renvoie à la ressemblance de ses représentants avec la Perche, mieux connue (Linnaeus, 1758). Bien représenté depuis le Crétacé supérieur (il y a 70 à 66 millions d’années), cet ordre est aujourd’hui considéré comme presque totalement éteint : il n’en subsiste qu’une douzaine d’espèces.
En général, les Percopsiformes sont de petits poissons, longs de 5 à 20 cm selon les espèces, et dont l’apparence variée rappelle quelque peu la Perche de l’ordre des Perciformes. On les trouve principalement dans les milieux d’eau douce d’Amérique du Nord, mais quelques espèces ont une distribution boréale. Aphredoderus sayanus Gilliams, 1824 est un Percopsiformes fréquent dans les eaux côtières de l’est des États-Unis, prédateur connu des larves de moustiques.

Il reste une douzaine d’espèces de Percopsiformes, communs au Crétacé. Aphredoderus sayanus est un prédateur de larves de moustiques et vit aux États-Unis © Michaeln Zambardino
Typhlichthys subterraneus Girard, 1859 est une espèce exclusive des grottes karstiques de l’est des États-Unis.
Le Poisson des cavernes de l’Alabama (Speoplatyrhinus poulsoni Cooper & Kuehne, 1974) a été trouvé dans des bassins souterrains de la réserve naturelle nationale de Key Cave en Alabama.
On classe également dans l’ordre des Percopsiformes le Poisson des marécages (Chologaster cornuta Agassiz , 1853), espèce d’environ 4 cm présente dans les eaux douces de la plaine côtière atlantique des États-Unis.
Ordre des Polymixiiformes
Ne sont afférentes à cet ordre d’Actinoptérygiens qu’une douzaine d’espèces de l’unique genre Polymixia. Ce sont des poissons de petite taille, allant d’un peu plus de 15 cm à environ 45 cm, avec de gros yeux et une grande bouche, une paire de longs barbillons et de petites nageoires.

Voici un autre survivant,Typhlichthys subterraneus. Il vit dans les grottes karstiques de l’est des États-Unis © Sunguramy
Les Polymixiiformes, répartis dans tous les océans et en Mer Rouge, sont connus pour avoir le corps recouvert d’un mucus abondant, d’où leur nom scientifique. Le Poisson-barbe du Pacifique (Polymixia berndti Gilbert, 1905) est l’un des représentants les plus connus de cet ordre. Il s’agit d’un poisson dont la taille peut atteindre 45 cm et que l’on trouve dans les océans Pacifique et Indien.
Ordre des Esociformes
Au sein des Actinopterygii, cet ordre des Esociformes regroupe des poissons morphologiquement et écologiquement très diversifiés qui se caractérisent principalement par des nageoires dorsale et anale quelque peu en retrait et l’absence d’une nageoire adipeuse. La taille des Esociformes est également très variable, allant d’environ 8 cm pour le Poisson chien à environ 1,40 cm pour le Brochet.
L’ordre regroupe une douzaine d’espèces, toutes vivant en eau douce, dont la plupart, appelées brochets, relèvent du genre Esox, que l’on trouve dans les rivières et les lacs d’Amérique du Nord et d’Europe. En Europe, il existe plusieurs espèces de Esociformes dont la plus connue est le Brochet.

Le Poisson des marécages (Chologaster cornuta), des eaux douces de la plaine côtière atlantique des États-Unis, est lui aussi membre des Percopsiformes © Daniel Folds
Le Brochet (Esox lucius Linnaeus,1758) est caractérisé par sa grosse tête aplatie en bec de canard, ce qui lui vaut aussi l’appellation de Bec de canard dans certaines régions. Sa grande bouche est armée de dents nombreuses, fortes et crochues (plusieurs centaines), qui existent également sur la langue. Le brochet peut mesurer jusqu’à 1,40 m de long et peser plus de 20 kg. La livrée est variée, le plus souvent brun verdâtre avec des taches sombres sur les parties dorsales, blanc jaunâtre sur les parties ventrales.
Largement présent en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Eurasie, le Brochet a fait l’objet d’introductions répétées pour la pêche sportive, entraînant une hybridation et menaçant ainsi l’ichtyofaune locale. L’Amérique du Nord abrite aussi le Maskinongé ou Muskie (Esox masquinongy, Mitchil, 1824), le plus grand des poissons prédateurs du Mississipi. Le Brochet joue un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, d’une part parce qu’il se nourrit préférentiellement de proies mortes, affaiblies ou souffrantes, et d’autre part parce qu’il limite la prolifération d’autres poissons, en particulier les Cyprinidae.
Les autres espèces européennes du genre sont le Brochet cisalpin ou Brochet italien (Esox cisalpinus Bianco & Delmastro, 2011), espèce endémique du nord de l’Italie qui affectionne les eaux stagnantes ou les habitats à faible courant, et le Brochet aquitain (Esox aquitanicus Denys et alii, 2014), originaire des bassins versants de la Charente et de l’Adour, au sud-ouest de la France.

Les Esociformes regroupent les poissons d’eau douce, tels que le brochet (Esox lucius), dont les nageoires dorsale et anale sont placées en arrière © Giuseppe Mazza
Enfin, le Poisson chien (Umbra krameri Walbaum, 1792), petit poisson d’un peu plus de 15 cm de long, est une autre espèce de cet ordre. Originaire du bassin du Danube, ce poisson a été introduit dans diverses régions d’Europe au cours du siècle dernier.
Ordre des Osmeriformes
Longtemps inclus parmi les Salmoniformes, les Osmeriformes sont aujourd’hui élevés au rang d’ordre au sein des Actinopterygii. Les Osmeriformes regroupent des espèces d’apparence et de biologie très variées et possèdent généralement une nageoire adipeuse. Largement répartis dans les deux hémisphères, à l’exception des zones tempérées et chaudes, les Osmeriformes se rencontrent dans les milieux marins, saumâtres et dulcicoles. Certains vivent également en eaux profondes. Les espèces côtières migrent généralement vers les rivières pour se reproduire (anadromes).
L’Éperlan européen (Osmerus eperlanus Linnaeus, 1758) est un poisson de petite taille, d’une vingtaine de centimètres en moyenne, commun dans les eaux côtières européennes de l’océan Atlantique.

En Amérique du Nord, le Maskinongé (Esox masquinongy) est le plus grand des poissons prédateurs du Mississippi. Il joue un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, parce qu’il se nourrit généralement de proies affaiblies ou malades, et parce qu’il limite la prolifération excessive de poissons comme les Cyprinidae © Engbretson, Eric U.S. Fish and Wildlife Service
Neosalanx tangkahkeii Wu, 1931 est une espèce d’à peine 6 cm de long qui vit dans les eaux saumâtres, tropicales ou subtropicales de Chine.
Parmi les Osmeriformes, citons enfin Opisthoproctus soleatus (Vaillant, 1888), poisson des océans Pacifique, Indien et Atlantique, où il vit généralement entre 500 et 700 mètres de profondeur. Il mesure une dizaine de centimètres de long.
Ordre des Salmoniformes
Ordre important de Poissons Actinopterygii, les Salmoniformes comptent de nombreuses espèces, tant marines que dulcicoles, souvent caractérisées par la présence de deux nageoires dorsales, dont la seconde est adipeuse.
Communément connus sous les noms de saumon, truite, corégone, lennok et autres, les Salmoniformes sont des poissons au corps généralement allongé et fusiforme, dont la taille varie entre un peu plus de 10 cm et plus de 1 m.

L’Ombre commun (Thymallus thymallus) est un Salmoniformes, ordre d’espèces marines et dulcicoles, souvent caractérisées par une deuxième nageoire dorsale adipeuse © Thomas Menut
L’apparence est également très variable. La bouche de nombreuses espèces, comme le Saumon et la Truite, est très grande et abondamment garnie de grandes dents également présentes sur la langue ; chez d’autres espèces, comme l’Ombre commun (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758), elle est petite et munie de dents minuscules.
Il y a deux nageoires dorsales, dont la postérieure est adipeuse. La nageoire caudale, généralement grande, peut avoir une marge fourchue ou tronquée.
Chez les Salmoniformes, les nageoires ventrales sont très en arrière, parfois postérieures à la première nageoire dorsale. La nageoire caudale peut être fourchue ou tronquée.
La livrée de la plupart des Salmoniformes est caractérisée par de petites taches et points noirs et rouges, parfois avec des reflets métalliques. Les Corégones ont un corps uniformément de couleur argentée.

Le genre Coregonus compte plus de 70 espèces, surtout des eaux douces et froides de l’hémisphère nord. Coregonus lavaretus, le Lavaret ou Corégone lavaret est apprécié pour la grande qualité de sa chair. Il a été introduit en Italie à la fin des années 1900, il y est aujourd’hui commun dans les lacs du nord et du centre © Thomas Menut
Les Salmoniformes sont principalement distribués en mer, dans les rivières et les lacs de l’hémisphère nord, dans les régions tempérées et froides et jusqu’aux régions polaires. Ils ont aussi été introduits en abondance dans les zones présentant des conditions environnementales adéquates. Ces poissons peuvent être carnivores, certains comme le Saumon s’attaquent à d’autres poissons, d’autres comme l’Ombre se nourrissent d’insectes, et d’autres encore sont planctonophages.
Les Salmoniformes sont généralement des poissons sténothermes, qui préfèrent les eaux froides et bien oxygénées. De nombreuses espèces sont anadromes : pendant la période de frai, elles quittent la mer où elles vivent en temps normal et, guidées par leur seul et extraordinaire odorat, remontent les rivières pour regagner les eaux douces où elles sont nées. Une fois arrivés dans leur zone de reproduction, les saumons jeûnent pendant que la maturation des œufs et des spermatozoïdes s’achève. Après l’accouplement, les femelles pondent un nombre relativement faible d’œufs sur des fonds de gravier à faible profondeur. Chez diverses espèces, une grande partie des géniteurs meurent après la ponte.
L’ordre des Salmoniformes est composé de plus de 200 espèces regroupées en différents genres. En voici les informations essentielles ; pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux pages taxonomiques correspondantes.

La truite est présente en Europe avec diverses races. Les truites de mer remontent les rivières pour se reproduire © Janne Passi
Corégone est le nom générique qui désigne plus de 70 espèces de Coregonus (Linnaeus, 1758), genre principalement d’eau douce des régions froides de l’hémisphère boréal.
Certains Corégones des régions plus septentrionales vivent dans les eaux marines et sont anadromes.
Le Lavaret ou Corégone lavaret (Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758) est présent dans les eaux douces du centre et du nord de l’Europe. Très apprécié pour la qualité de sa chair, le Lavaret a été introduit en Italie à la fin des années 1900, où il est désormais largement présent dans les lacs du nord et du centre de la péninsule.
Du même genre, itons le Grand corégone (Coregonus maraena Bloch, 1779), souvent confondu avec le Corégone et également appelée Hareng de lac.
Le nom de Truite est attribué à plusieurs espèces de Salmonidés et en particulier à celles relevant des genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus.
La Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), ou Truite américaine, est originaire de l’Amérique du Nord, d’où elle a été introduite dans une grande partie de l’Europe.
Les noms génériques de Saumon et Truite sont couramment utilisés pour désigner les espèces de Salmo, genre dont l’aire de répartition couvre l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Anatolie, y compris certaines régions du centre-ouest de l’Asie.
L’une des espèces les plus connues du genre est le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar Linnaeus, 1758), espèce anadrome désignée simplement sous le nom de Saumon. Largement répandu le long des côtes d’Amérique du Nord, ce poisson , à la faveur d’actions humaines, est désormais présent sur presque tous les continents, y compris l’Australie. Par ailleurs, la dénomination Truite méditerranéenne ou Truite péninsulaire regroupe sous le nom spécifique de Salmo ghigii (Pomini, 1941) toutes les truites originaires de l’Italie péninsulaire.
Le rang d’espèce est attribué à la Truite sicilienne ou Truite à grosses taches (Salmo cettii, Rafinesque, 1810), à la Carpe de Garda (Salmo carpio Linnaeus, 1758), indigène du Lac de Garde, et à la Truite de Fibreno ou Carpe de Fibreno (Salmo fibreni Zerunian – Gandolfi, 1990), endémique de la réserve naturelle du lac Posta Fibreno. La Truite de l’Adriatique ou Truite illyrienne (Salmo obtusirostris Heckel, 1851), appelée encore Truite à lèvres molles, est originaire des cours d’eau karstiques du nord-est de la mer Adriatique.

La Truite fario (Salmo trutta fario) est une variété des rivières de montagne. Dans les eaux chargées en caroténoïdes, sa chair prend une couleur rosée comme celle du saumon qui lui vaut la dénomination, sans valeur taxonomique, de Truite saumonée. On obtient le même résultat en aquaculture par une alimentation appropriée © Giuseppe Mazza
La Truite commune (Salmo trutta Linnaeus, 1758) est présente, sous différentes races dont la taxonomie demeure floue, dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique du Nord, en Anatolie et en Asie centrale. La taille et la livrée de ce poisson varient très sensiblement en fonction du milieu dans lequel il vit.
Les sujets marins et lacustres, appelés respectivement Truite de mer et Truite de lac, peuvent dépasser 1 m de long et présentent un corps argenté avec quelques petites taches sombres en forme de X, comme le Saumon.
La Truite fario est une variété des rivières et des ruisseaux, en particulier des torrents de montagne. Elle ne dépasse généralement pas 50 cm de long et présente une livrée agrémentée de taches rondes caractéristiques, noires sur le dos et rouge vif ou brunes sur les flancs, disposées en série horizontale. Les nageoires pectorales et ventrales sont de couleur jaunâtre. Dans les eaux particulièrement riches en caroténoïdes, la chair de la truite prend une couleur rosée comme celle du Saumon, d’où le terme, sans valeur taxonomique, de Truite saumonée.

La Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) est une espèce native d’Amérique du Nord qui a été introduite dans une grande partie de l’Europe © Bruce Deagle
La Truite d’Abant (Salmo abanticus Tortonese, 1954) est un Salmoniforme d’eau douce dont la taille reste généralement inférieure à 50 cm. Initialement considérée comme une race de Salmo trutta, puis comme une espèce distincte, la Truite d’Abant a actuellement un statut non défini et est présentée comme une souche limitée au lac d’Abant, en Anatolie. La Carpe de Garda (Salmo carpio Linnaeus, 1578) est un Salmoniforme originaire du lac de Garde, dans lequel elle accomplit tout son cycle de vie.
La Truite marbrée (Salmo marmoratus Kottelat & Freyhof, 2007), autrefois considérée comme une sous-espèce de Salmo trutta, a été plus récemment élevée au rang d’espèce. On connaît ce poisson dans les bassins fluviaux subalpins de l’Adriatique, dans les torrents, même à haute altitude, dans les bassins lacustres et dans les cours d’eau de plaine.
La Truite sicilienne ou Truite à grosses taches (Salmo cettii Rafinesque, 1810) se caractérise par la présence de taches punctiformes noires et l’absence de taches rouges. Elle est connue dans certains cours d’eau, essentiellement dans le sud-est de la Sicile.

Venu d’Amérique du Nord, l’Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) a été introduit en Europe à la fin du 19e siècle, parfois au détriment de l’ichtyofaune locale © G. Mazza
D’une façon générique, on appelle Ombles les espèces de Salvelinus (J. Richardson, 1836), genre de Salmoniformes originaires d’Amérique du Nord, où ils vivent dans des eaux froides et claires. Plusieurs espèces ont développé des comportements anadromes. Les Ombles sont de taille très variable, allant des 15 cm de Salvelinus lonsdalii (Regan, 1809), courant dans les eaux douces d’Angleterre, aux 150 cm du Cristivomer ou Omble du Canada (Salvelinus namaycush, Walbaum, 1792), originaire des eaux douces de l’Amérique du Nord septentrionale.
L’Omble de fontaine ou Saumon des fontaines (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) est un Salmoniforme à la livrée bigarrée et aux nageoires bordées de blanc, dont la taille est généralement inférieure à 40 cm. Originaire des eaux froides et tempérées d’Amérique du Nord, ce poisson a été introduit en Europe à la fin du 19ème siècle, souvent avec des conséquences néfastes pour l’ichtyofaune locale.
L’Ombre de l’Adriatique ou Ombre du Sud des Alpes (Thymallus aeliani Valenciennes, 1848) est un poisson d’eau douce endémique du bassin du Pô et d’autres cours d’eau du nord de l’Italie.

L’Ombre de l’Adriatique ou Ombre du Sud des Alpes (Thymallus aeliani) est endémique des eaux douces du nord de l’Italie, dont notamment le bassin du Pô © lifegraymarble
L’Ombre commun ou Ombre de rivière (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758), originaire du centre-nord de l’Europe, a été introduit dans diverses régions européennes, y compris l’Italie. Le Lenok (Brachymystax lenok Pallas, 1773) est un Salmoniforme d’environ 70 cm de long, des eaux douces du nord de l’Asie, de la Sibérie à la Corée. C’est un poisson qui peut atteindre jusqu’à 1 m de long et un poids de 15 kg. Hucho Günther, 1866 est un genre d’origine asiatique dont les représentants comptent parmi les poissons d’eau douce les plus impressionnants.
Ce genre compte quatre espèces, dont la plus connue est sans aucun doute le Saumon du Danube ou Huchon (Hucho hucho Linnaeus, 1758), poisson qui peut atteindre 150 cm pour un poids d’environ 50 kg. Autrefois exclusif au Danube et à ses principaux affluents, le Saumon du Danube a été introduit dans d’autres rivières d’Europe et d’Afrique du Nord. Une autre espèce du genre est le Saumon de Sibérie ou Taïmen (Hucho taimen Pallas, 1773), considéré par certains comme une sous-espèce du Saumon du Danube et aujourd’hui relégué à l’est de l’Asie.
Ordre des Myctophiformes

Benthosema pterotum est un Myctophiformes, ordre d’espèces de petite taille, environ 10 cm, au corps comprimé latéralement, à la bouche et aux yeux de grande taille et souvent, si elles vivent en eaux profondes, aux organes luminescents attirant les proies, d’où le nom de Poisson-lanterne. Reproduction avec parasitisme sexuel © uwkwaj
Autrefois réunis avec les Aulopiformes, les Myctophiformes sont considérés comme un ordre d’Actinopterygii distinct, comprenant des espèces de petite taille, en moyenne 10 cm, au corps comprimé latéralement et à la bouche et aux yeux généralement de grande taille. Sur la partie postérieure du corps et avant la nageoire caudale, on observe un lambeau de tissu dermique dépourvu de rayons, appelé nageoire adipeuse.
En relation avec leur vie en profondeur et leurs mœurs de prédateur, ces poissons sont généralement dotés d’organes luminescents (photophores). En référence à cette caractéristique, de nombreuses espèces, et en particulier les Myctophidae, sont souvent désignées par le nom générique de Poisson-lanterne. Hormis la bioluminescence, une autre caractéristique importante de ces poissons est leur mode de reproduction inhabituel, appelé parasitisme sexuel.
Commun à d’autres poissons abyssaux comme les Lophiiformes, le parasitisme sexuel est le fait que, pour assurer la reproduction, le mâle s’accroche au corps de la femelle et partage avec elle son système circulatoire. Ainsi, le mâle est alimenté tout en fournissant à la femelle un flux suffisant de spermatozoïdes pour féconder ses œufs.

Si l’apparence du Poisson-torche de l’Atlantique (Kryptophanaron alfredi) est similaire, c’est bien un poisson de l’ordre des Trachichthyiformes © Allison & Carlos Estape
Les Myctophiformes sont largement distribués dans toutes les mers, depuis les eaux chaudes équatoriales jusqu’aux mers froides polaires, où ils se trouvent en particulier dans les eaux profondes, loin des côtes. Dans leur grande majorité, ce sont des poissons bathypélagiques qui représentent une part importante des chaînes trophiques marines. Plusieurs espèces de poissons-lanternes sont communes en Méditerranée, certaines s’échouant parfois en grand nombre dans le détroit de Messine.
Parmi les Poissons-lanternes signalés en Méditerranée, on trouve la Lanterne grosse tête (Diaphus metopoclampus Cocco, 1829), poisson d’environ 7 cm, Benthosema pterotum (Alcock, 1890), de même longueur, et la Lanterne de Benoit (Hygophum benoiti Cocco, 1838), qui fait environ 8 cm. D’autres représentants de cet ordre sont les Neoscopelidae, poissons d’eaux profondes, présents de manière localisée dans les mers tropicales et subtropicales du monde entier, à l’exception de la Méditerranée. À un autre ordre, celui des Trachichthyiformes, appartient le Poisson torche de l’Atlantique (Kryptophanaron alfredi Silvester et Fowler, 1926), poisson d’environ 12 cm originaire du centre-ouest de l’Atlantique, qui doit son nom à la présence d’une structure bioluminescente typique près de la bouche.
Ordre des Ateleopodiformes

Les Ateleopodiformes sont des poissons abyssaux, absents de Méditerranée, qui habitent également le plan bathyal. Guentherus katoi vit dans le nord-ouest du Pacifique – National Oceanic and Atmospheric Administration, no known copyright restrictions
Il s’agit d’un ordre d’Actinopterygii auquel on attribue des espèces généralement très grandes, atteignant parfois 2 mètres. Les Ateleopodiformes sont des poissons au museau renflé et au corps très allongé, caractérisé par une très longue nageoire anale et une minuscule nageoire caudale.
La nageoire dorsale est courte et haute, et les nageoires ventrales sont généralement réduites à deux rayons situés à l’avant.
Poissons aux mœurs abyssales qui habitent également le plan bathyal, les Ateleopodiformes vivent dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique oriental, où l’on trouve l’Atéléopode de Loppe (Ijimaia loppei Roule, 1922), l’une des plus grandes espèces de l’ordre dont la longueur peut atteindre 2 mètres. Dans le nord-ouest du Pacifique on signale l’espèce Guentherus katoi (Kuwayama et Hiorate, 2008), poisson de haute mer d’un peu moins de 70 cm. L’ordre est absent de la Méditerranée.
Ordre des Stomiiformes

Poisson-vipère du Pacifique (Chauliodus macouni). Ainsi nommé du fait de ses longues dents, ce Stomiiformes de près de 30 cm peut descendre jusqu’à 4390 m. © Jackson W.F. Chu
Les Stomiiformes sont un ordre auquel on attribue des espèces d’aspect très varié, avec en général une taille réduite de quelques dizaines de centimètres.
Le plus petit représentant de cet ordre est le Cyclothone pygmée (Cyclothone pygmaea Jespersen & Tåning, 1926), originaire de Méditerranée et long de seulement 1,5 cm. Le plus grand des Stomiiformes est Opostomias micripnus Günther, 1878, largement distribué dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique, long d’environ 50 cm.
En lien avec leurs mœurs abyssales, ces poissons sont abondamment équipés d’organes luminescents (photophores) disposés en deux lignes parallèles sur la partie ventrale du corps.
De nombreuses espèces sont dotées d’une grande bouche armée de dents longues et acérées qui dépassent les yeux, comme le Dragagodet imberbe (Malacosteus niger Ayres, 1848) de l’Atlantique centre-est, dont la mâchoire peut se déployer largement pour attraper les petits crustacés et les poissons dont il se nourrit.

Caractérisé par sa bioluminescence rouge, aptitude unique chez les poissons, et un grand photophore orbital, le Poisson-dragon (Malacosteus australis) est un Stomiiformes présent dans les eaux subtropicales et tempérées de l’hémisphère sud. Les Stomiiformes fréquentent toutes les mers, y compris les mers polaires © ESRI, Dr. Beinart, Tracey T. Sutton
Certains Stomiiformes se caractérisent par une bouche pratiquement verticale, sans dents ou avec des dents minuscules.
Plusieurs espèces présentent des yeux télescopiques orientés vers le haut et la plupart des Stomiiformes disposent d’un barbillon parfois très long sous la bouche, souvent équipé de photophores qui attirent les proies.
Le corps de ces poissons, recouvert de fines écailles facilement détachables, voire dépourvu d’écailles, est généralement de couleur sombre, noire ou brune, ce qui leur autorise une grande discrétion dans l’environnement obscur des eaux profondes où ils vivent.
Figurant parmi les poissons d’eau profonde les plus typiques, bien qu’ils puissent aussi être trouvés dans les eaux de surface, les Stomiiformes fréquentent toutes les mers, y compris les mers polaires.
Voici quelques espèces de cet ordre.

L’Idiacanthe ruban (Idiacanthus fasciola) est un Poisson-dragon à barbillons de l’Atlantique Nord. Il taquine les 50 cm et présente de grandes mâchoires aux dents longues © Ken Graham
Le Poisson-vipère du Pacifique (Chauliodus macouni Bean, 1890) est un Stomiiformes des eaux profondes du Pacifique long d’un peu moins de 30 cm, qui se distingue par ses longues dents dont il tire son nom commun.
Idiacanthus fasciola Peters, 1877 appartient au groupe dit des Poissons-dragons à barbillons, caractérisés par de très grandes mâchoires garnies de longues dents. Ce poisson n’atteint généralement pas la taille de 50 cm. Mésopélagique, on le rencontre en eaux profondes dans l’Atlantique Nord.
Caractérisé par sa bioluminescence rouge, capacité unique parmi les poissons, et un grand photophore orbital, Malacosteus australis Kenaley, 2007 est un Poisson-dragon à barbillons dont la taille reste généralement inférieure à 20 cm. Appelée Southern Semaphore Mobile Jawfish par les populations locales, cette espèce vit dans les eaux subtropicales et tempérées de l’hémisphère sud.
Sous-classe des DIPNOI

La sous-classe des Dipnoi, ancien groupe de vertébrés à mâchoires (Gnathostomata), réunit des formes qui respirent à l’aide de branchies et de poumons © Vincent Rufray
C’est l’un des plus anciens groupes de vertébrés dotés de mâchoires (Gnathostomata). Ces animaux présentent des formes caractérisées par leur double capacité respiratoire, par des branchies ou par des poumons, d’où les noms de Dipnoi ou Dipneusti (Dipneustes en français), ou encore Poissons Pulmonés.
Le poumon de ces poissons est issu d’un diverticule ventral du pharynx ; pendant la croissance, il s’allonge, s’enroule autour du pharynx lui-même et prend une position dorsale.
La double capacité respiratoire des Dipnoi suppose la séparation entre la circulation sanguine générale, branchiale, et pulmonaire.
Aujourd’hui, avec le progrès des connaissances ichtyologiques, on sait que cette particularité est un peu plus ancienne que les Dipnoi eux-mêmes et qu’elle est largement partagée par pratiquement toutes les formes archaïques de tous les clades d’Osteichthyes.

C’est pourquoi on les appelle aussi poissons pulmonés, tels que ces Neoceratodus forsteri des eaux douces de l’est de l’Australie © Jan Stefka
Il semble que les Placodermi, poissons fossiles du Paléozoïque réputés aujourd’hui éteints, aient également été dotés de vessies gazeuses correspondant à celles des Poissons osseux les plus primitifs et, par voie de conséquence, aux poumons des vertébrés terrestres.
D’origine très ancienne, puisque des fossiles témoignent de leur présence dès le Dévonien (il y a environ 400 millions d’années), les Dipnoi constituent un groupe présentant des caractères très archaïques comme la colonne vertébrale sans corps vertébraux, et la queue qui, initialement hétérocerque chez les espèces fossiles, devient diphycerque chez les formes modernes.
Les nageoires ont persisté du Paléozoïque à nos jours et conservent encore la structure primitive avec une double série de rayons (archipterygium bisérié).
À ce propos, la double capacité respiratoire et la nageoire archiptérygienne étaient autrefois considérées comme caractéristique de l’ancêtre des Tétrapodes, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux et Mammifères ; la théorie qui prévalait était donc que les Dipnoi étaient le trait d’union entre Poissons et Amphibiens.

Protopterus dolloi. Quand les cours d’eau où ils vivent s’assèchent, les Protopterus s’enveloppent d’un cocon boueux et respirent l’air en attendant le retour des pluies © Giuseppe Mazza
Par la suite, et pendant longtemps, on a plutôt pensé que le rôle de trait d’union entre la faune aquatique et la faune terrestre était joué par les Crossopterygii, plus précisément les Rhipidistia, dotés d’appendices pairs ressemblant plus à des membres qu’à des nageoires. Très répandus au Paléozoïque, les Rhipidistia se sont probablement éteints dès le Permien, à la fin du Paléozoïque (il y a environ 250 millions d’années).
Aujourd’hui, de récentes avancées de biologie moléculaire ont relancé la théorie selon laquelle les Dipnoi, et non les Ripidisti, seraient les véritables ancêtres des Tetrapoda.
Les formes actuelles des Dipnoi présentent un corps allongé, évoquant parfois celui d’une anguille, recouvert de fines écailles cycloïdes disposées en tuiles. La tête est large et aplatie, les yeux latéraux sont plutôt petits. La bouche s’ouvre ventralement à l’extrémité du museau et est équipée de rangées successives de dents disposées en éventail, caractéristique qui n’existe chez aucune autre espèce de vertébrés.
La présence de coanes, situés derrière la lèvre supérieure et ouverts dans la cavité buccale, a également valu à ces poissons le nom de Coanoitti. Les fentes branchiales sont recouvertes d’un opercule.

Ce Neoceratodus forsteri australien nageant en surface aspire clairement de l’air par la bouche © Gavin Goodyear
Un caractère distinctif important est la nageoire dorsale, qui, diversement développée, est entière et se prolonge par la queue et l’anale, également indivise ; il n’y a qu’une seule nageoire caudale. Les nageoires pectorales et ventrales sont aplaties et recouvertes de minuscules écailles. Chez certaines espèces, elles sont très charnues et soutenues par des éléments osseux, et permettent à ces poissons de marcher sur le fond.
Chez les Dipnoi, la ligne latérale est clairement définie, et l’évent est absent. Un autre caractère de primitivité structurelle chez les Dipnoi est la présence d’une valve spirale dans l’intestin, qui reste court et droit.
Les sexes sont séparés et la reproduction des Dipnoi ne se fait qu’en milieu aquatique. Après l’accouplement, les femelles pondent de petits œufs de 2 à 3 millimètres de diamètre, recouverts de gélatine. Après 3-4 semaines, éclosent des jeunes à l’aspect larvaire, équipés de branchies externes rappelant celles des Brachiopterygii et des amphibiens Urodèles.
Il faut remarquer que les espèces actuelles de Dipnoi qui vivent dans les eaux du continent australien ne peuvent respirer de l’air que pendant une période limitée, alors que les espèces africaines et sud-américaines sont capables de traverser de longues périodes de sécheresse (jusqu’à quatre ans) en se réfugiant dans un abri creusé dans la boue du fond et scellé par un mucus protecteur.

Ce Protopterus aethiopicus respire hors de l’eau. Aussi a-t-on longtemps pensé que les Dipnoi étaient les ancêtres des Tetrapoda, les premiers vertébrés terrestres © Jason
Dans cette tanière, ces poissons survivent en entrant dans une sorte de léthargie (estivation) durant laquelle ils respirent directement l’air atmosphérique et réduisent fortement leurs activités métaboliques.
Pendant cette période, ils se contentent de consommer leurs propres réserves de graisse, les déchets du métabolisme étant transformés en urée au lieu d’ammoniaque.
Très communs au Trias (il y a environ 250 à 200 millions d’années), ils peuplaient probablement, à cette époque, les eaux douces de toute la Pangée, ce supercontinent qui concentrait toutes les masses continentales au Paléozoïque et au début du Mésozoïque. Les Dipnoi ont ensuite connu un déclin rapide au cours du Permien.
Aujourd’hui, presque complètement éteints, les Dipnoi ne sont plus représentés que par 6 espèces dont il faut mentionner Lepidosiren paradoxa (Fitzinger, 1837), seule espèce du genre et propre aux eaux douces des marécages de la forêt amazonienne, Neoceratodus forsteri (Frefft, 1870), endémique des cours d’eau du nord-est de l’Australie, et le Protoptère éthiopien (Protopterus aethiopicus Heckel, 1851), signalé dans les eaux intérieures d’Afrique.
Sous-classe des CROSSOPTERYGII
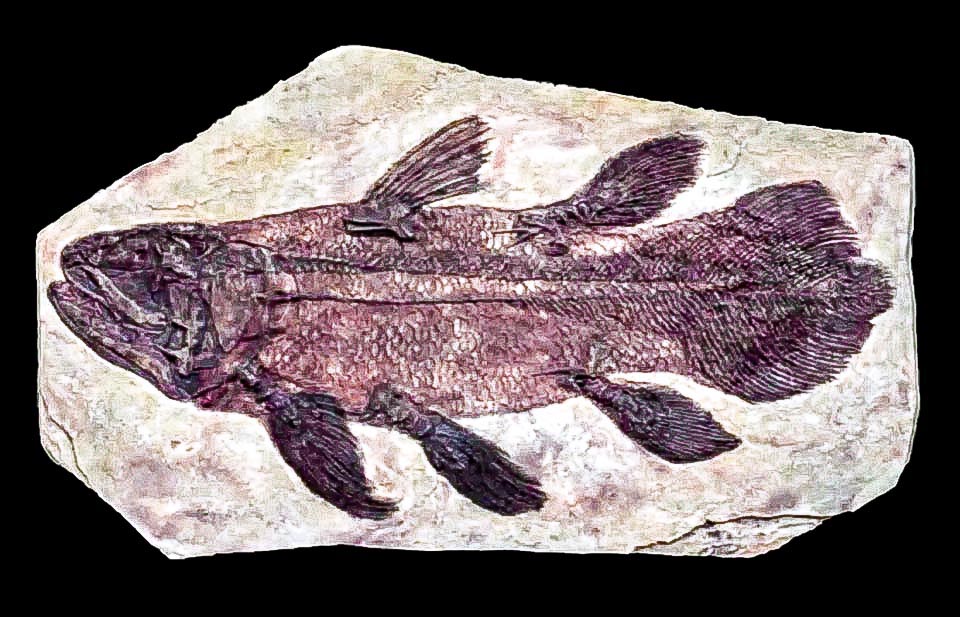
Puis, en observant les fossiles de Latimeria, poisson de la sous-classe des Crossopterygii, on a imaginé que c’étaient ces poissons qui avaient colonisé la terre © R.d207bea75a0adeb620180d0085980e43
Considérés comme les plus archaïques des vertébrés à mâchoires (Gnathostomata), les Crossopterygii constituent une sous-classe de Poissons osseux dont les fossiles témoignent de la présence depuis le début du Dévonien (il y a plus de 400 millions d’années). Presque totalement éteints à la fin du Mésozoïque, en même temps que disparaissaient les dinosaures (il y a environ 65 millions d’années), les Crossopterygii ne sont plus représentés aujourd’hui que par le Cœlacanthe (Latimeria (Smith, 1939)), découvert en 1938 par Marjorie E. D. Courtenay-Latimer, biologiste conservatrice du Muséum d’histoire naturelle d’East London, en Afrique du Sud.
Véritables fossiles vivants, les deux seules espèces connues de Latimeria conservent de nombreux caractères de primitivité, comme la voûte dermato-crânienne homologue aux plaques osseuses des Placodermi, aux os crâniens des Paleoniscoidi et aux os crâniens des anciens Amphibiens.
La primitivité des Crossopterygii est confirmée par la texture des écailles de type cosmoïde qui recouvrent le corps. L’écaille cosmoïde représente la forme la plus ancienne issue des plaques osseuses des premiers poissons (Ostracodermi et Placodermi), aujourd’hui disparus.
D’autres caractéristiques de la primitivité de ces poissons se retrouvent dans la colonne vertébrale où des vertèbres individuelles sont absentes du corps, et dans les dents, caractérisées par le fait qu’elles sont recouvertes d’un émail réparti de manière inégale, comme chez les Tétrapodes à labyrinthe.

La découverte, bien vivants, de Latimeria chalumnae, que voici, et de son homologue Latimeria menadoensis, ont fait de cette hypothèse une quasi-certitude © wrecklessmarine
Même la queue conserve une structure primitive différente et est subdivisée en trois lobes, dont le médian comprend le prolongement de la corde dorsale (notocorde).
Le nom de cette sous-classe fait référence à la structure des nageoires, qui est toujours archiptérygienne ; à la différence des Dipnoi chez lesquels elle est bisériée, elle est typiquement monosériée, c’est-à-dire avec un seul jeu de rayons latéraux implantés sur l’axe médian.
Les exceptions sont les Cœlacanthiformes dont les nageoires, bien que de type archiptérygien, sont dépourvues de rayons. Chez ces poissons, les nageoires pectorales et anales, charnues et soutenues par des éléments osseux, sont également utilisées pour se déplacer sur le fond. La vessie natatoire, non appariée et dorsale, est fortement réduite et ne fonctionne pas comme un organe hydrostatique, ni comme un organe respiratoire accessoire.
On pense que les poissons Crossopterygii, dont l’origine est identifiée dans une ramification précoce des Dipnoi, étaient séparés dès le Paléozoïque en deux lignées phylétiques divergentes, les Actinistiens et les Rhipidistiens. Un seul ordre, les Coelacanthiformes, regroupe les Actinistiens, tous marins, caractérisés par une nageoire sans rayons, ne pouvant se référer au modèle monosérié des Crossopterygii, et aujourd’hui représenté uniquement par les Coelacanthes (Latimeria Smith, 1939), auxquels deux espèces sont rattachées.

Fait renforcé par la proximité des écailles de Latimeria chalumnae, du cœlacanthe fossile et des restes de Tetrapoda, et par la structure du crâne et des vertèbres © Cordenos Thierry
Le Cœlacanthe africain (Latimeria chalumnae Smith, 1939) est un grand poisson, dont la longueur totale peut atteindre 2 m pour un poids de 80 kg. Il se caractérise par la couleur bleue intense de son corps.
Son aire de répartition est fragmentée ; on le trouve dans le Canal du Mozambique et les îles Comores, entre 200 et 600 m de profondeur.
Le Cœlacanthe indonésien (Latimeria menadoensis Pouyaud et al., 1999), retrouvé en Indonésie dans les eaux de Sulawesi (anciennement Célèbes), se différencie du Cœlacanthe africain par la coloration brune du corps, et par l’étude de l’ADN biomoléculaire.
Les cœlacanthes, dont la biologie est peu connue, sont des animaux vivipares. Les femelles produisent de gros œufs riches en vitellus (télolécithes) de près de 10 cm de diamètre. À la naissance, les jeunes mesurent plus de 30 cm de long.
Le groupe des Ripidisti, Crossopterygii aujourd’hui tous éteints, comprend des formes fossiles, attribuées à divers ordres (Osteolepiformi, Porolepiformi, Stomiiformi).

Aujourd’hui, la biologie moléculaire est le juge de paix. Ce Protopterus annectens semble se réjouir que les Dipnoi aient donné naissance aux vertébrés terrestres © Giuseppe Mazza
À la différence des Coelacanthiformes, les formes incluses dans le groupe des Rhipidistiens habitent les eaux continentales. Contrairement aux Dipneustes, les Crossoptérygiens actuels de l’ordre des Coelacanthiformes vivent exclusivement en milieu marin où ils séjournent généralement à des profondeurs de 300-400 m.
Pour conclure ce bref aperçu, mentionnons que, précisément, les Crossoptérygiens Rhipidistiens Ostéolépiformes sont considérés comme les progéniteurs des vertébrés terrestres. Cette hypothèse est basée sur l’évaluation de la structure du crâne et des vertèbres, ainsi que sur les dents de type labyrinthodonte et les nageoires archiptérygiennes qui préfigurent les pattes des Tétrapodes.
Cette hypothèse a fini par supplanter la précédente, selon laquelle les ancêtres des vertébrés terrestres (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères) se trouvaient plutôt parmi les Dipneustes.
Toutefois, aujourd’hui, de récents résultats en biologie moléculaire ont relancé la théorie selon laquelle ce sont les Dipneustes et non les Crossoptérygiens du groupe des Rhipidistiens qui sont à l’origine des vertébrés terrestres.
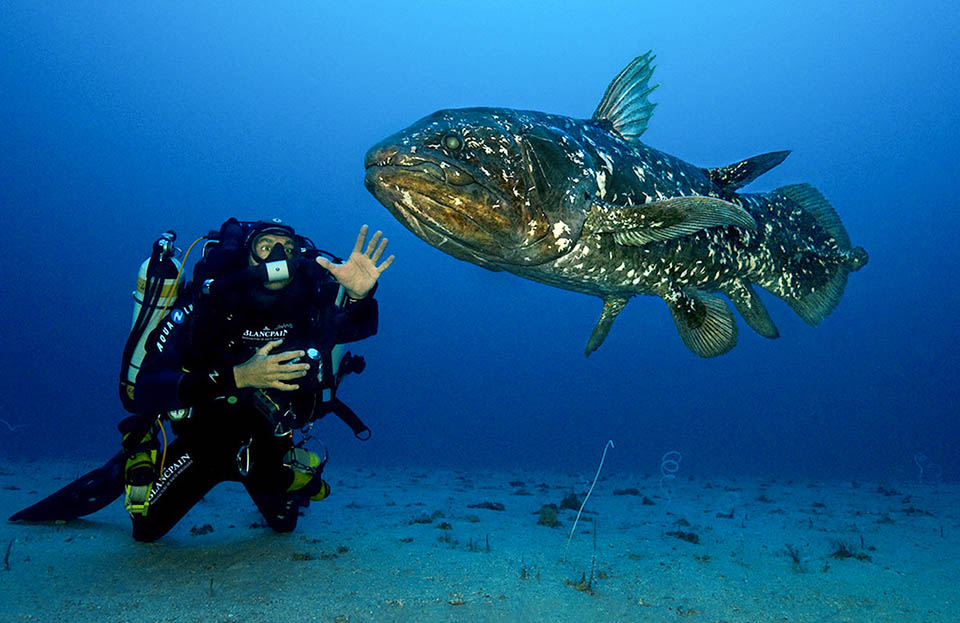
En réalité, le gagnant est la vie, et tous les êtres vivants sont gagnants de la même manière : parce que tous ont trouvé leur chemin vers la vie à travers les millénaires © Laurent Ballesta
