Famille : Columbidae

Texte © Dr. Gianfranco Colombo

Traduction en français par Catherine Collin

Espèce résolument en expansion, le Pigeon ramier ou Palombe (Columba palumbus) occupe un très vaste territoire couvrant l'Europe entière jusqu'à l'Oural et, comme si ce n'était pas assez, il a aussi colonisé, à travers le Moyen-Orient, pratiquement toute la façade tempérée du continent asiatique, jusqu'aux grandes plaines indiennes © Gianfranco Colombo

Le voici dans la nature alléché mais circonspect sur un sureau chargé de fruits © Giuseppe Mazza
C’était un oiseau sauvage, craintif, prudent, méfiant et difficilement approchable et ces caractéristiques sont encore présentes chez les individus de la campagne ou chez les populations vivant loin des milieux anthropisés.
Il suffisait pourtant d’aller dans n’importe quel parc londonien pour les voir trottiner entre les pieds en grand nombre, roucouler bruyamment sur la branche la plus basse juste au-dessus de la tête d’un homme assis sur un banc quand ce n’était pas en train de couver sur le haut de la colonne à l’entrée du parc, indifférents à la présence humaine. Un oiseau citadin, désormais habitué à la vie urbaine.
La véritable nature de cet oiseau est en revanche bien connue des chasseurs qui le recherchent activement, vu son abondance, pour sa chair savoureuse. C’est une proie méfiante montrant une grande intelligence pour esquiver les ruses et les appâts placés pour l’attirer. À cause de son caractère envahissant, dans certains pays dont le Royaume-Uni, la saison de la chasse au Pigeon ramier dure pratiquement toute l’année puisqu’il est considéré comme nuisible pour l’agriculture.
En revanche, dans le sud de l’Europe où confluent les immenses populations migratoires provenant des aires du Nord du continent, la chasse n’est pratiquée, avec passion, qu’en automne et cette période attendue avec impatience par un grand nombre de chasseurs.
Le Pigeon ramier ou Palombe (Columba palumbus Linnaeus 1758) appartient à l’ordre Columbiformes et à la famille Columbidae. C’est le plus gros et le plus répandu de tous les pigeons d’Europe.

Ils sont mûrs et irrésistibles et depuis toujours ses fruits préférés, avec ceux du lierre, les glands et la salade d'inflorescences de hêtre © Giuseppe Mazza
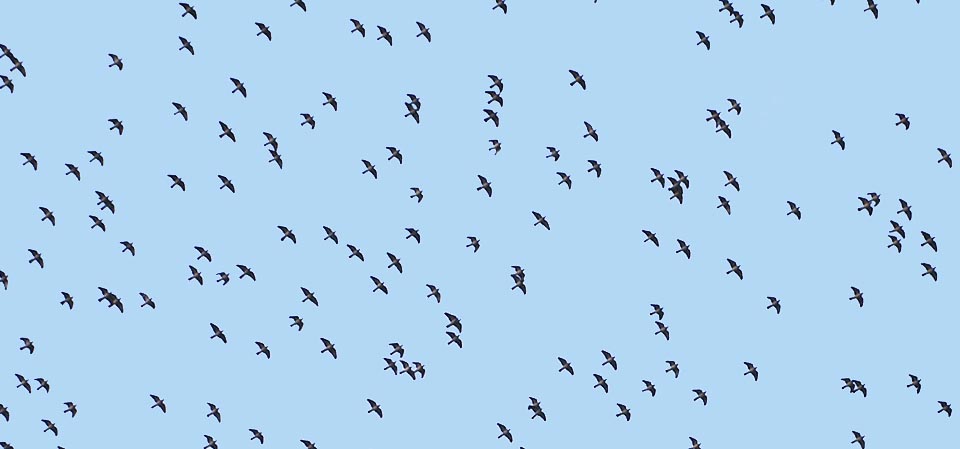
Mais aujourd'hui le Pigeon ramier s'est anthropisé et quand dans le ciel il en vole un groupe comme celui-ci, les agriculteurs sont, avec raison, inquiets pour leurs récoltes © Gianfranco Colombo
Comme il arrive souvent, la genèse de ses noms scientifiques se perd confusément dans le temps, donnant naissance à des interprétations variées et confuses.

Le voici dans un champs de maïs, mais il cause aussi des dégâts aux cultures de blé, de riz, de soja et de tournesol, et peut même détruire un verger, brisant sous son poids les branches sur lesquelles il se pose en groupe. Les pigeons ramiers sont malheureusement des redoutables destructeurs de cultures © Gianfranco Colombo

Puis, comme si de rien n'était, le vandale s'enfuit. Mesurant pratiquement le double du Pigeon biset, Columba palumbus atteint 40 cm de long, 75 cm d’envergure pour un poids de 600 g © G. Colombo
Et pour rendre encore plus confuse l’interprétation, par le terme islandais klumba on indique les Guillemots à miroir (Cepphus grylle) pour leur taille similaire et pour le fait qu’eux-aussi pondent deux œufs comme il est habituel chez les colombidés.
Évidemment, la prédominance historique sur cette langue nordique joue en faveur du latin mais il serait intéressant d’en connaître les origines et les correspondances ou peut-être les retranscriptions ou déformations linguistiques ayant eu lieu à travers les siècles.
Le nom d’espèce palumbus dérive lui aussi du latin, mais simplement de “palombes” = pigeon des bois, pour l’habitat principal de cet oiseau.
Il est appelé Wood Pigeon en anglais, Colombaccio ou Palombo en italien, Ringeltaube en allemand, Paloma torcaz en espagnol et Pombo-torcaz en portugais.
A noter la singularité du nom dans les langues ibériques où le nom torcaz vient du latin torques = bande, collier, pour le dessin qu’il porte sur le cou. Le même terme, déformé en trocaz, a donné son nom à une espèce de pigeon endémique de Madère (Columba trocaz).
Zoogéographie
Le Pigeon ramier occupe un très vaste territoire qui couvre entièrement l’Europe jusqu’à l’Oural et à travers le Moyen-Orient, la façade tempérée du continent asiatique jusqu’à la plaine indienne. Il est absent d’Islande, de l’extrême nord de la péninsule scandinave et de Russie ainsi que des territoires au nord des grandes chaînes de montagnes asiatiques. En Inde il est absent dans la partie tropicale de la péninsule. Il est aussi présent en Afrique mais uniquement au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Alors que chez le pigeon biset, souvent hybridé avec le pigeon domestique, la livrée varie, ici il y a toujours les bandes alaires blanches, bien visibles en vol, et le collier © Giuseppe Mazza

La poitrine du Pigeon ramier est rosâtre-vineux. L’œil, blanc perle, rappelle la couleur de la cire qui surplombe le bec jaune et rouge-vineux. Très souvent, la pupille est étrangement elliptique © Mazza
Le Pigeon ramier est largement sédentaire dans les aires où il n’y a pas de couverture neigeuse hivernale ou alors très peu.
Ayant une alimentation très variée il pourrait aussi survivre à des hivers plus rigoureux en s’adaptant à des aliments qui ne lui sont pas habituels.
Toutefois il a été constaté que les populations continentales entreprennent durant l’automne, d’importants déplacements qui les conduisent dans l’aire méditerranéenne où les conditions météorologiques sont sûrement meilleures et l’alimentation plus facilement repérable.
Les importantes transformations intervenues dans l’activité agricole dans les dernières décennies, notamment avec l’introduction massive de monocultures comme le maïs, le soja et le tournesol, ont grandement favorisé l’accroissement des populations européennes de ce pigeon, conduisant à des limites insupportables pour l’agriculture.
Ce surpeuplement a certainement provoqué l’occupation massive de territoire initialement évités par peur et par prudence, obligeant ainsi cet oiseau à abandonner partiellement l’habitat typique auquel il était habitué.
L’habitat traditionnel du Pigeon ramier est, comme le dit son nom vulgaire anglais, les bois ou la forêt de feuillus mais aujourd’hui nous le trouvons partout, puisqu’il s’est adapté à n’importe quelles conditions.
Jardins, parcs, petits bois, peupleraies, rives des fleuves et des rivières, les longues rangées d’arbres dans la campagne cultivée, une frange de verdure ou un buisson de ronces, tout cela est devenu l’habitat de cet oiseau.
Il n’aime pas les milieux montagneux sauf dans l’Atlas marocain.
Le maquis, où il se réfugie durant des heures, est le point de départ de ses missions dans les campagnes environnantes, où en volées parfois exceptionnelles, il s’abat sur les cultures y provoquant souvent d’importants dégâts.

Pour bâtir son nid le Pigeon ramier ne ramasse pas de branches, il les casse avec son bec © Gianfranco Colombo
Morpho-physiologie
Le Pigeon ramier est vraiment un pigeon grand et robuste. Il fait le double du Pigeon biset.
Bien qu’ayant les même caractéristiques, le même comportement et parfois une livrée très semblable, ils mènent des vies nettement séparées et on ne peut les observer ensemble que très rarement.
Il n’y a qu’en ces occasions que l’on peut noter la grande différence de taille et relever ces petits détails qui sont déterminants dans la classification de l’espèce.
Le vol du Pigeon biset est plus tendu et nerveux alors que celui du Pigeon ramier est plus indolent. Celui-ci a en vol une attitude hardie gardant la tête dressée en un port altier alors que le biset est plus compact, arrondi dans la forme.
Le Pigeon ramier aime se poser sur les arbres touffus alors que le Pigeon biset préfère les fils, les poteaux électriques, les toits et les bâtiments.
Si chez le Pigeon biset la livrée peut être très variable à cause des continuels croisements avec des espèces domestiques, chez le Pigeon ramier elle est toujours semblable et met en évidence la bande alaire et le collier blanc.
Son vol est très bruyant particulièrement à l’envol.
Le Pigeon ramier mesure plus de 40 cm de long, a une envergure de 75 cm et son poids peut aller jusqu’à 600 g.
Il a une silhouette élancée et sa queue est marquée de bandes sombres ; le cou et la tête sont très proéminents sur le corps.
La livrée est gris-bleuâtre sur la tête et la partie supérieure du corps avec une atténuation bronze-bleuté sur la poitrine.
Le cou montre un typique collier blanc limité à la nuque, qui devient plus prononcé avec l’âge, complété par deux bandes transversales sur les ailes, visibles quand il est en vol. L’œil est blanc perle comme la cire qui surplombe le bec jaune-rose vineux et contraste avec celui-ci. La pupille est très souvent elliptique, pas parfaitement ronde. Les pattes rosâtres sont très courtes et robustes comme chez tous les colombidés.

D’accès difficile y compris pour celui qui couve, le nid est une petite plate-forme parmi les branches © Giuseppe Mazza
Un autre de ses congénères est le bien connu Pigeon colombin (Columba oenas), de taille légèrement plus petite qui partage une bonne partie de son territoire et qui hiverne souvent avec lui en volées mixtes. Sa livrée est presque semblable sauf qu’elle ne présente pas les marques blanchâtres évidentes chez le Pigeon ramier.
Comme tous les colombidés, le Pigeon ramier roucoule et ce sur un ton très bas et morne, un peu plus allongé que celui des autres pigeons dans les phrases mais persistant et audible de très loin. Il émet des groupes de cinq syllabes accentué sur la première : “rou-rouou-rou-rou-ru” à la différence du Pigeon colombin qui en émet deux, accentué sur la seconde et de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) qui en fait trois accentué sur la seconde.
Éthologie-biologie reproductive
Comme souvent chez les colombidés, chez le Pigeon ramier aussi le couple se montre très affectueux et les partenaires n’acceptent pas de fugues amoureuses. Ces pigeons sont aussi très territoriaux et défendent vigoureusement leur propre territoire même si, au moment de rejoindre les sites de nourrissage, ils se réunissent en grandes volées et cohabitent pacifiquement jusqu’au moment de retourner au nid.
La parade nuptiale est typique des pigeons où le mâle se pavane et fait de fréquentes approches. Elle comporte aussi le vol territorial typique de la part du mâle, caractérisé par de fréquentes roulades et plongeons ondulés, particularité reprise dans la racine du nom scientifique. Le nid est une faible plate-forme formée de petit rameaux secs, appuyée sur une branche horizontale ou un support de lierre grimpant, dans des buissons épais souvent inaccessibles ou d’accès difficile y compris pour eux-mêmes. Ces petits rameaux ne sont pas ramassés au sol mais toujours détachés, parfois avec de grandes difficultés, directement sur les arbres, utilisant pour ce faire leur bec.

Le mâle et la femelle du Pigeon ramier couvent chacun leur tour. L’incubation dure environ 18 jours et les petits sont nourris avec le fameux “lait de pigeon”, une typique et caractéristique pâtée prédigérée, très nourrissante, qui est régurgitée directement par les parents dans le jabot des oisillons affamés © Museo Lentate
Souvent, lors d’un envol soudain du nid le Pigeon ramier se cogne violemment contre les arbustes et les ronces, perdant du duvet et donnant l’impression de se blesser gravement. Mais le Pigeon ramier est un oiseau extrêmement robuste et fort, capable de faire face à n’importe quel obstacle lors du vol. Le nid au contraire est particulièrement fragile et tellement peu consistant que souvent on peut apercevoir par en-dessous les œufs très blancs qu’il contient. Comme c’est l’habitude chez les colombidés la femelle ne pond que deux œufs, mais les pigeons ramiers peuvent se reproduire jusqu’à trois fois dans l’année.

Comme il est normal chez les colombidés, les œufs sont au nombre de deux, mais le Pigeon ramier peut se reproduire jusqu'à 3 fois dans l'année © Gianfranco Colombo

Aux premiers froids hivernaux on peut en observer des volées de milliers d’individus en route vers le Sud © Gianfranco Colombo

À la fin de la saison ils sont dodus, cibles faciles à tirer par doublettes, et ce n'est certes pas une espèce en danger. Dans certains états on peut les chasser toute l'année © Giuseppe Mazza
→ Pour apprécier la biodiversité au sein des COLUMBIFORMES cliquez ici.
